
 Synthèses
Synthèses
Les événements marquants du Québec
- 1535 - Les Iroquoiens du Saint-Laurent accueillent Jacques Cartier à Hochelaga
- 1541 - Fondation de Charlesbourg-Royal
- 1600 - Établissement d’un poste de traite à Tadoussac
- 1608 - Fondation de Québec
- 1615 - Arrivée des Récollets en Nouvelle-France
- 1618 - Présentation d’un projet de colonie permanente à Louis XIII par Champlain
- 1629 - Prise de Québec par les frères Kirke
- 1634 - Fondation de Trois-Rivières
- 1639 - Arrivée des Augustines en Nouvelle-France
- 1642 - Fondation de Montréal
- 1642 - Inauguration de l’Hôtel-Dieu de Montréal par Jeanne Mance
- 1663 - Le Séminaire de Saint-Sulpice devient seigneur de l’île de Montréal
- 1663 - Arrivée des Filles du roi en Nouvelle-France
- 1665 - Arrivée du régiment de Carignan-Salières en Nouvelle-France
- 1668 - Fondation de la Brasserie du Roy en 1668
- 1690 - Siège de Québec par Phips
- 1701 - Grande Paix de Montréal
- 1711 - Expédition et naufrage de la flotte Walker
- 1754 - Guerre de la Conquête
- 1755 - Déportation des Acadiens
- 1759 - Siège de Québec par Wolfe
- 1759 - Bataille de Montmorency
- 1759 - Bataille des Plaines d'Abraham
- 1760 - Bataille de Sainte-Foy
- 1760 - Bataille de la Ristigouche
- 1763 - Signature du traité de Paris
- 1806 - Voyage du Columbo, premier train de bois de Philemon Wright
- 1809 - Mise en service de l'« Accommodation ».
- 1817 - Fondation de la Banque de Montréal
- 1818 - Fondation de la Banque de Québec
- 1824 - Inauguration du canal de Lachine
- 1833 - Première séance du Conseil municipal de Montréal
- 1834 - Banquet de la fête de la Saint-Jean-Baptiste de 1834
- 1837 - Rébellions des patriotes du Bas-Canada
- 1837 - Bataille de Saint-Denis
- 1837 - Bataille de Saint-Eustache
- 1838 - Bataille d'Odelltown
- 1849 - Émeutes de Montréal
- 1849 - Sanction de la loi révoquant le droit de vote des femmes dans la province
- 1860 - Inauguration du pont Victoria
- 1876 - Inauguration du parc du Mont-Royal
- 1893 - Inauguration du Monument-National
- 1894 - Carnaval d’hiver de Québec de 1894
- 1900 - Fondation de la Caisse populaire de Lévis
- 1918 - Émeutes de la conscription à Québec
- 1922 - Fondation du Comité provincial pour le suffrage féminin
- 1922 - Entrée en vigueur de la Loi relative à la conservation des monuments et des objets d’art ayant un intérêt historique ou artistique
- 1929 - Réalisation de travaux publics pendant la Grande dépression
- 1931 - Fondation du Jardin botanique de Montréal
- 1937 - Grève des midinettes de 1937
- 1940 - Obtention du droit de vote et d'éligibilité pour les femmes québécoises
- 1943 - Première conférence de Québec
- 1944 - Création d'Hydro-Québec
- 1948 - Adoption du fleurdelisé comme drapeau officiel du Québec
- 1948 - Lancement du manifeste Refus global
- 1949 - Grève de l’amiante
- 1963 - Deuxième phase de nationalisation de l'électricité au Québec
- 1966 - Inauguration du métro de Montréal
- 1967 - Tenue de l'Exposition universelle de Montréal de 1967
- 1969 - Dépôt du rapport Rioux
- 1969 - Premier match à domicile des Expos de Montréal
- 1973 - Création du Conseil du statut de la femme
- 1974 - Superfrancofête
- 1975 - Adoption de la Charte des droits et libertés de la personne
Les Iroquoiens du Saint-Laurent accueillent Jacques Cartier à Hochelaga

Le 2 octobre 1535, les Iroquoiens d'Hochelaga, dans l'île de Montréal, accueillent le navigateur français Jacques Cartier et son équipage à proximité de leur village.
En mai 1535, Jacques Cartier quitte la France pour rejoindre le Nouveau Monde. Le but de son deuxième voyage est de pénétrer à l'intérieur du continent pour découvrir le royaume mythique identifié sous le nom de Saguenay où se trouverait de l'or, richesse convoitée par les puissances européennes. Cartier arrive à Terre-Neuve après une traversée de 50 jours, puis remonte le Saint-Laurent jusqu'à Stadaconé (Québec). Sans guide ni interprète, il quitte ce village iroquoien le 19 septembre à bord de l'Émérillon pour poursuivre la remontée du fleuve et atteindre le royaume de Saguenay. Neuf jours plus tard, il doit jeter l'ancre aux battures du lac Saint-Pierre et continuer en barque.
Le 2 octobre 1535, Cartier débarque dans l'île de Montréal. Son point d'arrivée est probablement situé au pied du courant Sainte-Marie, bien que certains historiens le placent plutôt au Sault-au-Récollet. C'est la première fois que des Européens s'aventurent aussi loin dans l'axe du Saint-Laurent. Les Iroquoiens avaient entendu parler de la venue imminente d'étrangers et ont organisé une fête pour accueillir les Français avec des offrandes de toutes sortes. Cartier offre à son tour des articles ménagers aux femmes et des couteaux aux hommes. Les Autochtones lui présentent du même coup des cristaux de quartz et des pièces de cuivre. Sans valeur en Europe, ces métaux ont en revanche une grande signification dans la culture iroquoienne puisqu'ils confèreraient des pouvoirs de guérison à ceux qui les détiennent. Avant de se rendre à Hochelaga, les Français optent pour une nuit de repos à leur point d'accostage. Le lendemain 3 octobre, Cartier s'aventure dans une forêt de chênes sur quelques kilomètres. À mi-chemin, il rencontre un chef iroquoien qui l'invite à suspendre son excursion le temps de livrer un discours. Les Français se font ensuite guider à travers des champs de maïs et arrivent aux portes du village.
Situé au pied de la montagne, cet établissement est entouré d'une palissade en bois d'une hauteur de dix mètres. Selon le récit de voyage de Cartier, on y retrouve une cinquantaine de maisons dont les dimensions atteignent jusqu'à 35 mètres de long et 7 mètres de large. Chaque maison longue héberge plusieurs familles d'une même lignée matriarcale. On estime que la population d'Hochelaga était d'environ 1500 personnes. Lors de sa visite, Cartier fait la connaissance du grand chef (agouhanna) qui lui organise un banquet.
Le court passage de Jacques Cartier au village d'Hochelaga se termine par l'ascension de la montagne qu'il nomme mont Royal. Une fois au sommet, il constate la présence des rapides de Lachine. Cet obstacle naturel freine abruptement ses ambitions initiales. Cartier et son équipage rebroussent chemin le 5 octobre 1535. Ils passent l'hiver à Stadaconé et regagnent la France en 1536.
Cette expédition n'est que la première d'une longue histoire qui mènera les Français loin à l'intérieur du continent nord-américain. Le voyage de Jacques Cartier à Hochelaga est le premier contact connu entre les Français et les Iroquoiens de la région de Montréal. Nonobstant le choc culturel et la barrière linguistique, la rencontre des deux communautés est cordiale. C'est le début de relations en dents de scie dont les enjeux ont encore un écho dans la société québécoise.
TREMBLAY, Roland et al. Les Iroquoiens du Saint-Laurent : peuple du maïs. Montréal, Les Éditions de l'Homme / Pointe-à-Callière, Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, 2006. 139 p.
ALLAIRE, Bernard. « Jacques Cartier ». Historica Canada. L'encyclopédie canadienne [En ligne]. http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/jacques-cartier
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La ligne du temps du Québec [En Ligne]. https://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
GAGNÉ, Michel. « Hochelaga ». Historica Canada. L'encyclopédie canadienne [En ligne]. http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/hochelaga
MALCHELOSSE, Gérard. « Jacques Cartier va à Hochelaga ». Le cahier des Dix. Vol. 21 (1956), p. 31-53.
PENDERGAST, J.F. et Bruce G. TRIGGER. Cartier's Hochelaga and the Dawson Site. Montréal et Londres, McGill-Queen's University Press, 1972. 388 p.
PENDERGAST, J.F. « The Confusing Identities Attributed to Stadacona and Hochelaga ». Revue d'études canadiennes. Vol. 32 (1997), p. 149-167.
PERRAULT, Claude. « La découverte de Montréal par Jacques Cartier ». Revue d'histoire de l'Amérique française. Vol. 20, no 2 (1966), p. 236-261.
TREMBLAY, Roland. « Regards sur le passé : réflexions sur l’identité des habitants de la vallée du Saint-Laurent au XVIe siècle ». Recherches amérindiennes au Québec. Vol. 29, no 1 (1999), p. 41-52.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Fondation de Charlesbourg-Royal

La fondation de Charlesbourg-Royal, la première colonie française en Amérique, est un événement majeur de l'histoire du Québec, qui s'inscrit dans le contexte d'expansion des royaumes européens en Amérique pendant le XVIe siècle.
Après les expéditions de Giovanni da Verrazzano en 1524 et de Jacques Cartier en 1534 et en 1535-1536, le roi François Ier décide en 1538 de fonder un établissement français en Amérique afin d'exploiter les ressources du continent et de découvrir un passage maritime vers l'Asie.
Le 15 janvier 1541, François Ier confie cette tâche à Jean-François de La Rocque de Roberval, lieutenant-général du Canada. Le navigateur Jacques Cartier, qui a déjà remonté le fleuve Saint-Laurent et hiverné près de Stadaconé (Québec), est fait maître-pilote de l'expédition. Cette entreprise de grande envergure est financée en partie par des capitaux privés.
Au cours de l'hiver 1541, La Rocque de Roberval et Cartier assemblent leurs flottes respectives, règlent les détails logistiques de l'opération et recrutent les membres de l'expédition. Parmi ces derniers se trouvent des artisans, des militaires, des paysans et des prisonniers, notamment pour réaliser les travaux les plus difficiles. En mai, les navires de Cartier sont prêts à appareiller. Retardé dans ses préparatifs, La Rocque de Roberval lui donne la permission de partir vers l'Amérique avec cinq vaisseaux et plus de 300 personnes.
Le 23 août 1541, Jacques Cartier arrive à Stadaconé et fixe l'établissement français le long du fleuve Saint-Laurent, à l'embouchure de la rivière du Cap Rouge. Il le nomme Charlesbourg-Royal. Il fait construire deux forts, un en haut du cap et l'autre en bas. Au début du mois de septembre, il dirige une expédition jusqu'aux rapides de Lachine, à la recherche du passage convoité. Durant ce temps, les relations entre les nouveaux arrivants et les Autochtones de Stadaconé semblent s'envenimer. Au printemps 1542, après un dur hiver pendant lequel plusieurs colons décèdent, Cartier décide de regagner la France.
Le 16 avril 1542, La Rocque de Roberval part enfin pour l'Amérique avec trois navires et un contingent de quelque 200 personnes comprenant une centaine de soldats, des artisans, des paysans et une dizaine de femmes. À la mi-juin, il croise Cartier dans le havre de Saint Jean, à Terre-Neuve, qui lui annonce qu'il a achevé les forts, planté du blé et trouvé des métaux précieux. La Rocque de Roberval demande à Cartier de retourner avec lui à Charlesbourg-Royal, mais Cartier préfère reprendre la direction de la métropole.
La Rocque de Roberval arrive à Charlesbourg-Royal à la fin du mois de juillet 1542. Il améliore les installations laissées par Cartier et renomme le lieu France-Roy. Il remonte le fleuve Saint-Laurent jusqu'aux rapides de Lachine, à la recherche de pierres et de métaux précieux. Au cours de l'hiver, il doit faire face à la famine, au froid, à la maladie. Il met fin à son projet de colonisation en 1543, après que le roi lui donne l'ordre de rentrer en France, alors menacée par la coalition anglo-espagnole.
L'établissement de Charlesbourg-Royal, renommé France-Roy, a eu une brève existence et n'a pas donné lieu aux découvertes anticipées. Le projet a également constitué un revers financier pour ses protagonistes. Néanmoins, cet événement a démontré que l'implantation d'une colonie permanente le long du fleuve Saint-Laurent était possible, ce que Samuel de Champlain a réalisé en fondant Québec en 1608. Pour les peuples autochtones de la vallée du Saint-Laurent, la fondation de Charlesbourg-Royal a plutôt été annonciatrice de nombreux bouleversements.
Cet événement historique est désigné pour les motifs suivants:
La fondation de Charlesbourg-Royal est un événement majeur de l'histoire du Québec, qui s'inscrit dans le contexte d'expansion des royaumes européens en Amérique au cours du XVIe siècle. C'est le 15 janvier 1541 que François Ier confie à Jean-François de La Rocque de Roberval, lieutenant-général du Canada, la mission de fonder un établissement français en Amérique du Nord pour tirer profit des ressources du continent et découvrir un passage maritime vers l'Asie.
Le 23 août 1541, Jacques Cartier, maître-pilote de l'expédition, et son groupe composé d'environ 300 personnes, fondent l'établissement de Charlesbourg-Royal, à proximité du village autochtone de Stadaconé. Le navigateur et son groupe regagnent toutefois la France dès l'année suivante.
Retardé dans ses préparatifs, La Rocque de Roberval arrive à Charlesbourg-Royal avec quelque 200 personnes à la fin du mois de juillet 1542. Il renomme le lieu France-Roy. En juillet 1543, en raison de la reprise des guerres en Europe, La Rocque de Roberval et son contingent doivent retourner en France, ce qui met fin à la première tentative de colonisation française en Amérique du Nord.
L'établissement français de Charlesbourg-Royal, renommé France-Roy, a eu une brève existence et n'a pas donné lieu aux découvertes espérées. Le projet a également constitué un revers financier pour ses protagonistes. Néanmoins, cet événement a démontré la faisabilité d'implanter une colonie permanente le long du fleuve du Saint-Laurent, ce que Samuel de Champlain a réalisé en fondant Québec en 1608. Pour les peuples autochtones de la vallée du Saint-Laurent, la fondation de Charlesbourg-Royal a plutôt été annonciatrice de nombreux bouleversements.
ALLAIRE, Bernard. La rumeur dorée : Roberval et l'Amérique. Montréal, Les Éditions La Presse, 2013. 159 p.
Assemblée nationale du Québec. Par ici la démocratie. Ligne du temps [En Ligne]. http://paricilademocratie.com/
BRAUDEL, Fernand, dir. Le monde de Jacques Cartier. Montréal, Libre-expression, 1984. 316 p.
CARTIER, Jacques. Voyages de découvertes entre les années 1534 et 1542. Textes et documents retrouvés. Paris, Antropos, 1968. 206 p.
HAVARD, Gilles et Cécile VIDAL. Histoire de l'Amérique française. Paris, Flammarion, 2005. 863 p.
LAVERDIÈRE, Camille. Le Sieur de Roberval. Chicoutimi, Les Éditions JCL inc, 2005. 158 p.
LITALIEN, Raymonde. Les explorateurs de l'Amérique du Nord, 1492-1795. Québec, Septentrion, 1993. 261 p.
TRUDEL, Marcel. Histoire de la Nouvelle-France. Tome 1 : Les vaines tentatives 1524-1603. Montréal, Fides, 1963. 307 p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Établissement d’un poste de traite à Tadoussac

En 1600, Pierre Chauvin de Tonnetuit, capitaine dans la marine et l’armée françaises, établit un poste de traite à l’emplacement actuel de Tadoussac. Il est accompagné, entre autres, de François Gravé du Pont et de Pierre Dugua de Monts. Le mot « Tadoussac » provient de l’innu-aimun, mais son origine et sa signification ont fait l’objet de diverses interprétations au fil du temps. En 1600, l’emplacement est déjà un lieu de commerce important pour les Autochtones, particulièrement les Innus. Le réseau de Tadoussac s’étend vers le nord-ouest le long de la rivière Saguenay et jusqu’à la baie James, à travers la forêt boréale.
Au XVIe siècle, des pêcheurs portugais, espagnols et français fréquentent les côtes de Terre-Neuve et l’embouchure du Saint-Laurent, établissant des contacts avec les Autochtones. Après les voyages de Jacques Cartier, qui explore le fleuve Saint-Laurent entre 1534 et 1541, les Français développent un intérêt croissant pour le commerce des fourrures. Les Hollandais implantent des comptoirs de commerce des fourrures en Amérique du Nord, notamment à Albany et sur l’île de Manhattan. L’emplacement de ces établissements reflète les stratégies d’accès aux réseaux commerciaux s’étendant à l’intérieur du continent.
C’est dans ce contexte qu’en 1599, Pierre Chauvin de Tonnetuit, ayant gagné la faveur du roi Henri IV pour son soutien contre la Ligue catholique durant les guerres de religion, obtient le monopole de la traite des fourrures en Nouvelle-France. Ce privilège suscite des tensions avec le vice-roi et lieutenant général de la Nouvelle-France, Troilus de La Roche de Mesgouez, qui avait reçu en 1598 une commission similaire lui accordant le monopole de la traite. À la suite des protestations de La Roche, en janvier 1600, le roi limite le monopole de Chauvin à l’embouchure du Saint-Laurent et en fait un lieutenant du vice-roi, ce qui n’empêche pas Chauvin d’organiser rapidement un voyage au Canada.
Durant l’été 1600, Chauvin fait construire à Tadoussac une maison (« habitation ») entourée d’une palissade et d’un petit fossé. Cette installation est acceptée par les Innus établis à cet endroit, ceux-ci souhaitant obtenir l’aide des Français pour lutter contre leurs ennemis. En plus de contrôler les principaux postes de traite des pelleteries, le monopole de Chauvin prévoit l’établissement d’une colonie. Tadoussac est cependant peu propice au peuplement en raison de son terrain accidenté, de la pauvreté de son sol et de ses hivers rigoureux. À l’automne, Chauvin retourne en France et 16 hommes demeurent sur place. Durant l’hiver 1600-1601, la plupart meurent en raison du froid, du manque de vivres et du scorbut. Seulement cinq d’entre eux survivent grâce aux Autochtones qui les ont accueillis et nourris. En 1601, les survivants regagnent la France sur un navire envoyé par Chauvin et l’habitation est abandonnée.
Chauvin ne réussit pas à établir de colonie et les protestations des marchands rivaux continuent de se faire entendre. En conséquence, le monopole du commerce est étendu à d’autres commerçants de Rouen et de Saint-Malo. Chauvin meurt en 1603 avant le voyage suivant.
Malgré l’échec de la colonisation, la création du poste de traite de Tadoussac en 1600 marque le début de la présence hivernale française dans la région et l’amorce des alliances entre les Français et les Innus. En 1603, c’est à Tadoussac, lors d’une « tabagie » organisée par le chef innu Anadabijou que les Français nouent une alliance durable avec les Innus et leurs alliés, les Algonquins et les Etchemins. La « Grande alliance de 1603 » permet aux Français de s’intégrer à un vaste réseau d’échanges qui s’étend jusqu’aux Grands Lacs, pavant la voie à la création d’établissements permanents sur le continent.
Assemblée nationale du Québec. Par ici la démocratie. Ligne du temps [En Ligne]. http://paricilademocratie.com/
MATHIEU, Jacques. La Nouvelle-France: les Français en Amérique du Nord, XVIe-XVIIIe siècle. Québec, Presses de l’Université Laval, 2001. 271 p.
MORLEY, William F. E. « Chauvin de Tonnetuit, Pierre de ». Université Laval/University of Toronto. Dictionnaire biographique du Canada [En ligne]. http://www.biographi.ca/009004-119.01-f.php?&id_nbr=125&interval=15&&PHPSESSID=6j2l49f22u73kdbapdcv3morr0
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
ST-HILAIRE, Marc. « Tadoussac ». Historica Canada. L’encyclopédie canadienne [En ligne]. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/tadoussac
THIERRY, Éric. Samuel de Champlain. Aux origines de l’Amérique française. Québec, Septentrion, 2024. 774 p.
TRUDEL, Marcel. « Gravé Du Pont, François ». Université Laval/University of Toronto. Dictionnaire biographique du Canada [En ligne]. http://www.biographi.ca/
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Fondation de Québec

Le 3 juillet 1608, l'explorateur Samuel de Champlain débarque à Québec en compagnie d'une trentaine d'ouvriers et y fonde le premier établissement français permanent en Amérique. D'abord un comptoir de commerce, Québec est appelée à devenir le centre administratif et politique de la Nouvelle-France.
En 1535, lors de son deuxième voyage, Jacques Cartier est le premier Européen à passer l'hiver sur le site de Québec. Fréquenté depuis près de 10 000 ans par des peuples autochtones, l'endroit est occupé par le village iroquoien de Stadaconé. Six ans plus tard, Cartier est de retour à titre de guide de Jean-François de La Rocque de Roberval. Mandatés par le roi François 1er, les deux hommes tentent d'établir une colonie permanente à l'embouchure de la rivière du Cap Rouge. Ce projet colonial, baptisé d'abord Charlesbourg-Royal, puis France-Roy, est définitivement abandonné en 1543 après que la guerre franco-espagnole force Roberval à rentrer en France.
L'idée d'implanter une colonie permanente sur le site de Québec refait surface au début du XVIIe siècle. Le commerce des fourrures ayant pris de l'importance, il devient de plus en plus intéressant d'installer un poste de traite au bord du fleuve Saint-Laurent, loin de la concurrence et près de zones riches en fourrures. En 1608, Pierre Du Gua de Monts, détenteur du monopole de la traite en Nouvelle-France, commandite l'expédition de Champlain et le charge de fonder un comptoir permanent à Québec.
Le choix de s'établir à Québec n'est pas un hasard. De 1603 à 1608, Champlain est à la recherche du lieu idéal pour fonder un établissement le long de la côte atlantique et autour du Saint-Laurent. Au terme de cette prospection, après qu'il ait considéré plusieurs sites, notamment celui de Trois-Rivières, Champlain conclut que Québec est le meilleur endroit. Il le choisit en raison de son emplacement stratégique à proximité des voies commerciales de la traite des fourrures, de son climat relativement tempéré, de la fertilité de ses sols et de l'avantage militaire que confère le promontoire constitué par le Cap Diamant.
Durant les années qui suivent la construction de la première habitation, Québec n'est guère davantage qu'un comptoir de commerce fortifié dépendant de l'approvisionnement transatlantique. Douze ans après sa fondation, seulement une soixantaine de colons y vivent. En 1629, lorsque les frères Kirke amènent leur flotte devant Québec pour l'assiéger, ils n'éprouvent aucune difficulté à obtenir sa reddition.
En 1632, au moment où la colonie est restituée à la France, un travail de reconstruction et d'édification est entrepris sous l'égide de la Compagnie des Cent Associés et, à compter de 1636, du gouverneur Charles Huault de Montmagny. Ce dernier planifie le développement de Québec, notamment par l'ouverture des premières rues et l'alignement des bâtiments. Pendant cette période, au moins 600 immigrants s'installent en Nouvelle-France, dont des jésuites qui fondent un collège dans la haute ville de Québec. Des difficultés minent toutefois les efforts de colonisation. La compagnie éprouve des problèmes financiers intermittents attribuables, entre autres, à l'inconstance et à l'incertitude de l'approvisionnement en pelleteries. À partir de 1642, la colonie est fréquemment confrontée à l'hostilité des Iroquois, dont les incursions menacent la survie de l'établissement.
La prise en main de la colonie par le roi en 1663, qui en fait une province de son royaume, établit Québec comme siège de son pouvoir en Nouvelle-France. Aux yeux de Marie Guyart, c'est à compter de cette date que le comptoir de commerce fondé par Champlain devient véritablement une ville. Toutefois, la petite bourgade de 550 habitants prendra son véritable essor au cours des décennies suivantes, pour enfin devenir la clef de voûte du système colonial français en Amérique du Nord.
Cet événement historique est désigné pour les motifs suivants:
La fondation de Québec est l'acte de naissance de la ville de Québec, de la Nouvelle-France et du peuplement français en Amérique. Le 3 juillet 1608, Samuel de Champlain et son groupe, commandités par Pierre Du Gua de Monts, détenteur du monopole de la traite des fourrures, fondent le comptoir de Québec, où ils construisent une habitation fortifiée. Champlain était à la recherche du lieu idéal pour fonder un établissement le long de la côte atlantique et autour du Saint-Laurent depuis 1603. Il choisit Québec en raison notamment de son emplacement stratégique à proximité des voies commerciales de la traite des fourrures et de l'avantage militaire que confère le promontoire constitué par le Cap Diamant. Ce premier établissement français permanent en Amérique, œuvre de Champlain, deviendra la capitale de la Nouvelle-France et, plus tard, celle du Québec.
Assemblée nationale du Québec. Par ici la démocratie. Ligne du temps [En Ligne]. http://paricilademocratie.com/
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La ligne du temps du Québec [En Ligne]. https://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
BLAIS, Christian, Gilles GALLICHAN, Frédéric LEMIEUX et Jocelyn SAINT-PIERRE. Québec: quatre siècles d'une capitale. Québec, Assemblée nationale du Québec - Les Publications du Québec, 2008. 692 p.
CHOUINARD, François-Xavier. La ville de Québec. Histoire municipale. Vol. I. Cahiers d'histoire, 15. Québec, La Société historique de Québec, 1963. 116 p.
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Secrétariat aux relations canadiennes. Le Québec au fil du temps [En Ligne]. https://www.sqrc.gouv.qc.ca/relations-canadiennes/federalisme/quebec-fil-du-temps.asp
GRENON, Jean-Yves. Pierre Dugua de Mons, cofondateur de Québec (1608) et fondateur de l'Acadie (1604-1605). Québec, Société historique de Québec, 1999. 31 p.
HARE, John, Marc LAFRANCE et David-Thiery RUDDEL. Histoire de la ville de Québec, 1608-1871. Montréal, Boréal, 1987. 399 p.
MACBEATH, George. « Du Gua de Monts, Pierre ». Université Laval/University of Toronto. Dictionnaire biographique du Canada [En ligne]. http://www.biographi.ca
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
TRUDEL, Marcel. « Champlain, Samuel de ». Université Laval/University of Toronto. Dictionnaire biographique du Canada [En ligne]. http://www.biographi.ca/
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Arrivée des Récollets en Nouvelle-France

Constitués en ordre à la fin du XVIe siècle, les Récollets proviennent d'une branche réformée de l'ordre des Franciscains se réclamant de saint François d'Assise. En 1615, les premiers missionnaires récollets arrivent en Nouvelle-France. Les Récollets constituent ainsi la toute première communauté religieuse à s'installer sur le territoire québécois.
L'histoire des Récollets en Nouvelle-France débute avec le passage de Samuel de Champlain en France, de 1613 à 1615. Champlain est alors en quête de religieux pour l'accompagner à Québec. Suivant la recommandation de Louis Houël, sieur du Petit-Pré, secrétaire du roi et contrôleur général des salines de Brouage, il porte son attention sur les Récollets. Les pères de Brouage sont les premiers à être approchés, mais ce sont finalement les Récollets de la province de Saint-Denis, à Paris, qui font la traversée de l'Atlantique.
En compagnie de Champlain, les pères Denis Jamet (commissaire provincial), Jean Dolbeau et Joseph Le Caron, ainsi que le frère Pacifique Duplessis, quittent Honfleur le 24 avril 1615 et débarquent à Tadoussac le 25 mai. Arrivés à Québec le 8 juin, ils entreprennent la construction d'une première chapelle près de l'Habitation. Après avoir remonté le fleuve Saint-Laurent, les pères Jamet et Le Caron célèbrent la première messe sur l'île de Montréal, le 24 juin 1615. Le lendemain, le père Jean Dolbeau effectue la même célébration à Québec.
À compter de 1615, les Récollets assurent les soins spirituels de la population de Québec et se consacrent à l'instruction et à l'évangélisation des Autochtones. Ils partent notamment à la rencontre des Montagnais de la rive nord du Saint-Laurent et des Hurons de la région des Grands Lacs. Ils établissent leur couvent en 1620 au bord de la rivière Sainte-Croix, à laquelle ils donnent le nom de Saint-Charles, probablement en l'honneur de Charles Borromée. Le couvent doit notamment servir de séminaire pour l'éducation de jeunes autochtones. En 1625, l'arrivée des Jésuites à Québec met fin à dix années d'exclusivité missionnaire pour les Récollets. Quatre ans plus tard, à la suite de la prise de Québec par les frères Kirke, les Récollets retournent en France avec Champlain et la majorité des colons.
Les Récollets reviennent en Nouvelle-France en 1670. Ils érigent un monastère à Montréal et reprennent également possession de leur domaine à Québec, où ils font construire une église et un nouveau monastère. Ils fondent également une mission au poste de pêche de Percé en 1673. En 1692, les Récollets sont nommés aumôniers du gouverneur et des soldats en Nouvelle-France. La même année, Mgr de Saint-Vallier, évêque de Québec, fait l'acquisition du couvent Saint-Charles pour y établir l'hôpital général de Québec. Les Récollets s'installent alors à la haute ville. Ils prennent aussi la charge de certaines paroisses.
En 1763, la Nouvelle-France est cédée à l'Angleterre. À ce moment, la majorité des Récollets sont d'origine canadienne. Les autorités britanniques interdisent alors à certaines communautés religieuses, dont les Récollets, de recruter des novices. Faute de relève, la communauté disparaît progressivement de la colonie avec la mort du père Louis Demers en 1813. Dès lors, les seuls récollets encore vivants au Canada sont sécularisés. Le dernier d'entre eux, Marc Coutant, meurt en 1849.
Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que d'autres religieux de la famille franciscaine reviennent s'installer sur le territoire québécois. Les Franciscains s'établissent à Trois-Rivières en 1888, à Montréal vers 1890, puis à Québec en 1900. Ils sont toujours présents sur le territoire québécois.
Cet événement historique est désigné pour les motifs suivants:
Les Récollets font partie des communautés religieuses fondatrices de la Nouvelle-France. Constitués en ordre à la fin du XVIe siècle, les Récollets proviennent d'une branche réformée de l'ordre des Franciscains. Recrutés en France par Samuel de Champlain, ils constituent la première communauté religieuse à s'établir en Nouvelle-France, au printemps 1615. Ils vont assurer le ministère spirituel et se consacrer à l'instruction et à l'évangélisation des Autochtones. Absents de la colonie à compter de 1629, ils reviennent en 1670. À la suite de la Conquête britannique, les Récollets sont privés de recrutement et la communauté disparaît en 1813. Les religieux de la famille franciscaine, qui ont été les premiers missionnaires et les premiers instituteurs en Nouvelle-France, sont de retour sur le territoire québécois à la fin du XIXe siècle.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La ligne du temps du Québec [En Ligne]. https://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
GALLAND, Caroline. Pour la gloire de Dieu et du roi : les récollets en Nouvelle-France aux XVIIe et XVIIIe siècles. Paris, Cerf, 2012. 528 p.
HAMELIN, Jean, dir. Les franciscains au Canada: 1890-1990. Sillery, Septentrion, 1990. 438 p.
JOUVE, Odoric. Dictionnaire biographique des Récollets - missionnaires en Nouvelle-France. Montréal, Bellarmin, 1996. 903 p.
KAUPP, Dorothée. « Nos premiers missionnaires. L'histoire des récollets dans les ouvrages franciscains au Canada, XIXe-XXe siècles ». Études d'histoire religieuse. Vol. 75 (2009), p. 25-38.
LAPERRIÈRE, Guy. Histoire des communautés religieuses au Québec. Montréal, Vlb éditeur, 2013. 329 p.
LAVALLÉE, Madeleine et Pierre VALCOUR. Les communautés religieuses au Québec. Québec, Septentrion, 2009. 390 p.
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
TRUDEL, Marcel. Le comptoir 1604-1627. Montréal, Fides, 1966. 554 p.
TRUDEL, Marcel. « Les Récollets sous le régime militaire ». Revue d'histoire de l'Amérique française. Vol. 10, no 2 (1956), p. 191-221.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Présentation d’un projet de colonie permanente à Louis XIII par Champlain

En 1618, Samuel de Champlain formule un ambitieux projet pour faire du comptoir qu’est alors Québec une colonie prospère, nommée Ludovica en l’honneur du roi de France Louis XIII.
C’est dans deux mémoires que les ambitions de Champlain sont présentées; le premier à la Chambre de commerce de Paris, orienté vers les perspectives commerciales, et le second au roi. Ces documents s’inscrivent dans un contexte de ralentissement du développement de la colonie. Malgré l’arrivée récente de récollets en 1615 et de la famille Hébert en 1617, les activités du comptoir et de sa population sont entièrement orientées vers le commerce. La prédominance de cette activité s’explique par le fait que la colonie est administrée par une compagnie commerciale, la Compagnie de Rouen et de Saint-Malo, qui poursuit un objectif de rentabilité.
Le mémoire présenté au roi expose les premières étapes d’un projet d’occupation du territoire qui doit, à terme, s’étendre à l’ensemble de la vallée du Saint-Laurent et assurer l’autonomie de l’entreprise. Des forts sont prévus à Pointe-Lévy, Tadoussac et sur le Cap-Diamant afin de contrer les ambitions territoriales des Anglais et Néerlandais dans la région. Il prévoit aussi convertir les comptoirs de Québec et de Tadoussac en ville, en plus d’évoquer le peuplement des territoires des villes de Trois-Rivières et Montréal. Pour y arriver, il demande le passage de 300 familles en Nouvelle-France. Peuplée et bien défendue, la colonie projetée serait aussi prospère puisque Champlain prévoit des activités commerciales variées et fructueuses pour complémenter le commerce des fourrures, presque unique source de revenus au moment où il élabore le mémoire. Enfin, tout cela offrirait des ressources suffisantes aux ¿uvres missionnaires afin d’appuyer leur entreprise de conversion des peuples autochtones. Enfin, la colonie serait un passage obligé du commerce avec l’Asie puisque Champlain compte toujours trouver une voie vers ce continent très convoité. Ce projet ambitieux a comme principal objectif d’augmenter la participation du pouvoir royal et des marchands dans l’entreprise menée par Champlain.
Intrigués, le roi et la Chambre de commerce donnent à Champlain et son projet leur approbation. Néanmoins, peu de mesures concrètes accompagnent l’assentiment de ce programme qui reste dans l’essentiel lettre morte. Il faut attendre jusqu’en 1663, avec l’intégration de la colonie dans le gouvernement royal, pour voir se concrétiser les orientations élaborées par Champlain.
D’AVIGNON, Mathieu. Champlain et les fondateurs oubliés: les figures du père et le mythe de la fondation. Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2008. 540 p.
DROUIN, Sophie. « Le poste et la forteresse ». COURVILLE, Serge et Robert GARON. Québec, ville et capitale. Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 2001, p. 46-49.
FISCHER, David Hackett. Le rêve de Champlain. Montréal, Boréal, 2011. 998 p.
HAVARD, Gilles et Cécile VIDAL. Histoire de l’Amérique française. Paris, Flammarion, 2005. 863 p.
LITALIEN, Raymonde et Denis VAUGEOIS. Champlain : la naissance de l’Amérique française. Québec/Paris, Les éditions du Septentrion/Nouveau Monde éditions, 2004. 397 p.
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
SÉGUIN, Maurice K. Samuel de Champlain : l’entrepreneur et le rêveur. Québec, Septentrion, 2008. 380 p.
TRUDEL, Marcel. « Champlain, Samuel de ». Université Laval/University of Toronto. Dictionnaire biographique du Canada [En ligne]. http://www.biographi.ca/
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Prise de Québec par les frères Kirke

La prise de Québec par les frères Kirke est un épisode important des débuts de la colonie de la Nouvelle-France. Il s'agit du premier siège dirigé contre la capitale de la Nouvelle-France, précédant ceux de William Phips (1690), la tentative de Hovenden Walker (1711) et celui de James Wolfe (1759).
En 1627, alors que l'Angleterre s'allie avec les protestants de La Rochelle dans une guerre contre la France, des marchands anglais et calvinistes de Dieppe forment une compagnie afin de commercer et d'établir des colons en Nouvelle-France. Du nombre se trouvent les frères David, Lewis, Thomas, John et James Kirke. Corsaires, ils sont munis de lettres de marque du roi anglais Charles 1er pour s'emparer du Canada et de l'Acadie. Partis en mars 1628 à bord de trois navires, ils prennent possession de l'établissement de pêche de Miscou (Miscou-Centre, Nouveau-Brunswick) et du poste de traite de Tadoussac, avant d'incendier des bâtiments à Cap-Tourmente. Le 10 juillet, des émissaires livrent un message à Samuel de Champlain le sommant de rendre l'habitation de Québec. Champlain refuse et les frères Kirke entreprennent un blocus du Saint-Laurent. Le 18 juillet, quatre vaisseaux chargés de ravitaillement et de colons affrétés par la Compagnie des Cent Associés sont pris par les corsaires à la suite d'un affrontement.
Les vainqueurs repartent en Angleterre en 1628. Leur société fusionne avec celle de William Alexander pour fonder la Company of Adventurers to Canada. C'est au nom de cette entreprise que les frères Kirke font voile vers Tadoussac en avril 1629 avec une flotte de six navires. David y établit une base d'opérations, puis envoie à Québec trois vaisseaux et 150 hommes guidés par un déserteur français, Jacques Michel. Le 19 juillet, faute de vivres et de munitions, Champlain livre la colonie à Thomas et Lewis Kirke. Il obtient toutefois que les colons conservent leurs possessions et leurs armes. Vingt et un d'entre eux demeurent à Québec alors que les autres s'embarquent sur des navires anglais avant d'être éventuellement ramenés en France.
En route vers Tadoussac, Champlain et Thomas Kirke croisent les navires de la Compagnie des Cent Associés, commandée par Émery de Caën, venus approvisionner la colonie. Ce dernier est défait après un court engagement. À Tadoussac, Champlain rencontre David Kirke puis, le 14 septembre, les deux hommes voguent vers l'Angleterre. Une fois arrivée, Champlain s'entretient avec l'ambassadeur de France à Londres et cherche à récupérer la colonie. La signature du traité de Suse le 24 avril 1629, qui met un terme aux hostilités franco-anglaises, rend légitimes ses revendications.
De 1629 à 1632, des négociations entre la France et l'Angleterre ont lieu au sujet de la rétrocession du Canada et de l'Acadie. Charles 1er retarde les pourparlers notamment parce que Louis XIII, roi de France et également son beau-frère, ne s'est pas acquitté de la dot de sa femme. La question de la souveraineté sur l'Acadie est très litigieuse et fait trainer le règlement de la paix. Avec la signature du traité de Saint-Germain-en-Laye le 29 mars 1632 le cardinal de Richelieu obtient la restitution des colonies françaises d'Amérique du Nord.
Pendant trois ans, Thomas et Lewis Kirke demeurent à Québec avec environ 90 autres Anglais. Lors du premier hiver, 14 d'entre eux meurent, victimes d'épidémies et de la disette. Le 29 juin 1632, Caën arrive à Québec et obtient la rétrocession de la colonie. Il constate que plusieurs bâtiments sont endommagés, dont l'Habitation. Les Kirke remettent le fort le 13 juillet et repartent à bord de leurs navires. Champlain est quant à lui de retour le 22 mai 1633 avec trois vaisseaux et 200 colons.
La prise de Québec par les frères Kirke accule la jeune Compagnie des Cent Associées au bord de la faillite et ralentit le peuplement de la Nouvelle-France. Cet événement conscientise les Français de la nécessité d'assurer une présence accrue sur ce territoire.
ALLAIRE, Bernard. « L'occupation de Québec par les frères Kirke ». LITALIEN, Raymonde et Denis VAUGEOIS. Champlain : la naissance de l'Amérique française. Québec/Paris, Les éditions du Septentrion/Nouveau Monde éditions, 2004, p. 245-257.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La ligne du temps du Québec [En Ligne]. https://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
BLAIS, Christian, Gilles GALLICHAN, Frédéric LEMIEUX et Jocelyn SAINT-PIERRE. Québec: quatre siècles d'une capitale. Québec, Assemblée nationale du Québec - Les Publications du Québec, 2008. 692 p.
DE WAELE, Michel. « Honneur national et destin colonial: le sort de l'Amérique française, 1627-1632 ». Histoire, économie et société. Vol. 35, no 49 (2016), p. 68-84.
HARE, John, Marc LAFRANCE et David-Thiery RUDDEL. Histoire de la ville de Québec, 1608-1871. Montréal, Boréal, 1987. 399 p.
HAVARD, Gilles et Cécile VIDAL. Histoire de l'Amérique française. Paris, Flammarion, 2005. 863 p.
LACOURSIÈRE, Jacques, Jean PROVENCHER et Denis VAUGEOIS. Canada-Québec: synthèse historique, 1534-2000. Québec, Éditions du Septentrion, 2001. 591 p.
LACOURSIÈRE, Jacques. Histoire populaire du Québec. Vol. 1: Des origines à 1791. Québec, Septentrion, 1995. 480 p.
LAHAISE, Robert. Nouvelle-France English Colonies : l'impossible coexistence, 1606-1713. Québec, Septentrion, 2006. 295 p.
MOIR, John S. « Kirke, sir David ». Université Laval/University of Toronto. Dictionnaire biographique du Canada [En ligne]. http://www.biographi.ca
MOIR, John S. « Kirke, sir Lewis ». Université Laval/University of Toronto. Dictionnaire biographique du Canada [En ligne]. http://www.biographi.ca
MOIR, John S. « Kirke, Thomas ». Université Laval/University of Toronto. Dictionnaire biographique du Canada [En ligne]. http://www.biographi.ca
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Fondation de Trois-Rivières

En 1634, Samuel de Champlain commande la construction d'un poste de traite fortifié à Trois-Rivières. Le 4 juillet de cette année, un dénommé Laviolette y débarque et fonde la première habitation française en ce lieu.
Bien avant l'arrivée des Européens, le site de Trois-Rivières est déjà fréquenté par divers peuples amérindiens qui y convergent pour y effectuer des échanges commerciaux. Jacques Cartier s'y rend lors de son deuxième voyage, le 7 octobre 1535, et plante une croix sur l'île Saint-Quentin, à l'embouchure de la rivière Saint-Maurice. La configuration des îles à cet endroit inspire le toponyme évoqué pour la première fois en 1599 par François Gravé du Pont, un officier de la marine française à la recherche d'un lieu pour installer un poste de traite. Ce nom se retrouve ensuite sur la carte de la Nouvelle-France dessinée par Guillaume Levasseur en 1601.
En 1603, avant la fondation de Québec, Samuel de Champlain est en quête d'un emplacement où établir une colonie. Il note que Trois-Rivières est un endroit idéal d'implantation, notamment en raison de son importance dans la traite des fourrures. Au début du XVIIe siècle, les Algonquins y érigent un village palissadé, mais celui-ci est vraisemblablement rasé par des attaques iroquoises. Les Français fréquentent le lieu annuellement à partir de 1610, pour prendre part au trafic estival des fourrures. Sept ans plus tard, le frère récollet Pacifique Duplessis y fixe une mission et enseigne aux Amérindiens dans une cabane.
En 1633, le chef montagnais Capitanal invite Champlain à s'établir de façon permanente à Trois-Rivières afin de renforcer leur alliance et pour sécuriser le site, menacé par les Iroquois. Champlain consent et lui répond : « Quand cette grande maison sera faite, alors nos garçons se marieront à vos filles, et nous ne serons plus qu'un peuple ». Cette même année, la Compagnie des Cent-Associés concède deux terres en seigneurie à Trois-Rivières, l'une à Jacques Hertel de La Fresnière et l'autre à Jean Godefroy de Lintot. Les Jésuites obtiennent quant à eux 600 arpents en février 1634.
Pour mettre sur pied et commander le nouveau poste, Champlain mandate Laviolette, probablement un capitaine de navire. Parti le 1er juillet 1634 de Québec avec un groupe d'artisans, de soldats, de colons et des pères jésuites Jean de Brébeuf et Antoine Daniel, Laviolette arrive à Trois-Rivières le 4 juillet. Commence alors l'érection d'une habitation sur un plateau surélevé, le Platon, qui offre une protection naturelle contre les ennemis provenant du fleuve. Cette première habitation comprend une maison et un magasin. Elle est entourée d'une palissade munie d'un ou deux bastions. Le 8 septembre, les jésuites Paul Le Jeune et Jacques Buteux se joignent au groupe. Ils fondent une mission permanente à Trois-Rivières, puis y font élever une chapelle. L'année suivante, un incendie détruit l'habitation qui est aussitôt reconstruite et agrandie.
À la suite de sa fondation, Trois-Rivières prospère d'année en année, surtout grâce aux rendez-vous annuels que se donnent les Amérindiens et les trafiquants de fourrures. La fondation de Montréal en 1642 et le déplacement du réseau d'échange des fourrures vers le sud, plus près du l'Iroquoisie et de l'Huronie, donnent cependant un dur coup au développement du poste. Jusqu'à la fin du Régime français, la population trifluvienne stagne malgré les efforts déployés au XVIIIe siècle pour y développer l'industrie sidérurgique avec l'implantation des Forges du Saint-Maurice.
Motivée par la volonté d'occuper stratégiquement le territoire en amont de Québec après la prise de la colonie par les frères Kirke (1629-1632), la fondation de Trois-Rivières permet d'étendre l'influence de la France en Amérique et de consolider la principale activité économique de la Nouvelle-France.
Assemblée nationale du Québec. Par ici la démocratie. Ligne du temps [En Ligne]. http://paricilademocratie.com/
BEAUDOIN, René. Rencontrer Trois-Rivières : 375 ans d'histoire et de culture. Trois-Rivières, Éditions d'art Le Sabord, 2009. 225 p.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La ligne du temps du Québec [En Ligne]. https://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
DUGUAY, Françoise. « Chronique trifluvienne. L'histoire oubliée : les Trois-Rivières avant le bourg (1535-1635) ». Patrimoine trifluvien. No 20 (2013), p. 16-29.
FOURNIER, Rodolphe. Lieux et monuments historiques des Trois-Rivières et environs. Trois-Rivières, Éditions du Bien Public, 1978. s.p.
GENDRON, Yannick. L'énigme de Trois-Rivières. s.l. PERRO éditeur, 2019. 450 p.
HAMEL, Nathalie. Étude de caractérisation de l'arrondissement historique de Trois-Rivières. Québec, Commission des biens culturel, 2005. 73 p.
HARDY, René et Normand SÉGUIN. Histoire de la Mauricie. Les Régions du Québec, 17. Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 2004. 1137 p.
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
ROBERT, Daniel et Normand SÉGUIN. « Trois-Rivières, 1634-2009 : chronologie essentielle du patrimoine bâti ». Patrimoine trifluvien. No 19 (2009), p. 1-51.
SULTE, Benjamin. Histoire de la ville des Trois-Rivières et de ses environs. Montréal, Eusèbe Sénécal, 1870. 126 p.
TESSIER, Albert. Trois-Rivières, 1535-1935. Trois-Rivières, Éditeurs Le Nouvelliste Imprimeurs, 1935. 199 p.
VACHON, André. « Laviolette, M. ». Université Laval/University of Toronto. Dictionnaire biographique du Canada [En ligne]. http://www.biographi.ca/
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Arrivée des Augustines en Nouvelle-France

Les Augustines de la Miséricorde de Jésus arrivent en Nouvelle-France en 1639. Débarquées à Québec, elles y fondent le premier hôpital de la colonie. Au fil des siècles, leur présence s’étend dans une dizaine de villes, où elles prodiguent activement des soins de santé et des soins spirituels à la population jusque dans les années 1960.
En 1637, conseillée par le père Paul Le Jeune, supérieur des missions des Jésuites en Nouvelle-France, Marie de Vignerot, duchesse d’Aiguillon et nièce du cardinal Richelieu, projette de fonder un hôpital à Québec. Les Augustines de Dieppe, communauté hospitalière cloîtrée fondée au Moyen Âge et responsable de l’Hôtel-Dieu de cette ville, acceptent de prendre en charge le futur établissement. C’est ainsi que le 1er août 1639, les trois premières Augustines de la Miséricorde de Jésus, soit Marie Guenet de Saint-Ignace, première supérieure de la communauté, Anne Le Cointre de Saint-Bernard et Marie Forestier de Saint-Bonaventure, arrivent à Québec, en même temps que les Ursulines. Les Augustines constituent ainsi l’une des deux premières communautés religieuses féminines à s’être établies en Nouvelle-France.
Après un bref séjour à Québec, les Augustines déménagent à Sillery, en 1640, où elles fondent le premier hôpital en Amérique, au nord du Mexique. Situé près de la maison des Jésuites, cet établissement est destiné à l’évangélisation des Autochtones, que les hospitalières espèrent convertir par leur charité et leurs soins. Les guerres franco-iroquoises forcent toutefois les religieuses à retourner à l’intérieur des remparts de Québec en 1644. Deux ans plus tard, elles ouvrent l’Hôtel-Dieu. Recevant de moins en moins d’Autochtones, les Augustines soignent surtout des colons, des soldats et des matelots qui débarquent à Québec. La communauté se « canadianise » rapidement après 1650, date à laquelle la première postulante née au pays prononce ses vœux.
Les Augustines de la Miséricorde de Jésus commencent à essaimer sur de nouveaux territoires au tournant du XVIIe siècle. En 1692, Mgr Jean-Baptiste de La Croix de Chevrières de Saint-Vallier, évêque de Québec, fonde l’Hôpital général de Québec. L’année suivante, les Augustines prennent en charge cette institution dédiée au soin des pauvres, des personnes âgées et des invalides. Les Augustines de l’Hôpital général de Québec seront autonomes de celles de l’Hôtel-Dieu à partir de 1701. Avec le temps, d’autres monastères et hôpitaux sont fondés dans diverses régions, notamment à Chicoutimi (Saguenay) (1884), à Lévis (1892), à Gaspé (1926) et à Dolbeau (Dolbeau-Mistassini) (1955). Ces établissements favorisent le développement de plusieurs municipalités du Québec. Les Augustines mettent aussi en place des écoles d’infirmières.
L’arrivée des Augustines en Nouvelle-France est un moment décisif dans l’amélioration des conditions de vie des habitants de la colonie. C’est le point de départ de l’œuvre hospitalière et spirituelle de ces religieuses, au cours de laquelle elles ont jeté les bases de la dispensation et de l’administration des soins de santé au Québec, et joué un rôle important dans le développement de la pharmacologie.
Cet événement historique est désigné pour les motifs suivants:
Arrivées en Nouvelle-France le 1er août 1639, les Augustines de la Miséricorde de Jésus constituent l’une des deux premières communautés religieuses féminines à s’être établies dans la colonie. Elles fondent le premier hôpital en Amérique, au nord du Mexique, en 1640. Au fil des siècles, elles établissent, dans diverses régions, de nouveaux monastères et hôpitaux où elles prodiguent des soins de santé et des soins spirituels à la population. Elles mettent aussi en place des écoles d’infirmières et font progresser la pharmacologie. L’arrivée des Augustines constitue donc un moment décisif dans l’amélioration des conditions de vie des habitants de la Nouvelle France. C’est le point de départ de l’œuvre de cette communauté qui a contribué à la dispense et à l’administration des soins de santé au Québec.
BATES, Christina, Diane DODD et Nicole ROUSSEAU. Sans frontières: quatre siècles de soins infirmiers canadiens. Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa / Musée canadien des civilisations, 2005. 248 p.
BERTHOLD, Étienne. Une société en héritage - L’oeuvre des communautés religieuses pionnières à Québec. Québec, Publications du Québec, 2015. 119 p.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La ligne du temps du Québec [En Ligne]. https://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
CARON, Pierre et Jacques LACOURSIÈRE. Québec et sa région. Histoire vivante du Québec. Montréal, Éditions de l’Homme, 2008. 371 p.
CHABOT, Marie-Emmanuel. « Simon de Longpré, Marie-Catherine de, dite de Saint-Augustin ». Université Laval/University of Toronto. Dictionnaire biographique du Canada [En ligne]. http://www.biographi.ca/
Fédération des monastères des Augustines de la Miséricorde de Jésus. Augustines de la Miséricorde de Jésus [En Ligne]. http://www.augustines.org/
HARE, John, Marc LAFRANCE et David-Thiery RUDDEL. Histoire de la ville de Québec, 1608-1871. Montréal, Boréal, 1987. 399 p.
JEAN, Marguerite. Évolution des communautés religieuses de femmes au Canada de 1639 à nos jours. Histoire religieuse du Canada. Montréal, Fides, 1977. 324 p.
JOUVE, O. Le troisième centenaire de l’établissement de la foi au Canada. Québec, Imp. franciscaine missionnaire, 1917. s.p.
LESSARD, Rénald. Se soigner au Canada aux XVIIe et XVIIIe siècles. Hull, Musée canadien des civilisations, 1989. 160 p.
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
ROUSSEAU, François. La croix et le scalpel. Histoire des Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec (1639-1989). Vol. 1. Sillery, Septentrion, 1989. 454 p.
ROUSSEAU, François. La croix et le scalpel. Histoire des Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec (1639-1989). Vol. 2. Sillery, Septentrion, 1994. s.p.
SIMARD, Jean. « Monastère des Augustines de Québec ». s.a. Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française [En ligne]. http://www.ameriquefrancaise.org/
THÉRIAULT, Michel. « Augustines de la Miséricorde de Jésus ». Historica Canada. L’encyclopédie canadienne [En ligne]. http://www.thecanadianencyclopedia.com/
s.a. Troisième centenaire de l’Hôtel-Dieu de Québec, 1639-1939. Cahiers de l’Hôtel-Dieu de Québec, 1. Québec, Imprimerie Charrier et Dugal, 1947. 142 p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Fondation de Montréal

Le 17 mai 1642, un groupe dirigé par Paul de Chomedey de Maisonneuve et Jeanne Mance fonde l'établissement de Ville-Marie sur l'île de Montréal.
L'île de Montréal est connue des Européens depuis la première visite de Jacques Cartier en 1535. L'île est alors habitée par des Iroquoiens du Saint-Laurent, regroupés dans un établissement nommé Hochelaga. En 1603, Samuel de Champlain se rend à sur l'île de Montréal, désormais inhabitée. Il est le premier Européen à apprécier la position stratégique que l'île occupe au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais. En 1611, Champlain évalue la possibilité d'établir un poste de traite sur le site qui sera plus tard connu sous le nom de Pointe-à-Callières, mais le deuxième poste de la Nouvelle-France sera plutôt fondé à Trois-Rivières en 1634.
En 1639, Jérôme Le Royer de La Dauversière, un percepteur d'impôts engagé dans plusieurs oeuvres religieuses, l'abbé Jean-Jacques Olier, fondateur de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, et Pierre Chevrier, baron de Fancamp, créent à Paris la Société de Notre-Dame de Montréal. Cette organisation à vocation pieuse a comme objectif de fonder un établissement missionnaire sur l'île de Montréal où pourraient cohabiter des Français et des Amérindiens convertis au christianisme. Le 17 décembre 1640, la Société acquiert la seigneurie de l'Île-de-Montréal de la Compagnie des Cent-Associés. La Société choisit le jeune officier Paul de Chomedey de Maisonneuve pour gouverner l'établissement et recrute des engagés pour participer à l'expédition. Jeanne Mance se joint à l'équipée avec l'intention de fonder un hôpital à Montréal, projet pour lequel elle bénéficie du soutien financier d'Angélique Faure de Bullion, veuve du surintendant des Finances de France.
Le 9 mai 1641, environ 40 colons partent de La Rochelle, en France, à bord de trois navires pour fonder un nouvel établissement sur l'île de Montréal. Les premiers navires atteignent Québec au mois d'août, mais le dernier tarde à arriver. La fondation du nouvel établissement est ainsi reportée au printemps suivant. Maisonneuve doit faire face à l'opposition du gouverneur Charles Huault de Montmagny qui tente, sans succès, de le convaincre d'installer son groupe sur l'île d'Orléans.
Le 8 mai 1642, les Montréalistes quittent Québec et atteignent leur destination le 17 mai. Maisonneuve prend officiellement possession de l'île au nom de la Société de Notre-Dame de Montréal. C'est la fondation de Montréal. Le lendemain, une messe est célébrée et le nouvel établissement est dédié à la Vierge Marie et nommé Ville-Marie. Rapidement, les colons se consacrent à la construction d'un fort et d'une habitation à l'emplacement identifié par Champlain en 1611.
Au cours de la première décennie de son histoire, l'existence de Ville-Marie demeure précaire. La population de la colonie stagne, Maisonneuve ne réussissant pas à convaincre les Amérindiens alliés aux Français à s'établir à Ville-Marie. La colonie est aussi la cible d'attaques fréquentes par les Iroquois. Les Montréalistes vivent donc à proximité du fort et dépendent du ravitaillement annuel de la Société de Notre-Dame de Montréal.
La situation s'améliore au cours de la décennie de 1650. En 1663, la Nouvelle-France est intégrée dans le domaine royal et la seigneurie de l'Île-de-Montréal est remise par la Société de Notre-Dame de Montréal aux Sulpiciens. Ce changement de propriétaire met un terme à la période de la fondation de Montréal au cours de laquelle la société aura réussi établir, à ses frais, une colonie durable sur l'île de Montréal.
Pendant ces années, Maisonneuve et Jeanne Mance auront effectué quelques voyages en France pour rencontrer les membres de la société, recruter des colons et trouver de nouveaux appuis financiers. En 1665, Maisonneuve quitte Montréal définitivement pour rentrer à Paris où il décède en 1676. Quant à Jeanne Mance, elle décède à Montréal en 1673.
Cet événement historique est désigné pour les motifs suivants:
Le 17 mai 1642, un groupe dirigé par Paul de Chomedey de Maisonneuve et Jeanne Mance fonde l'établissement de Ville-Marie sur l'île de Montréal. Malgré l'opposition du gouverneur Charles Huault de Montmagny, ce groupe prend possession de l'île au nom de la Société de Notre-Dame de Montréal. Cette organisation à vocation pieuse est créée en 1639 par Jérôme Le Royer de La Dauversière, l'abbé Jean-Jacques Olier et Pierre Chevrier, baron de Fancamp. Elle a comme objectif de fonder un établissement missionnaire sur l'île de Montréal, où pourraient cohabiter des Français et des Amérindiens convertis au christianisme. Les colons s'installent sur la pointe à Callière, à la rencontre de la rivière Saint-Pierre et du fleuve Saint-Laurent, un emplacement identifié par Samuel de Champlain en 1611 et permettant l'échouage des embarcations avant le sault Saint-Louis. En raison de sa position stratégique, Ville-Marie, déjà fréquentée par les Amérindiens, devient rapidement la tête de pont du commerce des fourrures en Nouvelle-France. Au cours des siècles suivants, la colonie fondée par Paul de Chomedey de Maisonneuve et Jeanne Mance accédera au rang de ville cosmopolite et de métropole économique et culturelle du Québec et du Canada.
Assemblée nationale du Québec. Par ici la démocratie. Ligne du temps [En Ligne]. http://paricilademocratie.com/
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La ligne du temps du Québec [En Ligne]. https://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
Conseil du statut de la femme et Réseau québécois en études féministes. Ligne du temps de l'histoire des femmes au Québec [En Ligne]. http://www.histoiredesfemmes.quebec/
DAVELUY, Marie-Claire. « Chomedey de Maisonneuve, Paul de ». Université Laval/University of Toronto. Dictionnaire biographique du Canada [En ligne]. http://www.biographi.ca
DAVELUY, Marie-Claire. « Mance, Jeanne ». Université Laval/University of Toronto. Dictionnaire biographique du Canada [En ligne]. http://www.biographi.ca
LINTEAU, Paul-André. Brève histoire de Montréal. Montréal, Boréal, 1992. 165 p.
MARSH, James. « Maisonneuve et la fondation de Montréal ». Historica Canada. L'encyclopédie canadienne [En ligne]. http://www.thecanadianencyclopedia.com/
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Inauguration de l’Hôtel-Dieu de Montréal par Jeanne Mance

Le 18 mai 1642, Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal et première infirmière laïque au Canada, fonde un dispensaire qui deviendra l'Hôtel-Dieu.
La construction d'un hôpital à Montréal est l'objectif principal de Jeanne Mance quand elle se dirige vers la Nouvelle-France. Pour le réaliser, elle a obtenu l'appui financier d'une riche bienfaitrice, Angélique Faure de Bullion, veuve du surintendant des Finances de France.
L'établissement est logé temporairement dans l'enceinte fortifiée de Ville-Marie. En 1644, le gouverneur Paul Chomedey de Maisonneuve fait mettre en chantier un immeuble distinct à l'extérieur du fort, à l'angle des actuelles rues Saint-Paul et Saint-Sulpice. Les premières hospitalisations se font le 10 août 1645. L'hôpital ne dispose alors que de huit lits, six pour les hommes et deux pour les femmes. Très vite, il se retrouve saturé et une annexe est construite en 1653.
Jeanne Mance retourne en France en 1658 pour obtenir de l'aide. Elle réussit à recruter trois religieuses hospitalières de Saint-Joseph de La Flèche, une communauté fondée en 1636 par Jérôme Le Royer de La Dauversière, le principal promoteur du projet de Montréal. Judith Moreau de Brésoles, Catherine Macé et Marie Maillet arrivent à l'Hôtel-Dieu le 20 octobre 1659. Jeanne Mance meurt en 1673 et, cinq ans plus tard, les Sœurs hospitalières deviennent propriétaires et gestionnaires de l'hôpital.
L'immeuble de la rue Saint-Paul est détruit par le feu à trois reprises. Il est réduit à néant pour la première fois en février 1695, mais reconstruit avant la fin de l'année sur une plus grande superficie. En 1721 survient un autre incendie aussi violent. Le nouveau bâtiment n'est inauguré que le 11 novembre 1724. Enfin, la troisième conflagration éclate en octobre 1734. Le brasier décime les archives de l'hôpital dont les écrits de Jeanne Mance. Cette fois-ci, la reconstruction prend une décennie.
L'Hôtel-Dieu est le seul établissement de santé de l'île jusqu'à la fondation du Montreal General Hospital en 1820. Les besoins en soins changent au XIXe siècle en raison de la croissance démographique et des transformations du milieu urbain. De 1801 à 1861, la population montréalaise décuple et quitte le secteur du Vieux-Montréal pour les faubourgs. Cette nouvelle réalité entraîne le déménagement de l'hôpital à l'angle des actuelles avenues du Parc et des Pins, sur un terrain appartenant déjà aux Sœurs hospitalières. Les travaux du nouvel édifice débutent en 1859 et les premiers patients sont admis le 8 mai 1860. La direction médicale est confiée à l'École de médecine et de chirurgie de Montréal, ce qui fait de l'Hôtel-Dieu le premier hôpital francophone de recherche en Amérique du Nord.
Le rôle de l'Hôtel-Dieu comme pôle de recherche est confirmé au XXe siècle. Pour suivre la croissance démographique, l'hôpital est agrandi en deux phases. Des ailes sont ajoutées au bâtiment central entre 1885 et 1928 pour loger le personnel soignant, augmenter le nombre de lits et aménager des salles chirurgicales. La seconde étape, de 1942 à 1952, triple la superficie totale de l'hôpital par la construction des pavillons Le Royer, Jeanne-Mance et De Bullion. En 1973, une société publique créée par le gouvernement du Québec prend le relais des Sœurs hospitalières à la direction de l'Hôtel-Dieu. Les religieuses conservent tout de même un certain rôle dans la prestation des soins de santé.
Le 1er octobre 1996, l'Hôtel-Dieu est intégré, avec les hôpitaux Notre-Dame et Saint-Luc, dans le Centre hospitalier de l'Université de Montréal. En 2017, les patients déménagent dans un bâtiment tout neuf, rue Saint-Denis.
La fondation de l'Hôtel-Dieu est un événement important dans l'histoire de Montréal. Sa construction donne naissance à une institution emblématique de la métropole.
Assemblée nationale du Québec. Par ici la démocratie. Ligne du temps [En Ligne]. http://paricilademocratie.com/
BERNIER, Jeanne. L’Hôpital de Jeanne-Mance à Ville-Marie : son évolution à travers les siècles. Montréal, Thérien Frères Limitée, 1958. 119 p.
CADOTTE, Marcel. « Histoire médicale de l'Hôtel-Dieu de Montréal I - Jeanne Mance et les débuts de l'hôpital ». Le Médecin du Québec. Vol. 27, no 6 (1992), p. 97-105.
Conseil du statut de la femme et Réseau québécois en études féministes. Ligne du temps de l'histoire des femmes au Québec [En Ligne]. http://www.histoiredesfemmes.quebec/
GAGNON, Robert et Denis GOULET. Histoire de la médecine au Québec 1800-2000. Québec, Septentrion, 2014. 450 p.
GOULET, Denis et André PARADIS. Trois siècles d'histoire médicale au Québec: chronologie des institutions et des pratiques (1639-1939). Montréal, VLB, 1992. 527 p.
LAHAISE, Robert. L'Hôtel-Dieu de Montréal (1642-1973). Montréal, Hurtubise HMH, 1973. 254 p.
LIARD, Nathalie. Hôtel-Dieu de Montréal: évolution historique et architecturale. Université de Montréal, 1998. 94 p.
MONDOUX, Marie. L'Hôtel-Dieu, premier hôpital de Montréal, 1642-1763. Montréal, Thérien Frères, 1942. 417 p.
PLOUFFE, Manon. Jeanne-Mance, infirmière et cofondatrice de Montréal. Montréal, Éditions de l'Isatis, 2014. 79 p.
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Le Séminaire de Saint-Sulpice devient seigneur de l’île de Montréal

Le 9 mars 1663, la Société Notre-Dame de Montréal cède à la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice la seigneurie de l'île de Montréal. Cette compagnie, créée à Paris par Jean-Jacques Olier de Verneuil en 1641, avait établi une succursale à Montréal en 1657.
La Société Notre-Dame de Montréal est fondée officiellement en 1642, mais active depuis 1639. Dirigée par Jérôme Le Royer de la Dauversière, elle veut créer une nouvelle cité de Dieu à Montréal dans laquelle cohabiteraient Français pieux et Amérindiens convertis. À cette fin, elle se fait concéder la seigneurie de l'île par la Compagnie de la Nouvelle-France (Cent-Associés). En 1650, Jean-Jacques Olier de Verneuil devient l'un des directeurs de la Société. Il recrute ensuite des collègues sulpiciens pour fonder un séminaire à Montréal et assurer le service spirituel d'une future paroisse. Quatre prêtres viennent ainsi s'établir le 12 avril 1657 : Gabriel Thubières de Lévy de Queylus, Gabriel Souart, Dominique Galinier et Antoine d'Allet.
La Société Notre-Dame de Montréal n'a jamais eu toutes les ressources nécessaires à son projet et se trouve à court de donateurs. Conséquemment, elle se tourne vers les Sulpiciens pour prendre le relais. Le supérieur de Saint-Sulpice, Alexandre Le Ragois de Bretonvilliers, possède une richesse suffisante pour absorber les dettes accumulées. Le contrat de cession est signé le 9 mars 1663 et la prise de possession de la seigneurie survient le 18 avril. Ainsi, les Sulpiciens élargissent le spectre de leurs activités dans la colonie en devenant des gestionnaires fonciers et des bâtisseurs.
De 1663 à 1740, les Sulpiciens mettent au point des outils de gestion du territoire. Le premier inventaire des terres est réalisé en 1667 et l'île de Montréal est organisée sur deux fronts. En 1672, un premier plan des rues de la ville est tracé par le supérieur montréalais, François Dollier de Casson. L'espace rural en périphérie est progressivement découpé selon des éléments de la topographie. Les premières côtes et les montées sont balisées et des chemins sont aménagés. Des paroisses qui regroupent des côtes voisines sont graduellement érigées. Les seigneurs complètent l'attribution des censives de l'île en 1834.
Après la Conquête, les autorités britanniques interdisent les congrégations religieuses masculines. Le supérieur montréalais des Sulpiciens, Étienne Montgolfier, se rend à Londres en 1763 pour démontrer que sa compagnie n'est pas une congrégation, mais bien une association de prêtres assurant le ministère paroissial. Le gouvernement britannique accepte les arguments des Sulpiciens, pourvu qu'ils rompent tout lien avec la France. L'année suivante, Montgolfier va à Paris afin que la seigneurie soit cédée au Séminaire montréalais. Toutefois, cette cession crée des problèmes, car celui-ci n'a pas d'existence légale et les arrangements de 1764 sont postérieurs à la Conquête. Les droits des Sulpiciens restent donc fragiles jusqu'à l'adoption d'une nouvelle charte en 1840 qui les reconnaît et confirme leurs titres seigneuriaux.
En 1854, le régime seigneurial est aboli, mais les Sulpiciens continuent à percevoir des rentes jusqu'au XXe siècle. Les ressources que leur procure la seigneurie au fil des siècles leur permettent de contribuer financièrement à de nombreuses initiatives religieuses, éducatives, sociales et culturelles.
L'acquisition de la seigneurie de Montréal par les Sulpiciens marque un tournant dans l'histoire de la gestion de l'espace montréalais. Elle permet d'accélérer le peuplement et structure le territoire.
DESLANDRES, Dominique, John Alexander DICKINSON et Ollivier HUBERT. Les Sulpiciens de Montréal: une histoire de pouvoir et de discrétion, 1657-2007. Montréal, Fides, 2007. 670 p.
HAREL, Bruno et Josette MICHAUD. Le séminaire de Saint-Sulpice de Montréal. Montréal, Ministère des Affaires culturelles, 1990. 22 p.
Les Sulpiciens de la Province canadienne. Les Sulpiciens de la Province canadienne [En Ligne]. http://www.sulpc.org/hist.html
MAURAULT, Olivier. « Les Sulpiciens seigneurs de Montréal ». Revue trimestrielle canadienne. Vol. 28 (1942), p. 237-253.
THÉRIAULT, Michel. « Sulpiciens ». Historica Canada. L'encyclopédie canadienne [En ligne]. http://www.thecanadianencyclopedia.ca/
TREMBLAY, Louise. La politique missionnaire des Sulpiciens au XVIIe et au début du XVIIIe siècles, 1668-1735. Université de Montréal, 1981. 187 p.
VIAU, Roland. « L’archipel du négoce, 1650-1701 ». FOUGÈRES, Dany, dir. Histoire de Montréal et de sa région. 2 Tomes. Québec, Les Presses de l'Université Laval, 2012, p. 150-164.
s.a. Les Prêtres de Saint-Sulpice au Canada : grandes figures de leur histoire. Sainte-Foy, Presses de l'Université Laval, 1992. 430 p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Arrivée des Filles du roi en Nouvelle-France

L’année 1663 marque un changement majeur dans l’histoire de la Nouvelle-France. Devant les difficultés vécues par la colonie depuis sa fondation, le roi Louis XIV décide de reprendre en main l’administration et le développement de ses territoires en Amérique du Nord. Parmi les nombreux problèmes qui attirent l’attention du souverain, la question du peuplement et celle de la disproportion entre les sexes dans la colonie sont particulièrement importantes. Il n’y a pas assez de femmes en Nouvelle-France pour assurer son peuplement.
Pour répondre à cette impasse démographique, Louis XIV décide de favoriser le passage de femmes célibataires ou veuves, appelées les Filles du roi, depuis la France jusqu’à la colonie, en vue de les marier aux colons et d’encourager la formation de familles. Cette immigration féminine, amorcée en 1663, est dirigée par l’intendant des finances du royaume, Jean-Baptiste Colbert, appuyé à partir de 1665 par le premier intendant de la Nouvelle-France, Jean Talon. Entre 1663 et 1673, des centaines de femmes acceptent ainsi de migrer vers la colonie en échange d’avantages consentis par le roi. Ce dernier assure non seulement leur traversée à ses frais, mais s’engage de plus à les vêtir et, pour certaines, les munir d’une dot d’au moins 50 livres afin de faciliter leur union. Il s’agit pour la plupart d’entre elles d’une occasion de s’extirper de leur condition et de commencer une nouvelle existence. Si quelques femmes issues de la bourgeoisie et de la petite noblesse comptent parmi les Filles du roi, la grande majorité de celles-ci sont tirées de milieux défavorisés ; environ le tiers sont choisies parmi les orphelines de la Salpêtrière, à Paris. D’autres proviennent des orphelinats, couvents et institutions de charité du nord-ouest de la France.
En 1663, 38 Filles du roi viennent s’établir en Nouvelle-France ; 36 d’entre elles font partie du premier contingent arrivé le 22 septembre 1663. Des femmes assurent la direction des cohortes qui suivent, dont Anne Gasnier, épouse de Jean Bourdon, procureur général au Conseil souverain, qui traverse l’Atlantique à plusieurs reprises pour recruter des immigrantes auxquelles elle offre l’hébergement dans sa maison de Québec. La capitale de la colonie dispose d’ailleurs d’un bâtiment érigé par Talon où logent temporairement les Filles du roi avant qu’elles ne se dispersent majoritairement dans le gouvernement de Québec, mais aussi dans ceux de Montréal et de Trois-Rivières. À Montréal, les Filles du roi sont notamment accueillies par Marguerite Bourgeoys. Supervisées, elles choisissent elles-mêmes leur mari. Dans un milieu où les hommes prêts au mariage sont au moins six fois plus nombreux que les femmes dans la même situation, les Filles du roi n’ont généralement pas tardé à trouver un époux. Elles prennent parti généralement dans les semaines qui suivent leur arrivée.
Pendant dix ans, elles sont entre 764 et 1000 à profiter de cette initiative royale et à s’installer dans la colonie. Le taux de natalité en Nouvelle-France atteint alors les 63 naissances par 1000 habitants. Conséquemment, les Filles du roi ont largement contribué à faire doubler la population coloniale de 1666 à 1672.
En raison de leurs origines modestes, les Filles du roi ont souvent été représentées à tort comme des femmes de mauvaise vie. Par contre, les recherches les plus récentes démontrent que les femmes choisies pour être envoyées en Nouvelle-France sont sélectionnées selon des critères assez stricts. Pour les premières cohortes, on exige même des certificats de bonne conduite témoignant de la rigueur morale des femmes tirant parti des générosités royales pour passer dans la colonie.
Cet événement historique est désigné pour les motifs suivants:
L’envoi des Filles du roi en Nouvelle-France découle de la volonté de Louis XIV de reprendre en main l’administration et le développement de ses territoires en Amérique du Nord. Sélectionnées selon des critères assez stricts, les Filles du roi sont de jeunes femmes célibataires qui acceptent d’immigrer en Nouvelle-France pour prendre époux et favoriser la formation de familles. Elles sont transportées aux frais du roi, qui les pourvoit pour la plupart d’une dot. Le premier contingent des Filles du roi arrive en Nouvelle-France le 22 septembre 1663. Jusqu’en 1673, elles sont entre 770 et 1 000 à tirer parti de cette initiative royale et à s’établir dans les régions de Québec, Montréal et Trois-Rivières. L’arrivée des Filles du roi en Nouvelle-France a contribué d’une manière importante à l’augmentation de la population et au développement de la colonie.
Assemblée nationale du Québec. Par ici la démocratie. Ligne du temps [En Ligne]. http://paricilademocratie.com/
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La ligne du temps du Québec [En Ligne]. https://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
Conseil du statut de la femme et Réseau québécois en études féministes. Ligne du temps de l’histoire des femmes au Québec [En Ligne]. http://www.histoiredesfemmes.quebec/
DUMAS, Silvio. Les filles du roi en Nouvelle-France : étude historique avec répertoire biographique. Cahiers d’histoire, 24. Québec, Société historique de Québec, 1972. 382 p.
GINGRAS, Marie-Ève. « Les Filles du roi : mythes, réalités et représentations ». Cap-aux-Diamants. No 114 (2013), p. 19-22.
HAMELIN, Jean. « Bourdon, Jean ». Université Laval/University of Toronto. Dictionnaire biographique du Canada [En ligne]. http://www.biographi.ca
LANCTÔT, Gustave. Filles de joie ou filles du roi : étude sur l’émigration féminine en Nouvelle-France. Montréal, Les éditions du jour, 1964. 156 p.
LANDRY, Yves. Les Filles du roi au XVIIe siècle : orphelines en France, pionnières au Canada ; suivi d’un Répertoire biographique des Filles du roi. Montréal, Bibliothèque québécoise, 2013. 276 p.
LANDRY, Yves. « Les Filles du roi et les soldats du régiment de Carignan-Salières ». Cap-aux-Diamants : la revue d’histoire du Québec (1993), p. 24-27.
LECLERC, Paul-André. « Le mariage sous le régime français (suite) ». Revue d’histoire de l’Amérique française. Vol. 14, no 1 (1960), p. 34-60.
LEDUC, Adrienne. « La destinée d’une Fille du roi ». Cap-aux-diamants. No 91 (2007), p. 14-17.
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
s.a. La société d’histoire des Filles du Roy [En Ligne]. www.histoirefillesroy.ca
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Arrivée du régiment de Carignan-Salières en Nouvelle-France

Le régiment de Carignan-Salières arrive en Nouvelle-France en 1665. La venue de ces hommes en armes permet de sécuriser les possessions françaises en Amérique du Nord et favorisera ultérieurement le peuplement de la colonie.
Au milieu du XVIIe siècle, les relations entre les Français et les Iroquois sont tendues. Les raids de ces derniers, particulièrement sur Ville-Marie (Montréal), compromettent le développement de la colonie. Pour défendre le territoire, la Compagnie des Cent-Associés entretient une petite troupe constituée en camp volant qui se déplace en fonction des nécessités. Cette force est toutefois insuffisante pour enrayer complètement la menace iroquoise.
En 1663, Louis XIV fait passer la Nouvelle-France sous son autorité directe en la dotant d'un gouvernement royal. Ayant été précédemment informé par les administrateurs coloniaux de la nécessité de pacifier les Iroquois pour stabiliser la colonie, il ordonne en 1664 l'envoi du régiment de Carignan-Salières en Nouvelle-France.
Le régiment de Carignan-Salières, commandé par le marquis Henri de Chastelard de Salières, est le résultat de la fusion, cinq ans plus tôt, du régiment de Salières avec le régiment d'Emmanuel-Philibert de Savoie, prince de Carignan. Parti de Marsal, en Lorraine, en janvier 1665, le régiment de Carignan-Salières, composé alors d'environ 1100 hommes, traverse la France à pied pour se rendre à La Rochelle. Peu avant l'embarquement, les compagnies sont réparties sur l'île d'Oléron et l'île de Ré. D'avril à mai 1665, les soldats sont embarqués sur sept navires et traversent l'Atlantique. Le premier contingent arrive à Québec le 19 juin et le dernier, le 14 septembre. Les soldats sont placés sous le commandement d'Alexandre de Prouville de Tracy, lieutenant-général des Antilles et de la Nouvelle-France, qui arrive des Antilles avec quatre de ses propres compagnies (environ 200 hommes), le 30 juin.
La première mission du régiment de Carignan-Salières en Nouvelle-France est de construire une série de forts le long de la rivière Richelieu pour verrouiller la route d'invasion des Iroquois. Les forts Saint-Louis, Richelieu et Sainte-Thérèse sont ainsi érigés à l'automne 1665 et les soldats sont répartis dans ces forts et à Québec, Montréal et Trois-Rivières.
En 1666, le régiment mène deux offensives contre les Iroquois. Au cours de l'hiver, 500 à 600 soldats, volontaires et alliés autochtones se rendent dans le territoire iroquois, sans toutefois causer de dégâts importants. Les pertes de l'expédition sont non négligeables : une soixantaine d'hommes périssent du froid et du manque de vivres. Cette démonstration de force amène toutefois quelques nations iroquoises à conclure une paix. À l'automne, une seconde expédition permet à 600 soldats du régiment, accompagnés de volontaires et d'Autochtones, d'atteindre les villages des Agniers. Avertis de l'arrivée des troupes françaises, ceux-ci désertent leurs villages, que les soldats incendient. Sans remporter une victoire décisive sur les Iroquois, Tracy arrive toutefois à démontrer la supériorité militaire française. Cette attaque, combinée aux épidémies de petite vérole et de scarlatine conduisent les Agniers à une paix avec les Français en 1667.
Le régiment de Carignan-Salières est rappelé en France en 1668. Désireux de promouvoir le peuplement de la colonie, le roi offre des terres aux soldats et officiers qui souhaitent s'y établir. Ils sont près de 400 à être démobilisés et à profiter de cette opportunité. De ce nombre, 283 se marient dans les années subséquentes, notamment avec des Filles du roi.
En s'établissant au pays, les soldats du régiment de Carignan-Salières ont contribué de manière importante au développement de la Nouvelle-France. Ils comptent de nos jours de nombreux descendants au Québec et en Amérique du Nord et ont laissé une marque durable dans la toponymie.
Cet événement historique est désigné pour les motifs suivants:
Le régiment de Carignan-Salières arrive en Nouvelle-France en 1665 sur l'ordre de Louis XIV. Placé sous le commandement d'Alexandre de Prouville de Tracy, le régiment sécurise les possessions françaises en Amérique du Nord en construisant des fortifications et en menant deux expéditions militaires contre les Iroquois. En 1667, une paix est signée et le régiment est rappelé en France. Environ 400 soldats choisissent toutefois de s'établir dans la colonie en échange de terres et de nourriture. Plus de la moitié de ces hommes se marient, notamment à des Filles du roi, et comptent de nos jours de nombreux descendants au Québec et en Amérique du Nord. Devenus seigneurs et habitants, ces soldats ont ainsi contribué de manière importante au développement de la Nouvelle-France.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La ligne du temps du Québec [En Ligne]. https://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
BLAIS, Christian, Gilles GALLICHAN, Frédéric LEMIEUX et Jocelyn SAINT-PIERRE. Québec: quatre siècles d'une capitale. Québec, Assemblée nationale du Québec - Les Publications du Québec, 2008. 692 p.
DESROSIERS, Léo-Paul. Iroquoisie. Vol. 2. Sillery, Septentrion, 1998. 341 p.
DESROSIERS, Léo-Paul. Iroquoisie. Vol. 3. Sillery, Septentrion, 1999. 347 p.
DICKINSON, John Alexander et Brian YOUNG. Brève histoire socio-économique du Québec. Sillery, Septentrion, 2003. 452 p.
Historica Canada. L'encyclopédie canadienne [En Ligne]. http://www.thecanadianencyclopedia.com/
LACOURSIÈRE, Jacques, Jean PROVENCHER et Denis VAUGEOIS. Canada-Québec: synthèse historique, 1534-2000. Québec, Éditions du Septentrion, 2001. 591 p.
LAMONTAGNE, Léopold. « Prouville de Tracy, Alexandre de ». Université Laval/University of Toronto. Dictionnaire biographique du Canada [En ligne]. http://www.biographi.ca
LANGLOIS, Michel. « Le régiment de Carignan-Salières : des forces pour la paix, des bras pour la colonisation ». Cap-aux-Diamants. No 23 (1990), p. 62-65.
MORTON, Desmond. Une histoire militaire du Canada, 1608-1991. Sillery, Les Éditions du Septentrion, 1992. 414 p.
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
TRUDEL, Marcel. Initiation à la Nouvelle-France. Montréal, Holt Rinehart and Winston, 1968. 323 p.
VERNEY, Jack. The good regiment : the Carignan-Salières Regiment in Canada, 1665-1668. Montréal, McGill-Queen's University Press, 1991. 222 p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Fondation de la Brasserie du Roy en 1668

En 1663, l’intendant Jean Talon arrive en Nouvelle-France avec la mission de développer la colonie d’un point de vue économique. Pour ce faire, il établit sur les rives de la rivière Saint-Charles ce qui peut être considéré comme le premier « parc industriel » du Canada. On y retrouve un chantier naval, une tannerie, un moulin à scie, deux briqueteries, trois moulins à farine ainsi qu’une brasserie. Cette dernière, en plus de rapporter des profits à la colonie et de diversifier les cultures, doit encourager les colons à consommer de la bière, une boisson abordable et moins forte en alcool que le vin ou les eaux-de-vie.
La brasserie est érigée entre 1668 et 1669 au pied de la falaise adjacente à l’Hôtel-Dieu de Québec. Au printemps 1670, la production peut commencer. L’édifice principal, constitué de blocs de schiste et de calcaire montés sur une fondation de bois et de pierre, fait 45 mètres de long et s’élève sur quatre niveaux. Un dallage de calcaire recouvre les planchers intérieurs du sous-sol – le germoir – et du rez-de-chaussée de la brasserie. Des cocons de vers tubifex prospérant facilement en milieu humide trouvés par les archéologues dans les vestiges du sous-sol confirment d’ailleurs la présence d’un germoir sur place. L’orge préalablement germée est ensuite torréfiée dans la touraille, une structure dans laquelle le grain est étendu et asséché sur de grandes toiles au-dessus d’un four. Ce malt est alors concassé, puis trempé dans de grandes cuves de bois munies de faux-fonds dont aucun vestige n’ont été retrouvés à la Brasserie du Roy. Le moût est ensuite transvidé à l’intérieur de deux grandes chaudières de cuivre pour y être bouilli avec du houblon. Ces chaudières se retrouvent dans la portion ouest de la brasserie et reposent sur un massif de maçonnerie construit au-dessus de grands foyers. Elles peuvent contenir environ 10.000 litres de moût chacune et valent alors plusieurs centaines de livres françaises. Le moût cuit est enfin fermenté une première fois dans la « cuve guilloire », puis une seconde fois à l’intérieur de tonneaux. La bonne facture des équipements de la Brasserie du Roy, des installations grandement similaires à ce que Diderot et D’Alembert recommandent dans leur encyclopédie pourtant publiée près de cent ans plus tard, contribue probablement à la qualité de la bière produite sur place. Quant à la qualification ou la provenance des employés de la brasserie, un autre facteur influençant la qualité de la bière, les historiens ne peuvent qu’émettre des hypothèses. On sait par exemple qu’au 17e siècle, plusieurs colons arrivent en Nouvelle-France de Picardie et de Normandie, deux régions où on retrouve une vive tradition brassicole. De plus, un certain sieur de Battanville, identifié comme étant un brasseur de profession, habite à proximité de la Brasserie du Roy, mais rien n’indique qu’il n’y travaille.
En effet, le savoir-faire brassicole est largement répandu dans la colonie et plusieurs s’adonnent à cette activité dans l’environnement domestique. Les différentes communautés religieuses ainsi que les colons brassent ainsi de manière autonome différents styles de bière dont le « bouillon », une bière primitive fabriquée à partir d’une boule de pâte au levain laissée à tremper dans une quantité d’eau. Ainsi, malgré ses qualités, la bière de Jean Talon peine à se vendre dans la colonie. De plus, se conservant plutôt mal et ne tolérant pas les longs voyages, cette dernière ne trouve pas preneur dans les Antilles où l’Intendant prévoit écouler la moitié des 20.000 litres brassés annuellement.
Jean Talon met donc fin aux opérations en 1675. Malgré sa volonté affirmée de dynamiser l’économie coloniale, il est possible que Jean Talon ait moins décidé d’établir la Brasserie du Roy « pour la production de bière que pour le prestige que lui apportait la magnificence de ce bâtiment et surtout les profits que sa vente pourrait lui rapporter. »
FERLAND, Catherine. « De la bière et des hommes : Culture matérielle et aspects socioculturels de la brasserie au Canada (17e-18e siècles) ». Terrains et travaux. No 9 (2005), p. 32-50.
FISET, Richard. Brasseries et distilleries à Québec (1620-1900) : Profil d’archéologie industrielle. Université Laval, 2001. 538 p.
MOUSSETTE, Marcel. « La bière à l’époque de Jean-Talon ». Cap-aux-Diamants. No 28 (1992), p. 18-20.
MOUSSETTE, Marcel. Le site du Palais de l’Intendant à Québec : Genèse et structuration d’un lieu urbain. Nouveaux cahiers du CÉLAT, 10. Québec, Septentrion, 1994. 229 p.
SIMONEAU, Daniel. « The Intendant’s Palace site : new insight into its physical evolution and initial occupation ». Post-Medieval Archaeology. Vol. 43, no 1 (2009), p. 171-182.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Siège de Québec par Phips

En Europe, au printemps 1689, la guerre éclate entre la France et la Ligue d'Augsbourg, une coalition de pays que l'Angleterre rejoint l'année suivante. Le conflit se transporte rapidement en Amérique où la France lance une attaque contre les colonies de la Nouvelle-Angleterre. Les troupes de Frontenac (Louis de Buade) incendient plusieurs villages et sèment la terreur dans les régions de Boston et d'Albany. Sans tarder, les Anglais réclament la destruction de Québec et les habitants des différentes colonies font front commun contre la Nouvelle-France.
Au Massachusetts, les autorités coloniales envoient le major général William Phips pour s'emparer de l'Acadie. Ce dernier prend possession de Port-Royal en mai 1690 et rentre à Boston où une autre expédition est aussitôt mise en branle. Il est prévu que Phips se rende à Québec par la voie des eaux pendant qu'un autre détachement de l'armée se dirige vers Montréal. Cette manœuvre terrestre est abandonnée en raison du manque de vivres et de la présence de maladie.
À la mi-août, Phips entre dans le fleuve Saint-Laurent avec 34 navires partis de Boston ayant à leur bord plus de 2 000 hommes. Le 16 octobre, il mouille devant Québec et envoie un émissaire à Frontenac lui demandant de lui rendre la ville. C'est alors que le gouverneur rétorque: « Je n'ai point de réponse à faire à votre général que par la bouche de mes canons ». Le siège de Québec débute le 18 octobre.
À cette époque, les fortifications de Québec s'étendent depuis la rivière Saint-Charles jusque sur le cap aux Diamants. La Haute-Ville est bien protégée par un mur entrecoupé de batteries d'artillerie tandis que la Basse-Ville est défendue par deux batteries riveraines équipées de canons lourds. Ajoutée à cela, une ligne de remblais ponctués de 11 redoutes couvre le côté ouest de la ville. En matière d'effectifs, Frontenac a sous ses ordres une armée de 3 000 hommes.
Une partie des troupes anglaises débarquent à Beauport (Québec) et sont repoussées par les soldats français. Dans le port, les vaisseaux anglais bombardent la ville de 1 500 coups de canon, mais ceux-ci font peu de dommages. Les batteries françaises ripostent notamment en réutilisant les boulets anglais. Après quatre jours de combat, les navires anglais ont épuisé leurs munitions. Les nouvelles tentatives de débarquement du côté de Beauport ont échoué et de nombreux miliciens sont malades. Le bilan du siège fait état de centaines de victimes du côté des Anglais contre une demi-douzaine du côté des Français. Phips abandonne l'idée d'une conquête et, après un échange de prisonniers, repart vers la Nouvelle-Angleterre le 24 octobre. Pendant le voyage de retour, quatre de ses navires font naufrage.
BERNIER, Serge. Québec, ville militaire, 1608-2008. Montréal, Art Global, 2008. 347 p.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La ligne du temps du Québec [En Ligne]. https://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
BLAIS, Christian, Gilles GALLICHAN, Frédéric LEMIEUX et Jocelyn SAINT-PIERRE. Québec: quatre siècles d'une capitale. Québec, Assemblée nationale du Québec - Les Publications du Québec, 2008. 692 p.
ECCLES, William John. « Buade, Louis de, comte de Frontenac et de Palluau ». Université Laval/University of Toronto. Dictionnaire biographique du Canada [En ligne]. http://www.biographi.ca
MATHIEU, Jacques. La Nouvelle-France: les Français en Amérique du Nord, XVIe-XVIIIe siècle. Québec, Presses de l'Université Laval, 2001. 271 p.
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Le sauvetage archéologique de l'épave d'un vaisseau de la flotte de Phips (1690) [En Ligne]. http://www.mcccf.gouv.qc.ca/phips/phips1.htm
MYRAND, Ernest. Sir William Phips devant Québec : histoire d'un siège. Quebec, L.-J. Demers, 1893. 428 p.
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
STANLEY, George Francis Gilman. Nos soldats: l'histoire militaire du Canada de 1604 à nos jours. Montréal, Éditions de l'Homme, 1980. 620 p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Grande Paix de Montréal

La Grande Paix est un événement diplomatique qui s'est déroulé à Montréal à l'été 1701. Les alliés amérindiens des Français et les Iroquois s'y sont assemblés afin de signer un traité de paix pour mettre un terme à la guerre franco-iroquoise.
Ce conflit commence au début du XVIIe siècle lorsque Samuel de Champlain consolide des alliances avec certaines tribus amérindiennes. Le contrôle des réseaux de la traite des fourrures devient un enjeu de rivalité entre les différentes nations amérindiennes, chacune souhaitant apparaître en interlocuteur privilégié auprès des Européens. La guerre pour le contrôle des fourrures oppose bientôt les Hurons, les Montagnais et les Algonquins, alliés des Français, aux nations iroquoises de la puissante Ligue des cinq nations, soutenues par les Hollandais, puis par les colons anglais. Les Montagnais, les Hurons et les Algonquins demandent à Champlain de les assister dans leurs guerres contre les Iroquois. Celui-ci accepte de fournir son appui militaire et attaque les Iroquois sur leur territoire. Ces derniers répliquent en dirigeant leurs assauts contre les établissements français de la vallée du Saint-Laurent. Ils deviennent rapidement une menace importante tant pour les habitants de la colonie que pour leurs alliés amérindiens. En 1649, les Iroquois réussissent à disperser les Hurons.
Cette guerre se poursuit tout au long du XVIIe siècle hormis durant les périodes de trêve. Une paix temporaire est signée en 1667, ce qui permet aux Français de circuler sans risque sur le territoire. Ils fondent alors une série de forts dans la région des Grands Lacs où ils rencontrent une multitude de nations amérindiennes avec qui ils nouent des alliances. Lorsque la guerre avec les Iroquois reprend en 1681, ces nations appuient les Français.
À la fin du XVIIe siècle, les Iroquois sont de plus en plus affaiblis, les Français n'ayant cessé de les attaquer sur leur propre territoire. Avec le traité de Ryswick de 1697 qui met un terme aux affrontements entre Anglais et Français, les Iroquois se retrouvent seuls à faire la guerre à ces derniers et à leurs alliés amérindiens. Lorsque Louis Hector de Callière envoie une députation en Iroquoisie pour leur proposer une paix à l'été 1700, ils prennent cette proposition très au sérieux.
En juillet 1701, quatre des cinq nations iroquoises et les alliés amérindiens des Français, venant principalement de la région des Grands Lacs, se rendent à Montréal pour discuter d'une paix. Le traité est signé le 4 août 1701 après deux semaines de pourparlers. Plus d'une trentaine de nations apposent leurs signatures. En appuyant ce traité, elles renoncent à se faire la guerre et se considèrent comme des alliés. Elles reconnaissent le gouverneur de la Nouvelle-France comme médiateur dans l'éventualité où un conflit les opposerait de nouveau. La Ligue iroquoise s'engage, quant à elle, à rester neutre dans l'éventualité d'une guerre opposant les Anglais aux Français. L'accord de paix de Montréal assure à la France la supériorité dans les questions autochtones et la liberté d'étendre sa présence militaire sur le continent au cours du demi-siècle qui suit. Le commerce et les expéditions de découverte peuvent reprendre en toute quiétude.
Ce traité met définitivement fin au conflit franco-iroquois.
Assemblée nationale du Québec. Par ici la démocratie. Ligne du temps [En Ligne]. http://paricilademocratie.com/
BEAULIEU, Alain et Roland VIAU. La Grande Paix : chronique d'une saga diplomatique. Montréal, Corporation des fêtes de la Grande Paix de Montréal/Éditions Libre Expression ltée, 2001. 127 p.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La ligne du temps du Québec [En Ligne]. https://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
HAVARD, Gilles. La Grande Paix de Montréal de 1701 : les voies de la diplomatie franco-amérindienne. Montréal, Recherches amérindiennes au Québec, 1992. 222 p.
JAENEN, Cornelius J. « Grande Paix de Montréal (1701) ». Historica Canada. L'encyclopédie canadienne [En ligne]. http://www.thecanadianencyclopedia.com/
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Expédition et naufrage de la flotte Walker

L'expédition menée par l'amiral Hovenden Walker en 1711 s'inscrit dans le contexte de la guerre de Succession d'Espagne (1701-1713) et de la lutte impériale qui oppose la France et l'Angleterre en Amérique depuis le 17e siècle. Après la conquête de l'Acadie au printemps 1710, l'Angleterre cherche à conquérir le Canada pour neutraliser la Nouvelle-France et ainsi s'approprier le commerce des fourrures et des pêches. L'attaque planifiée par la Grande-Bretagne prévoit un siège naval contre Québec ainsi qu'une expédition terrestre pour attaquer Montréal. La flotte de Walker compte entre 75 et 90 navires comprenant environ 6000 marins et 5300 soldats. Les troupes terrestres, sous le commandement de Francis Nicholson, comprennent environ 1500 soldats et miliciens de la Nouvelle-Angleterre et 800 alliés haudenosaunees (Iroquois).
Walker organise l'expédition à partir de Boston, mais il doit composer avec des problèmes de logistique et la pénurie de main-d'oeuvre, de munitions et de pilotes qui connaissent bien le fleuve Saint-Laurent. Le 11 août 1711, la flotte quitte Boston en direction de Québec. Dans la nuit du 2 au 3 septembre, en raison des vents, de la brume et de l'inexpérience des pilotes, elle dérive vers la côte nord du fleuve Saint-Laurent. Croyant s'approcher de la rive sud, Walker ordonne de mettre le cap vers le nord. Cette manoeuvre s'avère désastreuse, car au lieu de retourner dans le chenal, la flotte se dirige vers la côte et les récifs entourant l'île aux Oeufs. Plusieurs bateaux font naufrage en frappant ces récifs. L'évaluation des pertes humaines et matérielles varie selon les récits. La majorité des sources anglaises mentionnent 9 ou 10 navires perdus et entre 900 et 1400 morts. Ce chiffre comprend des marins et des soldats, mais aussi des femmes et des enfants. Plusieurs navires perdus transportaient des vivres et du matériel nécessaires à l'expédition.
Le 5 septembre, Walker et son conseil de guerre décident d'annuler l'invasion du Canada. Ayant appris l'échec de la flotte, l'expédition de Nicholson doit rebrousser chemin avant d'avoir atteint le lac Champlain. Ce qui reste de la flotte se sépare et les bateaux retournent dans leur port d'origine.
La nouvelle du naufrage parvient à Québec en octobre. L'échec de la flotte anglaise est interprété comme un miracle et le fruit de l'intervention divine, ce qui donne lieu à des célébrations exceptionnelles à Québec. Le 25 octobre 1711, la cérémonie du Te Deum Laudamus se tient à la cathédrale, suivie d'une procession solennelle. Le Te Deum est un chant de louanges entonné lors d'événements importants comme des victoires militaires ou des moments marquants de l'histoire de la famille royale. L'église Notre-Dame-de-la-Victoire, nommée ainsi en 1690 après l'échec du siège de William Phips, est renommée Notre-Dame-des-Victoires.
À la suite du changement de gouvernement à Londres, l'amiral Walker est sommé de fournir un récit complet de l'expédition. En 1720, afin de sauver sa réputation, il publie à Londres, A Journal: Or the Full Account of the Late Expedition to Canada.
BLAIS, Christian, Gilles GALLICHAN, Frédéric LEMIEUX et Jocelyn SAINT-PIERRE. Québec: quatre siècles d'une capitale. Québec, Assemblée nationale du Québec - Les Publications du Québec, 2008. 692 p.
CROFT, Marie-Ange et Jean-René THUOT. « Expédition et naufrage de la flotte Walker (1711). Récits d'une tentative avortée de conquête de la Nouvelle-France ». Revue d'histoire de la Nouvelle-France. No 5 (2024), p. 22-31.
CROFT, Marie-Ange, Dany DUMONT, Maxime GOHIER et Sylvain LUMBROSO. « L'expédition Walker. Entretien avec Marie-Ange Croft, Dany Dumont et Maxime Gohier ». Revue d'histoire de la Nouvelle-France. No 5 (2024), p. 14-21.
CROFT, Marie-Ange et Marie-Hélène NADEAU. « Le naufrage de la flotte Walker (1711): genèse et trajectoire d’un récit nord-côtier ». L'Estuaire. Vol. 81 (2023), p. 53-66.
DOUTRELEPONT, Charles. « Les chants de la victoire du 25 octobre 1711 ». Revue d'histoire de la Nouvelle-France. No 5 (2024), p. 50-56.
GRAHAM, Gerald S. « Walker, sir Hovenden ». Université Laval/University of Toronto. Dictionnaire biographique du Canada [En ligne]. http://www.biographi.ca
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Guerre de la Conquête

La guerre de la Conquête est un conflit qui oppose, de 1754 à 1760, les puissances coloniales britanniques et françaises en Amérique du Nord. Elle s’inscrit dans le contexte plus large de la guerre de Sept Ans, qui se déroule de 1756 à 1763, au cours de laquelle le royaume de France et le royaume de Grande-Bretagne s’affrontent, ainsi que leurs alliés, non seulement en Europe, mais sur l’océan Atlantique, en Afrique occidentale et aux Indes.
Avant cette guerre, l’Empire français d’Amérique du Nord, peu peuplé mais très vaste, s’étend jusqu’au lac Manitoba à l’ouest et jusqu’à la Louisiane au sud. À l’inverse, les colonies britanniques de la Nouvelle-Angleterre sont densément peuplées et leurs habitants font pression sur la Grande-Bretagne pour qu’elle permette l’expansion vers l’ouest. Le contrôle de cette région est devenu un enjeu important pour les deux camps, surtout depuis la création par les Britanniques en 1747 de la Compagnie de l’Ohio, qui a le mandat de coloniser ce territoire. Répondant à l’appel de ses colonies, la Couronne britannique décide de chasser les Français du continent.
La guerre de la Conquête s’amorce en juillet 1754 au moment où les Français repoussent une attaque britannique menée par George Washington et prennent possession du fort Nécessité, dans la vallée de l’Ohio. L’année suivante, la Grande-Bretagne s’empare du fort Beauséjour en Acadie et déporte les Acadiens de la Nouvelle-Écosse. Après une série de victoires des troupes françaises autour des forts Duquesne (1755), Bull (1756), Oswego (1756), William Henry (1757) et Carillon (1758), les Britanniques reprennent le contrôle de la situation. Rapidement, ils ravissent plusieurs possessions aux Français et les encerclent dans la vallée du Saint-Laurent. En 1758, ils s’emparent de la forteresse de Louisbourg, du fort Frontenac et du fort Duquesne. En juillet 1759, c’est au tour du fort Niagara de tomber aux mains de la Grande-Bretagne.
Durant ce temps, au nord-est, la ville de Québec subit le siège des troupes du major-général James Wolfe. Le 13 septembre, après deux mois à essuyer les bombardements des Britanniques, le lieutenant-général Louis-Joseph de Montcalm leur livre combat sur les plaines d’Abraham, après que ces derniers aient effectué un débarquement surprise à l’Anse-au-Foulon. Vaincus, les Français signent la reddition de la ville cinq jours plus tard. L’année suivante, les Britanniques encaissent un revers lors de la bataille de Sainte-Foy, avant d’emporter la bataille navale de la Ristigouche et de s’emparer des derniers forts de la vallée du Richelieu.
Le 8 septembre 1760, le gouverneur de la Nouvelle-France, Pierre de Rigault de Vaudreuil de Cavagnial, négocie la reddition de Montréal avec le major-général Jeffrey Amherst, entraînant la capitulation de la colonie. La Nouvelle-France passe sous contrôle britannique, hormis la Louisiane qui reste temporairement française. Les vainqueurs garantissent les droits civils et religieux aux Canadiens en plus de reconnaître leurs propriétés. La guerre a toutefois causé son lot de souffrances: 10 000 personnes meurent en raison des maladies et de la famine occasionnées par la guerre.
Durant les trois années qui suivent, le sort de la Nouvelle-France est en suspens puisque le conflit perdure en Europe. En 1763, la signature du traité de Paris confirme que la colonie est désormais une possession britannique. Les Français cèdent définitivement leur territoire en Amérique du Nord, à l’exception des îles Saint-Pierre et Miquelon.
ECCLES, William John. « Guerre de Sept Ans ». Historica Canada. L’encyclopédie canadienne [En ligne]. http://www.thecanadianencyclopedia.com/
FRÉGAULT, Guy. La Guerre de la Conquête. Montréal, Fides, 2009. 514 p.
MORTON, Desmond. Une histoire militaire du Canada, 1608-1991. Sillery, Les Éditions du Septentrion, 1992. 414 p.
Parcs Canada. « Lieu historique national du Canada du Fort-Chambly ». Parcs Canada. Parcs Canada [En ligne]. http://www.pc.gc.ca/lhn-nhs/qc/fortchambly/
s.a. Patrimoine militaire canadien [En Ligne]. http://www.cmhg.gc.ca/cmh/fr/page_1.asp
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Déportation des Acadiens

La déportation des Acadiens est un événement de la guerre de Sept Ans. Elle se déroule en 1755 et elle précède la chute de la Nouvelle-France. Elle affecte la population francophone de l’Acadie qui est déplacée principalement sur le territoire nord-américain et en Grande-Bretagne par l’armée britannique.
Dans le cadre du traité d’Utrecht qui met fin à la guerre de la Succession d’Espagne en 1713, la France cède le territoire de l’Acadie à la Grande-Bretagne, mais conserve l’île Royale (île du Cap-Breton). Privilège des vainqueurs, le territoire annexé est dorénavant désigné sous le nom de Nouvelle-Écosse. Les Acadiens, assujettis aux Britanniques, refusent de prêter serment d’allégeance au roi de la Grande-Bretagne. Tout au plus acceptent-ils de prononcer un serment de neutralité dans l’éventualité où les Britanniques entreraient à nouveau en conflit avec les Français. Alors que la tension monte entre les deux royaumes rivaux, la France fait construire la forteresse de Louisbourg sur l’île du Cap-Breton ainsi que le fort Beauséjour. Les Britanniques ripostent en établissant une base navale à Halifax et le fort Lawrence.
Entre 1713 et 1755, la démographie de la région change radicalement avec le décuplement de la population acadienne et l’arrivée de nombreux colons britanniques. Ces derniers convoitent les terres occupées par les Acadiens.
Au début de la guerre de Sept Ans, les autorités coloniales britanniques songent à déplacer la population acadienne. En 1755, un regroupement de provinciaux en armes et de soldats britanniques prennent plusieurs forts français de la péninsule, dont le fort Beauséjour et le fort Gaspareaux. Le gouverneur de la Nouvelle-Écosse, Charles Lawrence, confisque les armes des Acadiens et exige d’eux qu’ils prêtent serment d’allégeance à la couronne britannique. Devant leur refus, Lawrence donne l’ordre aux commandants des districts de Beaubassin, de Pisiquid et d’Annapolis Royal d’attirer et de capturer les hommes acadiens. Près de 10 000 Acadiens, répartis selon leur âge et leur sexe, sont ensuite déportés à différents endroits sur la côte atlantique. Certains sont envoyés en Grande-Bretagne où ils sont emprisonnés. D’autres se retrouvent en France ou dans les Caraïbes. Des milliers meurent de maladie ou de faim à bord des navires insalubres.
Après la signature du traité de Paris en 1763, les terres des Acadiens sont occupées par des colons venus de la Nouvelle-Angleterre. La Grande-Bretagne autorise les anciens occupants à s’installer dans les colonies britanniques. Ceux-ci sont pour la plupart disséminés sur le territoire et doivent trouver de nouvelles terres à cultiver.
Assemblée nationale du Québec. Par ici la démocratie. Ligne du temps [En Ligne]. http://paricilademocratie.com/
CHIASSON, père Anselme et Nicolas LANDRY. « Histoire de l’Acadie ». Historica Canada. L’encyclopédie canadienne [En ligne]. http://www.thecanadianencyclopedia.com/
FRÉGAULT, Guy. « La déportation des Acadiens ». Revue d’histoire de l’Amérique française. Vol. 8, no 3 (1954), p. 309-358.
MARSH, James. « La déportation des Acadiens ». Historica Canada. L’encyclopédie canadienne [En ligne]. http://www.thecanadianencyclopedia.com/
s.a. Patrimoine militaire canadien [En Ligne]. http://www.cmhg.gc.ca/cmh/fr/page_1.asp
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Siège de Québec par Wolfe

Le siège de Québec est un épisode de la guerre de la Conquête et se déroule entre les mois de juin et de septembre 1759. Il oppose les troupes britanniques du major-général James Wolfe au contingent de l'armée française du lieutenant-général Louis-Joseph de Montcalm de même qu'aux habitants de la ville de Québec et des environs.
Le conflit entre la France et l'Empire britannique, amorcé depuis 1754 en Amérique, se propage à l'Europe en 1756, marquant le début de la guerre de Sept Ans. En 1757, William Pitt, ministre de la Guerre de Grande-Bretagne, élabore un plan d'invasion de la Nouvelle-France, qui doit culminer par la prise de Montréal. La chute de la ville de Québec, capitale de la colonie, est essentielle à cette opération, car elle permet d'isoler le Canada de la France. Le plan de Pitt est en voie de se concrétiser en 1758, alors que le fort Duquesne et la forteresse de Louisbourg tombent aux mains des Britanniques.
En janvier 1759, le commandement de l'expédition contre Québec est confié au major-général James Wolfe. Au mois de juin, la flotte dirigée par le vice-amiral Charles Saunders remonte le fleuve Saint-Laurent vers la capitale. Les 186 vaisseaux, dont 49 navires de guerre, transportent 15 600 officiers et marins, et plus de 9 000 combattants. Le blocus naval tarde cependant à se mettre en place et des renforts français atteignent Québec le 10 mai. Douze jours plus tard, Montcalm arrive de Montréal. Chargé de la défense de la ville, ce dernier fortifie la rive de Beauport. Il peut compter sur une armée d'environ 16 000 hommes, constituée de miliciens, de soldats et d'Amérindiens.
Le siège débute à la fin du mois de juin, alors que la flotte britannique se regroupe au large de l'île d'Orléans et permet aux troupes de Wolfe d'y débarquer. Les Français répliquent en tentant de mettre le feu à l'escadre au moyen de brûlots, mais l'opération est un échec. Wolfe et ses hommes effectuent deux nouveaux débarquements, l'un à l'est de la rivière Montmorency et l'autre à la Pointe-De-Lévy où, légèrement à l'ouest, ils érigent leurs batteries et commencent les bombardements sur Québec dans la nuit du 12 juillet. La canonnade dure deux mois et entraîne la destruction de la cathédrale, du collège des Jésuites, de l'église de Notre-Dame-des-Victoires et des trois quarts de la basse ville de Québec. Ayant trop peu de poudre pour répliquer, les batteries françaises demeurent muettes.
Le 25 juillet, Wolfe donne l'ordre de mener des expéditions punitives sur les deux rives du fleuve entre Lauzon et Kamouraska. Ces raids visent à forcer Montcalm à l'affrontement et à châtier les Canadiens pour ne pas être restés neutres durant le conflit. Sous les ordres de George Scott et de Joseph Goreham, des rangers américains incendient 1 400 maisons et fermes, en plus d'anéantir les récoltes.
Le dernier jour du mois de juillet, les Britanniques subissent un revers en essayant de s'emparer de la ligne de Beauport au cours de la bataille de Montmorency. Après cette défaite, Wolfe et ses brigadiers cherchent un autre lieu de débarquement pour prendre Québec. Le choix du major-général se porte sur l'Anse-au-Foulon, à l'est de la batterie française de Samos. Dans la nuit du 12 au 13 septembre, les soldats britanniques font l'ascension de la falaise qui les sépare des plaines d'Abraham. En matinée, les troupes de Wolfe sont positionnées sur les plaines en préparation de la bataille. Montcalm, surpris, engage le combat.
La bataille des Plaines d'Abraham se termine par la défaite des forces françaises et par la mort des généraux Wolfe et Montcalm. Jean-Baptiste-Nicolas-Roch de Ramezay, lieutenant du roi, signe la reddition de la ville, qui est livrée aux Britanniques le 18 septembre 1759, mettant ainsi un terme au siège de Québec. L'année suivante, Montréal capitule et la Nouvelle-France est officiellement cédée à la Grande-Bretagne en 1763.
BLAIS, Christian, Gilles GALLICHAN, Frédéric LEMIEUX et Jocelyn SAINT-PIERRE. Québec: quatre siècles d'une capitale. Québec, Assemblée nationale du Québec - Les Publications du Québec, 2008. 692 p.
DESCHÊNES, Gaston. L'année des Anglais : la Côte-du-Sud à l'heure de la Conquête, Québec. Québec, Septentrion, 2009. 158 p.
DROUIN, Daniel et Hélène QUIMPER. La prise de Québec, 1759-1760. Québec, Commission des champs de bataille nationaux, 2009. 133 p.
LACOURSIÈRE, Jacques et Hélène QUIMPER. Québec, ville assiégée, 1759-1760, d'après les acteurs et les témoins. Sillery, Septentrion, 2009. 270 p.
MACLEOD, Peter D. La vérité sur la bataille des plaines d'Abraham. Montréal, Les Éditions de l'Homme, 2008. 491 p.
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
STACEY, C. P. Québec, 1759 : le siège et la bataille. Québec, Presse de l'Université Laval, 2009. 329 p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Bataille de Montmorency

La bataille de Montmorency est un événement de la guerre de la Conquête, qui précède la bataille des Plaines d'Abraham. Elle se déroule le 31 juillet 1759 et oppose les troupes britanniques, dirigées par le général James Wolfe, à un contingent de l'armée française, commandé par Louis-Joseph de Montcalm et secondé par des miliciens et des Amérindiens.
Tant en Europe qu'en Amérique du Nord, la guerre de Sept Ans oppose alors l'Empire britannique à la France. Les Britanniques souhaitent conquérir la Nouvelle-France en s'attaquant d'abord à la ville de Québec. Ils mettent en place, dès le mois de juin 1759, le siège de Québec en installant leur flotte sur le fleuve Saint-Laurent en face de Beauport (Québec). Au début du mois de juillet, les forces britanniques débarquent près du pied de la chute Montmorency et établissent un camp fortifié à l'est, sur les hauteurs. Le 31 juillet, les commandants George Townshend, James Murray et Robert Monckton rejoignent les troupes militaires britanniques à proximité de la chute et Wolfe ordonne une attaque immédiate des retranchements français.
L'armée française, campée dans le haut de la falaise, attend l'ennemi de pied ferme. L'indiscipline des premières compagnies de l'armée britannique qui attaquent avant l'arrivée de tous les soldats des autres régiments et un orage qui se déclenche durant les hostilités font des Britanniques, en pleine ascension de la falaise, une cible facile. Plus de 400 d'entre eux sont tués ou blessés avant que Wolfe n'ordonne la retraite de ses troupes. Du côté français, on enregistre une soixantaine de morts et de blessés.
Malgré cette défaite, la marine britannique poursuit le siège de Québec après la bataille de Montmorency. La campagne de peur dans les villages côtiers de la vallée du Saint-Laurent prend de l'ampleur et les bombardements sur Québec se multiplient.
EVANS, David. « Montmorency, chute ». Historica Canada. L'encyclopédie canadienne [En ligne]. http://www.thecanadianencyclopedia.com/
STACEY, C. P. Québec, 1759 : le siège et la bataille. Québec, Presse de l'Université Laval, 2009. 329 p.
s.a. Patrimoine militaire canadien [En Ligne]. http://www.cmhg.gc.ca/cmh/fr/page_1.asp
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Bataille des Plaines d'Abraham

La bataille des Plaines d'Abraham est un événement majeur de la guerre de la Conquête. Elle se déroule le 13 septembre 1759 et oppose les troupes britanniques du major-général James Wolfe au contingent de l'armée française du lieutenant-général Louis-Joseph de Montcalm, composé de soldats réguliers, de miliciens canadiens et d'Amérindiens.
Depuis la fin du mois de février 1759, les Britanniques assiègent la ville de Québec, capitale de la Nouvelle-France. Après une tentative infructueuse de débarquement sur la rive de Beauport, Wolfe, conseillé par ses brigadiers, opte pour le site de l'Anse-au-Foulon.
Dans la nuit du 12 au 13 septembre, un premier détachement de soldats britanniques atteint le rivage de l'Anse-au-Foulon. L'endroit est peu défendu et les vigiles prennent les barques britanniques pour un convoi de ravitaillement devant arriver sous peu. Un groupe d'infanterie légère gravit, sans résistance, l'escarpement qui le sépare des plaines d'Abraham. L'arrivée d'un deuxième détachement de soldats entraîne une riposte des défenseurs situés sur les hauteurs.
Au matin, environ 4 500 soldats britanniques sont alignés à l'ouest des fortifications de Québec. Les bataillons de Wolfe sont toutefois harcelés par des francs-tireurs canadiens et amérindiens. Montcalm, surpris par la présence des Britanniques de ce côté de la ville, fait appel aux soldats stationnés dans la baie de Beauport. À leur arrivée, le contingent de réguliers, de miliciens et d'Amérindiens compte approximativement 3 500 hommes. N'attendant pas l'arrivée de Louis-Antoine de Bougainville et de son armée de plus de 2 000 soldats professionnels, Montcalm donne l'ordre de livrer bataille. Il préfère attaquer l'ennemi avant que celui-ci renforce ses positions et amène de nouvelles pièces d'artillerie pour canonner Québec sur son flanc le moins fortifié.
Vers 10 heures, les troupes de Montcalm s'engagent dans une bataille à l'européenne. Alignées sur trois rangs, elles chargent au pas rapide, de façon désordonnée, avant de faire feu sur l'ennemi à peine en vue. En face, les Britanniques attendent que les Français soient à portée de mousquet avant de riposter. Deux salves finement coordonnées suffisent à semer la pagaille au sein de l'armée française, qui rompt les rangs et prend la fuite. Cet engagement décisif dure moins d'une demi-heure. Montcalm est touché durant la retraite tout comme Wolfe, qui meurt non loin du champ de bataille. Une grande part des troupes françaises sont refoulées vers la rivière Saint-Charles, tandis que des miliciens et des Amérindiens embusqués protègent leur repli.
Le gouverneur de la Nouvelle-France, Pierre de Rigaud de Vaudreuil de Cavagnial, arrivé de Beauport avec deux bataillons de miliciens, rassemble ce qu'il reste de l'armée en fuite. Vers midi, les troupes françaises se réfugient au camp de Beauport. À l'ouest de Québec, Bougainville arrive avec des renforts après avoir tenté de s'emparer de la batterie de Samos. Assailli par les bataillons de George Townshend, qui est désormais à la tête de l'armée britannique, il se replie. Dans les heures qui suivent, Vaudreuil, sur l'avis de ses officiers, fuit avec ses hommes au site du fort Jacques-Cartier pendant que Bougainville couvre ses arrières.
Alors que l'armée française est en déroute, les forces présentes dans la ville sont désorganisées. Montcalm meurt de ses blessures le 14 septembre, les provisions suffisent à peine à nourrir la population et plusieurs soldats désertent. Durant ce temps, Townshend rassemble son artillerie. Jean-Baptiste-Nicolas-Roch de Ramezay, commandant de la garnison de la ville, se plie aux conseils de ses officiers et des notables de Québec et livre la cité aux Britanniques le 18 septembre.
Pour la colonie française et ses habitants, la bataille des Plaines d'Abraham est une défaite militaire qui entraîne la perte de la capitale de la Nouvelle-France et annonce le changement de régime qui sera entériné par le traité de Paris de 1763.
Assemblée nationale du Québec. Par ici la démocratie. Ligne du temps [En Ligne]. http://paricilademocratie.com/
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La ligne du temps du Québec [En Ligne]. https://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
COURTOIS, Charles-Philippe. La conquête : une anthologie. Montréal, Typo, 2009. 485 p.
DROUIN, Daniel et Hélène QUIMPER. La prise de Québec, 1759-1760. Québec, Commission des champs de bataille nationaux, 2009. 133 p.
FRANCIS, R. Douglas, Richard JONES et Donald B. SMITH. Origins: Canadian History to Confederation. Toronto, Nelson Education, 2004. 493 p.
FRÉGAULT, Guy. La Guerre de la Conquête. Montréal, Fides, 2009. 514 p.
LAPIERRE, Laurier. 1759 : la bataille du Canada. Montréal, Le Jour, 1992. 301 p.
MACLEOD, Peter D. La vérité sur la bataille des plaines d'Abraham. Montréal, Les Éditions de l'Homme, 2008. 491 p.
MORTON, Desmond. Une histoire militaire du Canada, 1608-1991. Sillery, Les Éditions du Septentrion, 1992. 414 p.
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
STACEY, C. P. Québec, 1759 : le siège et la bataille. Québec, Presse de l'Université Laval, 2009. 329 p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Bataille de Sainte-Foy

La bataille de Sainte-Foy est un événement de la guerre de la Conquête. Elle se déroule le 28 avril 1760 sur le chemin Sainte-Foy, près de Québec, et oppose l’armée française, dirigée par François de Lévis, à l’armée britannique, dirigée par le colonel James Murray.
À la fin de 1759, la ville de Québec est contrôlée par l’armée britannique. À Montréal, Lévis, de concert avec Pierre de Rigaud de Vaudreuil de Cavagnial, lance l’idée de reprendre la ville. Il dresse les plans et rassemble l’équipement nécessaire à l’opération. Dans le but d’aller en France demander du renfort pour l’année suivante, des bateaux réussissent à passer devant Québec. Les demandes sont fixées à l’envoi de 7 000 soldats, de provisions, de munitions et de pièces d’artillerie.
Menée par Lévis, une armée de 7 000 hommes se dirige vers Québec via Sainte-Foy. Lorsque le colonel Murray est informé de la situation, il fait évacuer la population de Québec, de Sainte-Foy et de l’Ancienne-Lorette. Il fait raser les quartiers Saint-Roch et Sainte-Famille et ordonne à la garnison de Québec de mettre en place des retranchements à Sainte-Foy.
L’armée française arrive à proximité de Québec le 27 avril 1760. Des escarmouches éclatent entre les soldats britanniques et français. Murray ordonne l’assaut de l’armée française le lendemain. Son armée compte près de 3 400 soldats. L’affrontement entre les deux armées se déroule sur la largeur du promontoire de Québec, particulièrement sur le chemin Sainte-Foy. Le régiment de La Sarre affronte les 40e et 60e régiments britanniques au moulin Dumont. Peu à peu, les Français gagnent du terrain et, après trois heures de combat, Murray ordonne finalement la retraite de ses troupes. Le bilan des pertes est plus important que celui de la bataille des Plaines d’Abraham: 1 104 victimes pour les Britanniques contre 833 pour les Français.
À la suite de la bataille de Sainte-Foy, Lévis met en place le siège de la ville de Québec, mais les renforts en provenance de la France tardent à arriver. Ce sont finalement les bateaux britanniques qui arrivent en premier. Les bateaux français, n’amenant que 400 soldats au lieu des 7 000 demandés, n’atteindront jamais Québec. Lévis lève le siège et retraite vers Montréal, qui capitule un peu plus tard, marquant ainsi la chute définitive de la Nouvelle-France.
Assemblée nationale du Québec. Par ici la démocratie. Ligne du temps [En Ligne]. http://paricilademocratie.com/
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La ligne du temps du Québec [En Ligne]. https://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
ECCLES, William John. Bataille de Sainte-Foy [En Ligne]. http://www.thecanadianencyclopedia.com
s.a. Patrimoine militaire canadien [En Ligne]. http://www.cmhg.gc.ca/cmh/fr/page_1.asp
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Bataille de la Ristigouche

La bataille de la Ristigouche est un événement de la guerre de la Conquête. Elle se déroule le 8 juillet 1760 et a lieu à l’embouchure de la rivière Ristigouche, dans la baie des Chaleurs. Cette bataille oppose la marine française, dirigée par le commandant François Chenard de La Giraudais, à la marine britannique, dirigée par le capitaine John Byron.
Après la chute de Québec en septembre 1759, les Français tentent de reprendre le contrôle de la Nouvelle-France. Au printemps 1760, la France envoie cinq navires marchands qui transportent 400 hommes de troupe et 2 000 tonneaux de vivres et de munitions pour ravitailler la colonie. Ces navires, escortés par la frégate Le Machault, doivent franchir le blocus mis en place par la marine britannique près des côtes françaises. Trois des bateaux ne réussiront pas à compléter la traversée.
Le 15 mai 1760, les bateaux français pénètrent dans le golfe du Saint-Laurent et La Giraudais, apprenant qu’une flotte britannique a déjà remonté le fleuve, choisit de se réfugier dans la baie des Chaleurs. Les Français jettent l’ancre à l’embouchure de la rivière Ristigouche et ravitaillent la population, composée en majeure partie de déportés acadiens et de Micmacs.
Le capitaine Byron quitte Louisbourg avec cinq vaisseaux de guerre au mois de juin suivant. La flotte française est alors bloquée. La Giraudais ordonne à ses bateaux de se réfugier dans l’estuaire de la rivière Ristigouche. Il croit que les bateaux britanniques sont trop gros pour y pénétrer. Les deux flottes campent sur leurs positions pendant quelques jours.
Le 3 juillet 1760, les bateaux britanniques pénètrent dans l’estuaire de la Ristigouche et la bataille s’engage. Pendant cinq jours, de furieux combats ont lieu et La Giraudais parvient à tenir tête à Byron. Le 8 juillet, voyant la défaite imminente de ses troupes, le commandant français ordonne de couler les bateaux Le Machault et Le Bienfaisant. Il veut ainsi éviter que les Britanniques prennent possession des vivres et des munitions qui se trouvent dans les cales de ces bateaux. Une fois sur la terre ferme, les Français établissent un fort et y prennent garnison.
La bataille de la Ristigouche est le dernier affrontement naval nord-américain entre la France et la Grande-Bretagne. Elle est suivie de la capitulation de la Nouvelle-France, privée des secours nécessaires, le 8 septembre 1760 à Montréal. Le 29 octobre, apprenant la nouvelle, la petite garnison française à Ristigouche se rend aux Britanniques.
BEATTIE, Judith et Bernard POTHIER. La bataille de la Ristigouche. Ottawa, Parcs Canada, 1996. 48 p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Signature du traité de Paris

Le 10 février 1763, la signature du traité de Paris met fin à la guerre de Sept Ans, un conflit qui oppose depuis 1756 les royaumes de France et de Grande-Bretagne, ainsi que leurs alliés, non seulement en Europe, mais en Amérique du Nord, sur l’océan Atlantique, en Afrique occidentale et aux Indes. Fruit de longues négociations, ce document engendre d’importantes transformations politiques, économiques et sociales à travers le monde, particulièrement en Amérique du Nord.
Les négociations de paix s’amorcent au printemps 1761, alors que le roi de Grande-Bretagne George III, monté sur le trône l’année précédente, envisage de mettre un terme à la guerre. Victorieux sur le plan militaire, les Britanniques n’ont ni les moyens, ni la volonté de réclamer la cession de tous les territoires qu’ils occupent. Dans ce contexte, le gouvernement du premier ministre John Stuart recherche l’atteinte d’un compromis basé sur un meilleur équilibre entre les puissances européennes. Du côté de la France, le secrétaire d’État à la Guerre Étienne François de Choiseul considère, compte tenu des dernières défaites militaires subies par les troupes de Louis XIV, céder le Canada si la Guadeloupe et les pêcheries de Terre-Neuve sont conservées. L’entrée dans le conflit de l’Espagne au côté de la France en janvier 1762 a pour effet de remanier les enjeux territoriaux. Lors des négociations préliminaires tenues à Fontainebleau le 3 novembre 1762, le royaume de Charles III obtient de son allié français la Louisiane, en compensation des pertes subies durant le conflit.
Le traité de Paris est signé à l’hôtel du diplomate britannique John Russell en 1763. L’entente, rédigée en français entre la France, la Grande-Bretagne et l’Espagne, comprend 30 articles qui consacrent d’importants gains britanniques. Toutes les possessions françaises en Inde, sauf quelques comptoirs, sont abandonnées au profit de la Grande-Bretagne. La France donne à cette dernière tous ses territoires américains à l’est du Mississippi, mais conserve les îles Saint-Pierre et Miquelon ainsi qu’un droit limité de pêche dans le golfe du Saint-Laurent. Elle garde aussi ses lucratives possessions antillaises. L’Espagne cède quant à elle la Floride aux Britanniques pour récupérer La Havane.
Pour les Canadiens, la ratification du traité de Paris confirme le changement de régime. Le traité offre toutefois des garanties aux habitants, telles que la liberté de professer la religion catholique dans le respect des lois britanniques et le droit de jouir et de disposer de leurs biens. Ceux qui désirent rentrer en France auront 18 mois pour le faire. Le 7 octobre 1763 est déclarée la Proclamation royale qui définit les structures administratives de la colonie britannique, désormais désignée sous le nom de Province de Québec. Un nouveau découpage territorial circonscrit les Canadiens autour de la vallée du Saint-Laurent.
La signature du traité de Paris a aussi des répercussions ailleurs en Amérique du Nord. Une coalition de peuples autochtones menés par le chef outaouais Pontiac se rebelle contre la Grande-Bretagne en mai 1763, pour récupérer leurs territoires cédés à cette dernière. Cette révolte se solde par la défaite de Pontiac en 1766. La fin des hostilités amène également la Grande-Bretagne à imposer diverses taxes aux Treize colonies afin de recouvrer une partie des sommes investies dans l’effort de guerre. Ces taxes provoquent le mécontentement des colons américains, alimentant leur désir d’être représentés politiquement, et conduisent ultimement à la Déclaration d’indépendance des États-Unis.
Le traité de Paris de 1763 sème les germes de profondes transformations. La confirmation de la conquête de la Nouvelle-France, plus particulièrement du Canada, bouleverse les institutions et la structure sociale de l’ancienne colonie française. Les nouveaux administrateurs britanniques devront toutefois composer avec une population francophone majoritaire qui n’entend pas renier ses origines.
Assemblée nationale du Québec. Par ici la démocratie. Ligne du temps [En Ligne]. http://paricilademocratie.com/
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La ligne du temps du Québec [En Ligne]. https://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
CALLOWAY, Colin. The scratch of a pen : 1763 and the transformation of North America. New York, Oxford University Press, 2005. 219 p.
DE WAELE, Michel. « Guerre et paix en Europe, conquête et cession en Nouvelle-France ». Cap-aux-Diamants. No 115 (2013), p. 11-14.
FRÉGAULT, Guy. La Guerre de la Conquête. Montréal, Fides, 2009. 514 p.
GOUGH, Barry. British Mercantile Interests in the Making of the Peace of Paris - 1763. Lewinston (NY), E. Mellen Press, 1992. 156 p.
IMBEAULT, Sophie, dir., Denis VAUGEOIS, dir. et Laurent VEYSSIÈRE, dir. 1763 : la traité de Paris bouleverse l’Amérique. Québec, Septentrion, 2013. 420 p.
JENNINGS, Francis, dir. The History and culture of Iroquois diplomacy : an interdisciplinary guide to the treaties of the Six Nations and their league. Syracuse (NY), Syracuse University Press, 1985. 278 p.
SAWAYA, Jean-Pierre. « Les Amérindiens et le traité de Paris ». Cap-aux-Diamants. No 115 (2013), p. 27-29.
VAUGEOIS, Denis. « Un traité aux répercussions continentales ». Cap-aux-Diamants. No 115 (2013), p. 4-7.
s.a. Le traité de Paris de 1763 en bref. Québec, Septentrion, 2014. 157 p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Voyage du Columbo, premier train de bois de Philemon Wright

Le voyage de Philemon Wright (1760-1839) à bord du Columbo, premier train de bois à descendre la rivière des Outaouais et le Saint-Laurent jusqu'à Québec, symbolise le début de l'industrie forestière au Québec. Celui-ci arrive au Canada en 1800 et s'établit sur le site actuel de Hull avec l'intention de fonder une communauté de fermiers indépendants. Le manque de capitaux l'amène toutefois à développer le commerce du bois en 1806 pour financer la colonie. La coupe de bois est également motivée par la nécessité de retenir la main-d'œuvre pendant les mois d'hiver jusqu'aux travaux d'été.
Pour acheminer son bois jusqu'au port de Québec afin de l'exporter vers le marché de la Grande-Bretagne, Philemon Wright assemble des pièces de bois équarri, des planches et des madriers sous forme de radeau, appelé train de bois. Un premier radeau de bois équarri part le 11 juin 1806 de l'embouchure de la rivière Gatineau pour descendre la rivière des Outaouais, puis le fleuve Saint Laurent jusqu'à Québec. Nommé le Columbo, ce train de bois constitué de plusieurs cages est composé de 700 plançons de pin et de chêne et de milliers de planches, qui portent environ 900 madriers. Le voyage effectué par Wright et quatre autres cageux est pénible en raison des obstacles, dont les rapides du Long-Sault. La difficulté du voyage est accentuée par la nouveauté de l'entreprise. Wright estime qu'il peut passer par le nord de l'île de Montréal pour atteindre Québec, ce qui, d'après lui, est réputé impossible et n'a jamais été tenté. Il atteint cependant Québec le 12 août par cette voie, non sans difficultés, et doit attendre jusqu'en novembre pour vendre sa cargaison. Il récidive l'année suivante et rencontre de meilleurs résultats. Wright parvient rapidement à la tête d'une industrie naissante. En 1814, il fonde avec ses fils la compagnie Philemon Wright and Sons pour accroitre l'efficacité de cette activité naissante.
L'expérience de Wright permet à la fois de lier l'important potentiel forestier de la vallée de l'Outaouais au marché britannique et d'ouvrir une voie de navigation pour les cages entre Hull et Québec. Seulement en 1823, l'entreprise P. Wright and Sons achemine vers Québec plus de 300 trains de bois provenant de la vallée de l'Outaouais. Le paysage de cette rivière en est profondément marqué: des travaux de dragage sont effectués et en 1829, un glissoir – le premier du genre au Canada – est construit par la compagnie P. Wright and Sons en bordure de la rive nord de la rivière des Outaouais pour que les trains de bois puissent contourner la chute des Chaudières sans dommages ou pertes. D'autres installations de ce type ne tardent pas à apparaitre, de même que des scieries et quais autour de la rivière.
Le voyage du Columbo en 1806 contribue à l'essor de l'industrie forestière de l'Outaouais, qui joue un rôle structurant dans l'histoire de cette région. En effet, le succès de l'entreprise de Wright encourage d'autres entrepreneurs à l'imiter et entraine un accroissement du trafic de bois vers Québec.
Le développement du marché américain pour le bois de charpente avec la signature du traité de réciprocité avec les États-Unis en 1854 ouvre le commerce au sud et amène la diversification de l'industrie. Le voyage de Wright symbolise en quelque sorte le début de l'exploitation forestière orientée vers le marché extérieur, qui demeure une activité économique importante au Québec jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
Cet événement historique est désigné pour les motifs suivants:
« Le voyage du premier train de bois, le Columbo, en 1806, s'inscrit dans le contexte de l'essor du commerce du bois dans le Bas-Canada au début du XIXe siècle, alors favorisé par la forte demande de la Grande-Bretagne en bois équarri. Pour atteindre le marché britannique, l'homme d'affaires Philemon Wright, établit dans le canton de Hull, met au point un système d'assemblage des radeaux de bois pour les faire flotter jusqu'au port de Québec, d'où les pièces pourront être chargées dans les cales des navires en partance pour la métropole. Le 11 juin 1806, le Columbo entreprend son périple. Constitué de plusieurs cages, ce premier train de bois est composé de 700 plançons de pin et de chêne ainsi que de milliers de planches, le tout permettant de transporter environ 900 madriers. Le périple effectué par Wright et quatre autres cageux était jusqu'alors considéré comme impossible en raison des nombreux obstacles se dressant sur le parcours, notamment les rapides du Long-Sault. Le Columbo atteint néanmoins Québec le 12 août, et Wright écoule sa cargaison en novembre. Fort de son expérience, il récidive l'année suivante et obtient de meilleurs résultats. Les trains de bois en provenance de l'Outaouais seront par la suite très nombreux à rejoindre Québec, pour ensuite transiter outre-Atlantique. Le voyage du Columbo en 1806 a ainsi contribué au développement de l'exploitation forestière dans l'Outaouais, qui sera le moteur économique de cette région durant la majeure partie du XIXe siècle. »
Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire public de l’Outaouais et Société d'histoire forestière du Québec. Histoire forestière de l'Outaouais [En Ligne]. http://www.histoireforestiereoutaouais.ca/bienvenue/
CURTIS, Christopher G. « Wright, Philemon ». Historica Canada. L'encyclopédie canadienne [En ligne]. http://www.thecanadianencyclopedia.com/
DIONNE, Lynda et Georges PELLETIER. Des forêts et des hommes 1880-1982. Sainte-Foy, Les Publications du Québec, 1997. 189 p.
ELLIOTT, Bruce S. « "The Famous Township of Hull": Image and Aspirations of a Pioneer Quebec Community ». Histoire sociale/ Social History. Vol. 12, no 24 (1979), p. 339-367.
GAUDREAU, Guy. Les récoltes des forêts publiques au Québec et en Ontario, 1840-1900. Montréal/Kingston, McGill-Queen’s University Press, 1999. 178 p.
POMERLEAU, Jeanne. Bûcherons, raftmens et draveurs, 1850-1960. Sainte-Foy, Éditions J.-C. Dupont, 1997. 143 p.
QUENNEVILLE, Raymond. « Pin blanc d’Amérique : exploitation des peuplements ». s.a. Encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française [En ligne]. http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-54/Pin_blanc_d'Am%C3%A9rique:_exploitation_des_peuplements_.html#.Xn0GvW5CdE5
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Mise en service de l'« Accommodation ».

Sa construction commence en janvier 1809. John Bruce, constructeur de bateau, John Jackson, ingénieur, ainsi que l'ébéniste John Kay s'associent pour construire ce bateau à vapeur. Des coûts élevés forcent John Kay à se retirer de l'aventure dès le 22 mars 1809. Le brasseur John Molson le remplace le 6 juin 1809. Les composantes de la machine à vapeur de six chevaux-vapeur, coulées aux Forges du Saint-Maurice ont été usinées par George Platt à son atelier montréalais. Plusieurs Montréalais participent à sa construction: François Corbeil, William Boyce, Robert Pollock, William Griffin, Louis Tavernier pour n'en mentionner que quelques-uns et même un Québécois, John Goudie (1775-1824).
Le lancement de l'Accommodation, contrairement aux traditions maritimes, a été très discret. Les journaux n'en ont pas parlé. On ne sait pas quelles personnalités étaient présentes. Il faut dire que le navire n'était pas très long, seulement 25,9 mètres pour une largeur d'au plus 4,5 mètres. Il pouvait recevoir près de vingt passagers en cabine et probablement une petite cargaison.
Le voyage inaugural vers Québec s'effectue sur quatre jours entre le 1er et le 4 novembre 1809. Ainsi, en 66 heures, l'Accommodation rallia Québec. Ce premier voyage demeure lent même en tenant compte du fait que le vapeur est resté ancré plus de 30 heures après son escale à Trois-Rivières. Quoi qu'il en soit, ce premier voyage marque le début d'une nouvelle ère pour le transport maritime au Canada.
La première saison de navigation a été très courte, car, dès la fin novembre, il a fallu penser à mettre le navire en hivernage. Rapidement, Molson prend le contrôle de l'aventure. Jackson est alors remplacé comme ingénieur-mécanicien par James Clark. De plus, en novembre 1810, John Bruce, employé par les Molson comme capitaine, se décide à céder ses parts dans l'entreprise Molson pour près de 28 livres.
L'Accommodation subit une importante refonte au cours de l'année 1810 dans le but d'améliorer ses performances. Malheureusement, tous ces travaux ne régleront rien: l'Accommodation reste un navire poussif. Le 5 juin 1810, le navire entreprend sa seconde saison, qui se termine au début d'octobre. À la même époque, John Molson comprend les défauts de son navire et commence à penser à le remplacer. Il rencontre l'inventeur et promoteur Robert Fulton à New York à cet effet à la fin de l'été 1810. Puis, il se rend en Angleterre afin de rencontrer James Watt, l'inventeur du moteur à double action, pour acquérir un moteur vraiment performant pour son nouveau navire, le Swiftsure.
L'Accommodation effectue, en 1810, huit ou neuf aller-retour Montréal-Québec. Les départs sont si aléatoires que Molson craint d'annoncer les départs dans les journaux. Il a recours aux services du crieur public A. Kollmyer pour annoncer les départs à la dernière minute. Les avis sont partagés quant à la qualité du service; tous déplorent le manque de puissance du moteur. Lors de son passage sur l'Accomodation en octobre 1810, Samuel Bridge constate que la fumée dégagée par le moteur est intolérable. Par contre, messieurs les voyageurs Tudor Hall, Pilgrim et Tuzo sont enchantés par la qualité de l'hébergement et des divertissements offerts à bord. De son côté, William Riddell ne se gêne pas pour dénoncer un certain manque de classe et la mauvaise construction du vapeur.
À la fin de la saison 1810, l'Accommodation est conduit à ses quartiers d'hiver dans les îles de Boucherville. Le bateau disparaît des livres de compte de la compagnie en janvier 1811. Malgré les pertes encourues par Molson, l'expérience acquise avec l'Accommodation se révèle capitale pour la mécanisation de l'industrie canadienne.
BELISLE, Jean. À propos d'un bateau à vapeur. Montréal, Hurtubise HMH, 1994. 93 p.
BELISLE, Jean et André LÉPINE. « La salle des machines du vapeur P.S. Lady Sherbrooke ». Archéologiques. Vol. Collection hors-séries 1 (2003), p. 104-121.
CROIL, James. Steam Navigation, its Relation to the Commerce of Canada and the United States. Toronto, William Briggs, 1898. 381 p.
DENISON, Merrill. The Barley and the Stream, The Molson Story. Toronto, McClelland & Stewart, 1955. 398 p.
DOWNS-ROSE, G. et W.S. HARVEY. William Symington Inventor and Engine Builder. London, Northgate Publishing Co. Ltd., 1980. 203 p.
MACKEY, Frank. Steamboat Connections : Montreal to Upper Canada, 1816-1843. Montréal, McGill-Queen's University Press, 2000. 383 p.
MARESTIER, Jean-Baptiste. Mémoire sur les bateaux à vapeur des États-Unis d'Amérique. Paris, Imprimerie royale, 1824. 290 p.
MCNALLY, Larry S. Montreal Engine Foundries and Their Contribution to Central Canadian Technological Development, 1820-1870. Université Carleton, Ottawa, 1991. 163 p.
MOLLAT, Michel. Les origines de la navigation à vapeur. Paris, Presses universitaires de France, 1970. 206 p.
WILSON, George H. The application of steam navigation to the St. Lawrence 1809-1840. Montréal, Université McGill, 1961. 287 p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Fondation de la Banque de Montréal

La Banque de Montréal est créée le 3 novembre 1817. Sa première succursale se trouve sur la rue Saint-Paul à Montréal. Société par actions à responsabilité limitée, la Banque de Montréal compte 289 associés au moment de sa fondation. Austin Cuvillier, George Moffatt, John Richardson et James Leslie font, notamment, partie des premiers fondateurs. La Banque obtient une charte émise par la province du Bas-Canada en 1822.
Dès sa fondation, la Banque de Montréal se positionne comme un acteur économique important dans la colonie. En plus d'être un lieu sûr pour entreposer des fonds, elle consent des prêts commerciaux et finance le commerce outre-mer. La Banque favorise aussi le développement commercial et industriel ainsi que la colonisation avec le financement de grands projets, telles l'ouverture des canaux pour la navigation et la construction du chemin de fer transcontinental. Plus grande institution financière du pays, la Banque de Montréal fait office de banque centrale à partir de 1863, et ce, jusqu'à la fondation de la Banque du Canada en 1935. Depuis 1893, elle est également l'agent financier du gouvernement canadien en Angleterre.
La croissance de la Banque de Montréal est, entre autres, liée aux nombreuses fusions avec d'autres banques, comme celles avec la Banque d'Échange de Yarmouth (1903), avec la Banque du Peuple d'Halifax (1905), avec la Banque de l'Amérique Britannique du Nord (1918), avec la Banque des Marchands du Canada (1922) et avec la Harris Bankcorp aux États-Unis (1984). Plusieurs hommes d'affaires occupent le poste de président de la Banque, comme Peter McGill, de 1834 à 1860, George Alexander Drummond, de 1905 à 1910, et Richard B. Angus, de 1910 à 1913.
Dans les années 1990, l'assouplissement de la réglementation concernant les banques permet à la Banque de Montréal de diversifier ses activités. Elle offre ainsi de nouveaux services, dont ceux des valeurs mobilières et de l'assurance. Elle est aussi la première banque canadienne à s'inscrire à la cote officielle à la bourse de New York en 1994. En 2007, la Banque de Montréal compte 1300 succursales au Canada et à l'étranger, fournit à sa clientèle un service bancaire électronique et déclare des actifs de 367 milliards de dollars. La Banque de Montréal possède plusieurs sociétés, regroupées sous l'appellation BMO Groupe financier.
Banque de Montréal. À propos de nous. [En Ligne]. http://www2.bmo.com/
DENISON, Merrill. La première banque au Canada. Histoire de la Banque de Montréal. Toronto / Montréal, MSRC / McClelland and Stewart Limited, 1967. 453 p.
NOLIN-RAYNAULD, Michelle. L'édifice de la Banque de Montréal à la Place d'Armes 1845-1901. Montréal, Les Éditions Varia, 1997. 157 p.
PARÉ, Jean-Pierre. « La doyenne des banques québécoises: la Banque de Montréal ». Cap-aux-Diamants. No 29 (s.d.), p. 36-39.
PARÉ, Jean-Pierre. Les banques au Québec. Québec, Éditions GID, 2008. 413 p.
Société de développement de Montréal. Vieux-Montréal [En Ligne]. http://www.vieux.montreal.qc.ca
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Fondation de la Banque de Québec

La diminution du commerce du bois à la fin du XXe siècle, et la lenteur des administrateurs de la Banque de Québec à exploiter d'autres sources de capitaux, font prendre beaucoup de retard à l'institution financière par rapport aux autres banques canadiennes. Les dirigeants de la Banque de Québec décident tardivement d'exploiter le marché national. Ils se butent alors à une zone saturée et n'arrivent pas à trouver suffisamment de nouveaux épargnants. La baisse importante du commerce dans la région de Québec durant la Première Guerre mondiale porte un coup fatal à la banque, qui doit trouver un moyen de sauver ses capitaux. En 1917, elle fusionne avec la Banque Royale du Canada. Cette institution renforce ainsi sa présence dans la région de Québec.
Banque Royale du Canada. À propos de RBC, Histoire [En Ligne]. http://www.rbc.com/
PARÉ, Jean-Pierre. Les banques au Québec. Québec, Éditions GID, 2008. 413 p.
RUDIN, Ronald. Banking en français: les banques canadiennes-françaises de 1835 à 1925. Montréal, Boréal, 1988. 244 p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Inauguration du canal de Lachine

Le canal de Lachine est inauguré le 24 août 1824 et ouvert à la navigation l'année suivante. Traversant le sud-ouest de Montréal, du lac Saint-Louis jusqu'au Vieux-Port, il permet de contourner les rapides de Lachine.
Depuis les premiers efforts de peuplement européen dans la vallée du Saint-Laurent, ces rapides constituent une barrière naturelle à la navigation. Ils sont considérés comme un obstacle au développement économique et à la pénétration au cœur du continent nord-américain. Seul un long portage permet de les contourner.
En 1819, des hommes d'affaires anglophones de Montréal se regroupent pour former la Compagnie des propriétaires du canal de Lachine. Dirigée par John Richardson, la société embauche l'ingénieur britannique Thomas Burnett. En 1821, l'entreprise est contrainte de céder la responsabilité des travaux au gouvernement bas-canadien puisqu'elle n'a pas été capable de lever les fonds nécessaires. Le gouvernement forme alors un organisme pour mener à bien le projet. La construction du canal de Lachine est financée en grande partie par une subvention impériale. Les travaux sont inaugurés le 17 juillet 1821 et se terminent en 1826. Le canal est néanmoins ouvert au trafic maritime dès 1825.
Parcourant une distance de 13,4 kilomètres, le canal a une largeur de 14,6 mètres et une profondeur de 1,4 mètre. À l'époque, seuls les voiliers de petites dimensions peuvent s'y aventurer et franchir les sept écluses sur son trajet étroit. L'ouverture du canal de Lachine accentue le rôle de Montréal comme plaque tournante des échanges en Amérique du Nord et lieu de rencontre du commerce transatlantique et de la navigation intérieure. Pour répondre à la croissance du trafic, le canal est rénové à deux reprises. De 1843 à 1848, son gabarit est doublé à 37 mètres de largeur et 2,8 mètres de profondeur pour rendre l'accès possible aux navires à vapeur. Ce chantier donne lieu à un conflit ouvrier important. L'agrandissement permet de capter de l'énergie hydraulique pouvant faire tourner la machinerie des usines à proximité des écluses. Beaucoup plus ambitieuse, la seconde phase de réfection se tient de 1874 à 1885 et porte les dimensions de la voie navigable à leurs niveaux actuels, soit une largeur 45 mètres et une profondeur moyenne de 4,3 mètres.
Plus qu'une simple voie navigable, le canal de Lachine crée un corridor industriel et contribue à l'urbanisation du sud-ouest de Montréal. Le canal attire des sociétés d'envergure dans la manutention des matières premières (blé, charbon, bois), la fabrication, l'entreposage et la navigation. Son rôle stratégique est renforcé par les liens étroits avec le transport ferroviaire dans la deuxième moitié du XIXe siècle.
Dans les années 1950 et 1960, le canal est de moins en moins utilisé. La taille des navires augmente alors que le gabarit du canal ne peut être élargi. Les manufacturiers, attirés par les opportunités du camionnage, vont progressivement s'établir en bordure des axes autoroutiers. À partir de 1959, la Voie maritime, avec ses écluses de 223 mètres et sa profondeur de 9,1 mètres, permet le contournement des rapides de Lachine par un lien fluvial plus moderne sur la rive sud. Le canal demeure d'abord ouvert pour une poignée entreprises, mais le secteur se désindustrialise. La navigation y cesse le 30 novembre 1970. Dans les décennies suivantes, les établissements industriels sont démolis ou convertis en résidences et bureaux. Depuis 1978, le canal de Lachine est géré par Parcs Canada et transformé en parc linéaire. Le 18 mai 2002, il est rouvert à la navigation récréotouristique.
La construction du canal de Lachine permet de développer la navigation du Saint-Laurent en amont de Montréal. Elle contribue par la suite à l'industrialisation de la métropole.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La ligne du temps du Québec [En Ligne]. https://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
BLIEK, Desmond et Pierre GAUTHIER. « Understanding the Built Form of Industrialization along the Lachine Canal in Montreal ». Urban History Review / Revue d'histoire urbaine. Vol. 35, no 1 (2006), p. 3-17.
DESJARDINS, Pauline. L'organisation spatiale du corridor du canal de Lachine au 19e siècle. Thèse présentée à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Philosophiae Doctor en anthropologie. s.l., Université de Montréal, 1999. 391 p.
DESLOGES, Yvon et Alain GELLY. Le canal de Lachine: du tumulte des flots à l'essor industriel et urbain, 1860-1950. Sillery, Septentrion, 2002. 216 p.
GELLY, Alain. Vapeur, thermoélectricité et hydroélectricité comme force motrice le long du corridor industriel du canal de Lachine, des années 1850 à la Seconde Guerre mondiale. Université Laval, 2010. 331 p.
MCNALLY, Larry. « The Relationship between Transportation and Water Power on the Lachine Canal in the Nineteenth Century ». JARRELL, Richard A., dir. et Arnold E. ROOS, dir. Critical Issues in the History of Canadian Science, Technology and Medicine. Thornhill, HSTC Publications, 1983, p. 76-88.
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
STEVENS, George Roy. Ogilvie, pionniers de la meunerie au Canada, 1801-1951. Montréal, 1951. 72 p.
WILLIS, John. « Le Canal de Lachine jusqu'en 1870: origine et fonction d'un canal hydraulique ». s.a. Traditions maritimes au Québec. Québec, Commission des biens culturels du Québec, 1985, p. 471-492.
WILLIS, John. The Lachine Canal, 1840-1900 : preliminary report. Ottawa, Parcs Canada, 1983. 191 p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Première séance du Conseil municipal de Montréal
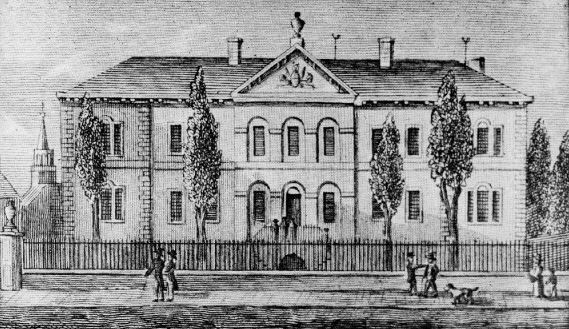
La première séance du Conseil municipal de la Ville de Montréal a lieu le 5 juin 1833 dans le Palais de justice.
Des pressions sont exercées concurremment par le Parti patriote et les Tories pour doter Montréal d'institutions politiques électives qui mettraient fin au régime des juges de paix, en place depuis 1764. L'Acte pour incorporer la Cité de Montréal est sanctionné le 5 juin 1832 et entre en vigueur le 1er mai 1833. La charte est valable pour une durée de trois ans.
Le territoire de la municipalité est divisé en huit quartiers, deux pour la vieille ville (Est, Ouest) et six pour les faubourgs (Sainte-Anne, Saint-Joseph, Saint-Antoine, Saint-Laurent, Saint-Louis et Sainte-Marie). Chacun de ces quartiers est représenté par deux conseillers ayant un mandat de deux ans. La moitié du Conseil est renouvelée chaque année. Les élections municipales sont fixées le premier lundi de juin. Quant au maire, il est choisi par et parmi les conseillers élus, lors de la première séance du Conseil municipal.
De premières élections sont organisées le 3 juin 1833. Le droit de vote est réservé aux propriétaires masculins de plus de 21 ans qui résident à Montréal depuis au moins un an avant la tenue des élections. Le nombre d'électeurs ne correspond donc qu'au cinquième de la population masculine recensée dans la ville. Tous les conseillers sont élus sans opposition, sauf dans le quartier Sainte-Anne où quatre candidats s'affrontent.
Les seize élus, neuf anglophones et sept francophones, ont un profil socioéconomique commun. Ils émanent en grande partie du milieu des affaires et des professions libérales. À la première séance du Conseil municipal, le 5 juin 1833, les conseillers s'entendent à l'unanimité pour nommer Jacques Viger maire de Montréal. Inspecteur des chemins depuis 1813, Viger à une connaissance inégalée de la situation de la ville. En 1825, c'est d'ailleurs lui qui a fait le recensement des habitants de l'île de Montréal avec Louis Guy.
Le Conseil municipal est responsable de la gestion quotidienne de la ville et peut adopter des règlements à cet effet. Comme les juges de paix le faisaient auparavant, il gère le budget, planifie et fait réaliser des travaux de voirie, contrôle les marchés publics, dirige les services de sécurité et règlemente l'hygiène publique. Il peut exproprier et emprunter pour mener à bien des projets d'infrastructures.
La charte n'est pas renouvelée en 1836 parce que, à cause des troubles politiques au Bas-Canada, le Parlement ne siège pas. Le gouvernement britannique rend donc le pouvoir aux juges de paix. L'autonomie de la Ville de Montréal est acquise seulement en 1840 quand une nouvelle charte municipale est octroyée. Sous le régime de la première charte, les conseillers se concentrent surtout sur la mise en place des structures de fonctionnement de la municipalité. On leur doit également deux réalisations : la création des armoiries de la Ville et le début du drainage des faubourgs pour y faire du lotissement.
La première séance du Conseil municipal de Montréal s'inscrit dans le processus de naissance de la démocratie municipale au Québec.
BOURASSA, Guy, dir. et Jacques LÉVEILLÉ, dir. Le système politique de Montréal. Montréal, ACFAS, 1986. s.p.
BOURASSA, Guy. « Les élites politiques de Montréal: de l'aristocratie à la démocratie ». LEMIEUX, Vincent, dir. Personnel et partis politiques au Québec - aspects historiques. Montréal, Boréal Express, 1982, p. 255-276.
DAGENAIS, Michèle. La démocratie à Montréal de 1830 à nos jours. Montréal, Ville de Montréal, 1992. 52 p.
FYSON, Donald. « La gouvernance municipale avant la municipalité : Montréal, 1760-1840 ». ROBICHAUD, Léon, dir. La gouvernance montréalaise : de la ville-frontière à la métropole. Montréal, Éditions Multimondes, 2014, p. 25-42.
PERRAULT, Claude. « La première élection municipale de Montréal ». Cahiers gen-histo. Vol. II (s.d.), p. 54-57.
ROBERT, Jean-Claude. « Viger, Jacques ». Université Laval/University of Toronto. Dictionnaire biographique du Canada [En ligne]. http://www.biographi.ca/
STE CROIX, Lorne. The first incorporation of the City of Montreal, 1826-1836. Mémoire de M.A. (histoire), Université McGill, 1971. 256 p.
Ville de Montréal. L’incorporation de Montréal [En Ligne]. http://www2.ville.montreal.qc.ca/archives/democratie/democratie_fr/expo/incorporation/premiere-charte/index.shtm.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Banquet de la fête de la Saint-Jean-Baptiste de 1834

Le 24 juin 1834, près de 60 personnes se réunissent sur la propriété de l'avocat Jean-François-Marie-Joseph MacDonell pour célébrer le premier banquet de la fête nationale de la Saint-Jean-Baptiste. Cet événement est considéré comme l'acte de fondation de la fête nationale du Québec.
La Saint-Jean-Baptiste était déjà célébrée dans la vallée du Saint-Laurent pendant la période de la Nouvelle-France. Elle ponctuait généralement le début des travaux agricoles de l'été. C'est au XIXe siècle que la fête de la Saint-Jean-Baptiste prend une dimension nationale et identitaire. L'un des protagonistes de cette première manifestation patriotique et des suivantes est Ludger Duvernay, propriétaire de La Minerve et figure importante du mouvement patriote au Bas-Canada.
Duvernay participe à la fondation en mars 1834 de la société patriotique « Aide toi, le Ciel t'aidera ». Elle se donne le mandat de consacrer saint Jean Baptiste comme le saint patron des Canadiens français et de faire de sa fête patronale une fête nationale. Cette initiative prend forme quelques semaines après l'étude des 92 résolutions à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada, soit au début de la radicalisation politique du mouvement patriote. Il est mené par un groupe de personnes relativement unies sur la question des réformes parlementaires, constitutionnelles et démocratiques.
Le 24 juin 1834, des notables proches du Parti patriote se réunissent pour participer au premier banquet de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. En plus de Duvernay, Thomas Storrow Brown, Clément-Charles Sabrevois de Bleury, Louis Hippolyte LaFontaine, Edmund Bailey O'Callaghan, George-Étienne Cartier et le maire Jacques Viger sont présents parmi les convives. Des discours sont prononcés et des hommages sont portés au peuple, aux 92 résolutions et aux réformistes de différentes nations. La soirée se déroule dans un décor orné des symboles de la feuille d'érable et du castor, respectivement choisis pour leur puissance d'évocation du territoire et de l'importance de la traite des fourrures dans l'édification nationale. Un compte rendu de la soirée est publié dans le journal La Minerve le surlendemain. Cet événement consacre une importante association : saint Jean Baptiste est déclaré le saint patron des Canadiens français, et sa fête patronale, celle de la collectivité.
L'initiative est reconduite le 24 juin des années suivantes et s'étend à d'autres localités. L'idée d'instituer une fête nationale pour les Canadiens français gagne en popularité jusqu'en 1837, alors qu'éclatent les rébellions patriotes. Les festivités reprennent pour de bon à Québec en 1842 et à Montréal en 1843, sous la gouverne cette fois de leur Société Saint-Jean-Baptiste respective. Ces organismes bénéficient du soutien du clergé catholique qui accroît l'envergure et la charge spirituelle de la fête. Il est dès lors bien établi que la Saint-Jean-Baptiste est la fête nationale des Canadiens français.
Au fil du temps, la fête gagne en ampleur et en popularité. Elle évolue avec la société qu'elle célèbre, tant en regard de ses référents que dans ses conceptions nationales. Elle subsiste à la mutation identitaire qui s'effectue dans les années 1960, alors que l'identité canadienne-française est progressivement remplacée par l'identité québécoise, plus étroitement liée au territoire du Québec, et dans laquelle la religion catholique est de moins en moins présente.
En 1977, l'Assemblée nationale adopte une loi qui prévoit que le 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste, est le jour de la fête nationale du Québec, et que cette journée est dorénavant fériée et chômée.
Cet événement historique est désigné pour les motifs suivants:
« Le premier banquet de la fête de la Saint-Jean-Baptiste est tenu à Montréal, le 24 juin 1834, dans le jardin de la propriété de l'avocat Jean-François-Marie-Joseph MacDonell. La Saint-Jean-Baptiste était déjà célébrée dans la vallée du Saint-Laurent pendant la période de la Nouvelle-France, mais c'est seulement avec le banquet de 1834 qu'elle prend une dimension identitaire. C'est Ludger Duvernay, propriétaire de La Minerve et président de la société « Aide-toi, le Ciel t'aidera », l'ancêtre de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui souhaite rassembler les Canadiens de l'époque autour d'une fête nationale annuelle à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste. Le 24 juin 1834, environ 60 notables se réunissent ainsi pour participer au premier banquet de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. En plus de Duvernay, Thomas Storrow Brown, Clément-Charles Sabrevois de Bleury, Louis-Hippolyte LaFontaine, Edmund Bailey O'Callaghan, George-Étienne Cartier et le maire Jacques Viger sont présents parmi les convives. Dans un décor orné des symboles de la feuille d'érable et du castor, les invités entonnent des chants patriotiques, prononcent des discours et rendent des hommages au peuple, aux 92 résolutions et aux réformistes de différentes nations. La manifestation est reconduite au cours des années suivantes, et s'étend à d'autres localités. Interrompues pendant les rébellions du Bas-Canada de 1837 et de 1838, les festivités reprennent pour de bon à Québec en 1842 et à Montréal en 1843. Au fil des décennies, la fête de la Saint-Jean-Baptiste gagne en popularité et son sens évolue avec les mutations identitaires de la collectivité qu'elle célèbre. La fête des personnes de nationalité canadienne-française devient ainsi la fête nationale du Québec et de l'ensemble de ses citoyens, tel que reconnu en 1977 par l'Assemblée nationale. Le banquet de la fête de la Saint-Jean-Baptiste de 1834 organisé par Ludger Duvernay et la société « Aide-toi, le Ciel t'aidera » s'impose désormais comme l'acte de fondation de la fête nationale du Québec. »
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La ligne du temps du Québec [En Ligne]. https://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
LAMONDE, Yvan. Histoire sociale des idées au Québec 1760-1896. Montréal, Fides, 2000. 572 p.
LEBEL, Jean-Marie. « Duvernay, Ludger ». Université Laval/University of Toronto. Dictionnaire biographique du Canada [En ligne]. http://www.biographi.ca/
OUIMET, Marc. Le lys en fête, le lys en feu : la Saint-Jean-Baptiste au Québec de 1960 à 1990. Université du Québec à Montréal, 2011. 192 p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Rébellions des patriotes du Bas-Canada

Les rébellions de 1837-1838 au Bas-Canada sont des soulèvements armés qui opposent les patriotes à l'armée britannique, renforcée de volontaires loyaux. Cet événement constitue l'aboutissement de la crise politique née du désir du Parti patriote, dirigé par Louis-Joseph Papineau, de réformer le système de gouvernement du Bas-Canada.
Au printemps 1837, à la suite de l'adoption par le Parlement britannique des résolutions Russell, qui rejettent définitivement les réformes proposées par la Chambre d'assemblée du Bas-Canada, les moyens constitutionnels de réformer les institutions politiques de la colonie semblent épuisés. Pour tenter de dénouer l'impasse et se protéger les uns des autres, les patriotes et les bureaucrates font provision d'armes. Le pouvoir colonial, fort de l'appui de l'évêque de Montréal, mobilise l'armée et interdit les assemblées dites séditieuses, mais plusieurs auront lieu pendant l'été et l'automne. Dans un climat de violence croissant, le premier affrontement d'importance éclate à Montréal le 6 novembre 1837 entre les Fils de la liberté, une association politique et paramilitaire regroupant de jeunes patriotes, et le Doric Club, une association de loyaux radicaux.
Afin de prévenir l'insurrection appréhendée, le gouvernement colonial lance des mandats d'arrestation contre 26 dirigeants patriotes, accusés de haute trahison. Pour faciliter leur capture et écraser un éventuel soulèvement armé, le commandant britannique, John Colborne, dépêche ses troupes dans les comtés de Richelieu et de Deux-Montagnes. Les patriotes affrontent les troupes coloniales et remportent la bataille de Saint-Denis, mais sont défaits à Saint-Charles, à Saint-Eustache et à Moore's Corner. Entre-temps, la loi martiale est proclamée dans le district de Montréal. Des centaines de patriotes sont emprisonnés, tandis que d'autres se réfugient aux États-Unis. En guise de représailles, les volontaires loyaux exercent une importante répression dans les villages qui se sont soulevés.
Pour faire le point, les chefs patriotes exilés aux États-Unis se réunissent à Middlebury, dans l'État du Vermont, le 2 janvier 1838. Sous la direction de Robert Nelson, ils conviennent de s'emparer du Bas-Canada par les armes. Louis-Joseph Papineau, qui prône la modération, est écarté de la chefferie du groupe. Le 28 février, les patriotes exilés proclament la république du Bas-Canada à Caldwell's Manor. Au cours des mois qui suivent, Nelson fonde une association militaire secrète, les Frères chasseurs, et recrute des combattants.
En mai 1838, John George Lambton (lord Durham), nommé gouverneur en chef des colonies de l'Amérique du Nord britannique, arrive à Québec pour enquêter sur les rébellions et proposer des solutions à la crise politique des Canadas. Il fait déporter 8 chefs patriotes aux Bermudes et interdit le retour au pays de 16 autres exilés aux États-Unis, dont Papineau.
Au mois de novembre 1838, les Frères chasseurs lancent leur offensive, qui est coordonnée avec celle des rebelles du Haut-Canada. Le plan d'attaque s'avère toutefois trop ambitieux pour être réalisé. Désorganisés et mal approvisionnés, les Frères chasseurs dirigés par Nelson sont mis en déroute par les volontaires loyaux pendant les batailles de Lacolle et d'Odelltown. La répression qui suit l'épisode insurrectionnel de 1838 est tout aussi sévère que celle de 1837. Des maisons et des fermes sont pillées et incendiées, des centaines de patriotes sont emprisonnés, 58 sont déportés en Australie et 12 sont exécutés.
Lord Durham dépose son rapport à Londres en 1839. Il propose l'union législative du Haut et du Bas-Canada en une seule province, l'assimilation des Canadiens et l'octroi de la responsabilité ministérielle. L'Acte d'union, qui est inspiré du Rapport Durham, est adopté par le Parlement britannique en 1840 et est mis en vigueur l'année suivante.
Assemblée nationale du Québec. Par ici la démocratie. Ligne du temps [En Ligne]. http://paricilademocratie.com/
BLAIS, Christian, Gilles GALLICHAN, Frédéric LEMIEUX et Jocelyn SAINT-PIERRE. Québec: quatre siècles d'une capitale. Québec, Assemblée nationale du Québec - Les Publications du Québec, 2008. 692 p.
BUCKNER, P.A. « Rébellions de 1837 ». Historica Canada. L'encyclopédie canadienne [En ligne]. http://canadianencyclopedia.com/
DAVID, Laurent-Olivier. Les Patriotes de 1837-1838. Montréal, E. Sénécal, 1884. 299 p.
LACOURSIÈRE, Jacques. Histoire populaire du Québec. Vol. 2: De 1791 à 1841. Québec, Septentrion, 1996. 446 p.
LAPORTE, Gilles. Patriotes et loyaux : leadership régional et mobilisation politique de 1837 et 1838. Sillery, Septentrion, 2004. 414 p.
SENIOR, Elinor Kyte. Les habits rouges et les patriotes. Montréal, VLB, 1997. 310 p.
SIMARD, Marc. Papineau et les Patriotes de 1837. Agincourt, La Société Canadienne du Livre Limitée, 1983. 71 p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Bataille de Saint-Denis

La bataille de Saint-Denis est un événement des rébellions de 1837-1838. Elle a lieu le 23 novembre 1837 à Saint-Denis (Saint-Denis-sur-Richelieu), un village situé sur la rive sud de la rivière Richelieu. Elle oppose un groupe composé de 200 miliciens patriotes et de 600 civils sans armes, dirigé par le docteur Wolfred Nelson, à un contingent de 300 soldats de l'armée britannique, dirigé par le lieutenant-colonel Charles Stephen Gore.
Au mois de novembre 1837, la crise amorcée par la réponse négative de la Grande-Bretagne aux revendications patriotes atteint un point culminant. Le 6 novembre 1837, une bagarre éclate dans les rues de Montréal entre les Fils de la liberté et le Doric Club. Dix jours plus tard, le gouvernement lance des mandats d'arrestation contre 26 chefs patriotes. Plusieurs d'entre eux choisissent alors de quitter Montréal pour se réfugier dans les campagnes. Louis-Joseph Papineau et Edmund Bailey O'Callaghan, après un arrêt à Varennes, se rendent à Saint-Denis.
Sir John Colborne, le commandant en chef des forces armées dans les deux Canadas, décide d'envoyer deux détachements de l'armée pour arrêter les chefs patriotes visés par les mandats d'arrestation. Croyant que la plupart des chefs se trouvent à Saint-Charles (Saint-Charles-sur-Richelieu), un premier détachement, mené par le commandant George A. Wetherall, prend la route du sud par Chambly. Un second, dirigé par Charles Stephen Gore, prend la route du nord en direction de Sorel (Sorel-Tracy).
Papineau et O'Callaghan, qui ont rejoint Nelson à Saint-Denis, organisent alors la résistance aux arrestations prévues dans ce village et celui de Saint-Charles. Ils mettent en place des camps et ils réquisitionnent des armes. Au matin du 23 novembre, alors que le détachement de Gore se trouve à proximité de Saint-Denis, Papineau et O'Callaghan quittent le village en direction de Saint-Hyacinthe.
Lorsque l'armée de Gore arrive à proximité de Saint-Denis, les soldats sont épuisés par une marche qui a duré toute la nuit, le froid et la pluie. De leur côté, les patriotes ont vu venir les troupes et plusieurs sont barricadés dans des bâtiments de pierre à l'entrée du village. La bataille tourne à l'avantage des patriotes, qui bénéficient de l'effet de surprise et d'un meilleur positionnement stratégique. Après environ six heures de combat, Gore sonne la retraite. Les pertes des patriotes s'élèvent à douze morts et sept blessés, tandis que les Britanniques comptent six morts, dix blessés et six disparus.
La bataille de Saint-Denis est la seule victoire des patriotes durant les rébellions de 1837-1838. Elle est suivie par leurs défaites lors des batailles de Saint-Charles (25 novembre) et de Saint-Eustache (14 décembre). Par la suite, plusieurs patriotes se réfugient aux États-Unis où ils s'organisent autour du docteur Robert Nelson.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La ligne du temps du Québec [En Ligne]. https://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
FILTEAU, Gérard. Histoire des Patriotes. Sillery, Septentrion, 2003. 628 p.
LAPORTE, Gilles. Patriotes et loyaux : leadership régional et mobilisation politique de 1837 et 1838. Sillery, Septentrion, 2004. 414 p.
SENIOR, Elinor Kyte. Les habits rouges et les patriotes. Montréal, VLB, 1997. 310 p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Bataille de Saint-Eustache

La bataille de Saint-Eustache est un événement des rébellions de 1837-1838. Elle a lieu le 14 décembre 1837 à Saint-Eustache, un village situé au nord-ouest de Montréal. Elle oppose des patriotes à l'armée britannique, aidée de volontaires loyaux.
Après avoir pacifié le sud de Montréal, le commandant en chef des forces armées pour le Haut et le Bas-Canada, sir John Colborne, décide d'attaquer la région des Deux-Montagnes. Selon ses informateurs, les patriotes y seraient très bien organisés. Il prépare donc son offensive en conséquence. Il recrute des volontaires de Montréal et de la région de Deux-Montagnes. Il mobilise aussi plusieurs régiments de l'armée en vue de l'attaque. Au matin du 13 décembre 1837, c'est près de 1500 soldats et volontaires qui convergent vers le village de Saint-Eustache.
Les patriotes du comté des Deux-Montagnes sont organisés en deux camps. À Saint-Eustache, ils sont dirigés par le suisse Amury Girod et le docteur Jean-Olivier Chénier. Des villageois et des patriotes venus de Montréal sont regroupés dans des camps aux abords du noyau institutionnel du village. Les effectifs varient de jour en jour.
Colborne envoie un groupe de volontaires, dirigés par le capitaine Maximilien Globensky, passer par le village de Sainte-Dorothée. Le reste de l'armée traverse la rivière des Mille-Îles en aval de Saint-Eustache. Lorsqu'il aperçoit le groupe de volontaires dirigé par Globensky, Chénier se lance à leur poursuite sur la rivière gelée. Colborne profite du fait qu'ils sont à découvert pour tirer des coups de canon dans leur direction. Chénier et son groupe se replient alors au centre du village. Dès lors, c'est la débandade chez les patriotes. Plusieurs prennent la fuite tandis que d'autres se réfugient dans l'église et des bâtiments institutionnels à proximité. L'armée et les volontaires loyaux encerclent le village et arrêtent de nombreux fuyards. À un moment, des militaires ou des volontaires allument des foyers d'incendie dans le presbytère, le couvent puis l'église. Les patriotes sont alors pris au piège dans l'église en flamme. Plusieurs s'enfuient et sont aussitôt arrêtés par l'armée. L'un des derniers à sortir de l'église est le chef Jean-Olivier Chénier, qui est aussitôt abattu.
Au cours des heures qui suivent, le village de Saint-Eustache est pillé et incendié. La bataille a fait près de 70 morts et plus d'une centaine de prisonniers patriotes. Dès le lendemain, l'armée dirigée par sir John Colborne se dirige vers le village de Saint-Benoît pour y arrêter les principaux chefs du comté des Deux-Montagnes.
BERNARD, Jean-Paul. « Bataille de Saint-Eustache ». Historica Canada. L'encyclopédie canadienne [En ligne]. http://www.thecanadianencyclopedia.com/
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La ligne du temps du Québec [En Ligne]. https://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
SENIOR, Elinor Kyte. Les habits rouges et les patriotes. Montréal, VLB, 1997. 310 p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Bataille d'Odelltown

La bataille d'Odelltown est un événement des rébellions de 1837-1838. Elle se déroule le 9 novembre 1838 à Odelltown (Lacolle), situé au sud-est de Montréal. Elle oppose un groupe de frères chasseurs, mené par Robert Nelson, Médard Hébert et Charles Hindenlang, à des volontaires loyaux, dirigés par le lieutenant-colonel Charles Cyril Taylor et le lieutenant Lewis Odell.
Après les batailles de 1837, des chefs patriotes s'exilent aux États-Unis. Un groupe de patriotes radicaux s'organise autour du docteur Robert Nelson. Pour obvier au manque d'organisation qui a mené à l'échec de l'incursion des patriotes au Bas-Canada au mois de février, l'Association des frères chasseurs est créée en mars 1838. Elle projette d'envahir le Bas-Canada par les armes et d'en proclamer l'indépendance. Elle passe à l'offensive au début du mois de novembre 1838. Après avoir pris la seigneurie de Beauharnois, certains membres de l'association retournent aux États-Unis pour se procurer des armes.
Dans les villages avoisinant la frontière américaine, des volontaires loyaux se sont organisés en milice pour contrer la menace insurrectionnelle. Le 9 novembre 1838, environ 700 frères chasseurs se dirigent vers Odelltown, où quelque 200 volontaires loyaux se réfugient dans l'église méthodiste. Les frères chasseurs assiègent l'église mais, après quelques heures, des volontaires loyaux en provenance d'Hemmingford et de L'Île-aux-Noix viennent en renfort et les obligent à se disperser. Les pertes sont relativement faibles d'un côté comme de l'autre.
La bataille d'Odelltown est la dernière bataille des rébellions de 1837-1838. De nombreux frères chasseurs sont emprisonnés à la suite de l'insurrection. Plusieurs participants à la bataille sont ensuite condamnés à mort par un tribunal militaire.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La ligne du temps du Québec [En Ligne]. https://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
COURNOYER, Jean. La mémoire du Québec: de 1534 à nos jours: répertoire de noms propres. Montréal, Stanké, 2001. 1861 p.
SENIOR, Elinor Kyte. Les habits rouges et les patriotes. Montréal, VLB, 1997. 310 p.
s.a. Patrimoine militaire canadien [En Ligne]. http://www.cmhg.gc.ca/cmh/fr/page_1.asp
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Émeutes de Montréal

Depuis les années 1820, la Grande-Bretagne accorde des taux préférentiels aux importations coloniales par rapport à ceux des autres pays. Cette politique a pour effet de créer un important marché d'exportation céréalière en Amérique du Nord britannique. Les marchands canadiens profitent de ces dispositions législatives pour s'enrichir. En 1846, la Grande-Bretagne abroge les lois sur les céréales (Corn Laws) pour favoriser le libre-échange. Le commerce céréalier encaisse un dur coup et les profits des marchands diminuent considérablement. La grogne se fait sentir parmi la communauté marchande de Montréal, ville mi-anglophone, mi-francophone, où siège le gouvernement depuis 1845.
En 1848, l'abandon des politiques mercantilistes, conjugué au retour d'une majorité réformiste à la Chambre d'assemblée, amène la Grande-Bretagne à consentir à l'avènement du gouvernement responsable dans la colonie. Les Tories, relégués dans l'opposition et dépossédés de leur influence politique, se sentent menacés par l'influence grandissante des Canadiens français au gouvernement.
La tension monte à l'occasion de la lecture en français du discours du trône par le gouverneur général du Canada, Lord Elgin (James Bruce), à l'ouverture de la session en janvier 1849. Elle atteint son paroxysme le 25 avril lorsqu'il sanctionne le projet de loi parrainé par les réformistes sur l'indemnisation des victimes des rébellions de 1837-1838 dans le Bas-Canada. Vivement dénoncée par les Tories, cette loi, quoiqu'elle dédommage ceux qui ont souffert des rébellions et non ceux qui y ont participé, est vue comme une prime à la révolte et comme la confirmation de la domination politique des Canadiens français. Dans la capitale, des assemblées de protestation sont aussitôt organisées. Le gouverneur est accueilli par des oeufs pourris et des pierres lancés par les protestataires. La manifestation tourne à l'émeute dans la soirée lorsqu'une partie de la foule évaluée à plus de 1 500 personnes envahit le parlement et met le feu à l'édifice qui est réduit en cendres, de même que 22 000 volumes et la totalité des archives parlementaires.
Les troubles durent encore quelques mois. Le 15 août, les autorités procèdent à l'arrestation de cinq individus responsables de l'incendie du parlement. Malgré la libération de quatre d'entre eux, 200 émeutiers se rassemblent dans la soirée. Ils décident d'attaquer la résidence du ministre réformiste Louis-Hippolyte La Fontaine où un échange de coups de feu fait une victime du côté des rebelles. Lors de l'enquête du coroner, au moment où La Fontaine s'apprête à témoigner devant jurés à l'hôtel Cyrus, sur la place Jacques-Cartier, des individus mettent le feu à l'édifice.
Conséquemment aux émeutes de Montréal, la capitale du Canada-Uni alternera entre Toronto et Québec. Les marchands anglophones montréalais se sentent quant à eux abandonnés par l'Angleterre à la suite du refus de réprouver la loi d'indemnisation. Comme solution aux problèmes politiques et économiques de la colonie, ils se font les promoteurs de l'annexion aux États-Unis.
Assemblée nationale du Québec. Par ici la démocratie. Ligne du temps [En Ligne]. http://paricilademocratie.com/
BERNARD, Jean-Paul. « Émeutes de Montréal ». Historica Canada. L'encyclopédie canadienne [En ligne]. http://www.thecanadianencyclopedia.com/
BLAIS, Christian, Gilles GALLICHAN, Frédéric LEMIEUX et Jocelyn SAINT-PIERRE. Québec: quatre siècles d'une capitale. Québec, Assemblée nationale du Québec - Les Publications du Québec, 2008. 692 p.
LAPORTE, Gilles. Les Patriotes de 1837@1838 : les rébellions du Bas-Canada [En Ligne]. http://cgi2.cvm.qc.ca/glaporte/1837.pl?out=menu
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
Ville de Montréal. Centre d'histoire de Montréal. "Le Parlement brûle!". Montréal Clic [En Ligne]. http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2497,3090359&_dad=portal&_schema=PORTAL
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Sanction de la loi révoquant le droit de vote des femmes dans la province

Durant la session parlementaire de 1849, le Parlement de la province du Canada apporte plusieurs amendements à la loi électorale, notamment l’interdiction du suffrage féminin dans tous les types d’élections. Cette loi est sanctionnée le 30 mai de la même année. Peu importe leur statut, toutes les femmes de la colonie perdent formellement le droit de voter. Depuis l’Acte constitutionnel de 1791, les candidats et les électeurs devaient être âgés de 21 ans ou plus, être sujets britanniques et propriétaires ou locataires payants, et ce, sans distinction de sexe. C’est donc par omission que certaines femmes pouvaient voter au Bas-Canada alors qu’elles ne pouvaient pas exercer ce droit ni en Angleterre ni dans le Haut-Canada. Après des décennies de luttes de la part des suffragettes, ce n’est qu’en 1940 que le droit de vote et d’éligibilité est accordé aux femmes de la province de Québec par le Parlement, sous l’impulsion du gouvernement libéral d’Adélard Godbout.
Assemblée nationale du Québec. Chronologie parlementaire depuis 1764 [En Ligne]. https://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/chronologie/index.html
Assemblée nationale du Québec. Par ici la démocratie. Ligne du temps [En Ligne]. http://paricilademocratie.com/
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La ligne du temps du Québec [En Ligne]. https://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
Conseil du statut de la femme et Réseau québécois en études féministes. Ligne du temps de l’histoire des femmes au Québec [En Ligne]. http://www.histoiredesfemmes.quebec/
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Inauguration du pont Victoria

Construit par la Compagnie du Grand Tronc de chemin de fer du Canada, le pont Victoria traverse le fleuve Saint-Laurent entre le secteur montréalais de Pointe-Saint-Charles et la municipalité de la paroisse de Saint-Lambert. Il est inauguré le 25 août 1860 par le Prince de Galles, futur roi Édouard VII.
L'idée de relier Montréal à la rive sud émerge dans le cadre du développement ferroviaire. Les traversiers ne suffisent plus pour que Montréal conserve son rôle de plaque tournante des échanges, d'autant plus qu'ils ne fonctionnent pas en hiver.
Le projet de construction du pont Victoria est lancé en 1851 et on confie la réalisation des plans à l'ingénieur Thomas Keefer. Ce dernier remet une étude préliminaire au printemps 1852 et soulève des contraintes techniques, dont la force des eaux, le mouvement des glaces et les crues printanières. En 1853, le Grand Tronc reprend le projet avec le soutien financier du gouvernement. Les plans sont peaufinés par les ingénieurs Robert Stephenson, James Hodges et Alexander Ross. Les travaux, réalisés par la firme britannique Peto, Brassey & Betts, sont inaugurés le 24 mai 1854. On choisit l'option d'un pont tubulaire plutôt qu'à treillis pour ses gains en matériaux. Les ingénieurs se prononcent en faveur du tracé de Pointe-Saint-Charles à Saint-Lambert en raison de ses avantages topographiques et du raccordement prévu avec les installations de la compagnie ferroviaire.
Au moment de sa construction, le pont Victoria est le plus long pont tubulaire d'une seule voie au monde. Un système d'alternance permet aux trains de circuler à tour de rôle. Il s'étend sur 2,7 kilomètres et possède une hauteur de 18,3 mètres au maximum. Érigés en premier dans des caissons étanches, les piliers sont formés de blocs de calcaire. Ils adoptent une forme pointue pour briser les glaces. Le tube de circulation en fer, préfabriqué en Angleterre et assemblé sur le chantier, se divise en 25 travées pour diminuer la force exercée par le courant sur les piliers. Les approches sont érigées en remblai. Plus de 3000 ouvriers, surtout des immigrants irlandais et des Mohawks de Kahnawake, travaillent sur le chantier. Le pont est achevé le 24 novembre 1859 et testé une première fois le 12 décembre.
En 1860, le prince de Galles vient en Amérique du Nord britannique. C'est la première visite royale officielle. Le 25 août 1860, il inaugure le pont Victoria à Montréal, considéré alors comme la 8e merveille du monde. Sa venue donne lieu à des célébrations grandioses. Les bâtiments sont illuminés et de nombreux touristes se déplacent pour l'occasion. Une fois les cérémonies protocolaires achevées, le prince se rend sur le pont pour y déposer symboliquement une pierre de calcaire et enfoncer le dernier rivet du tube ferroviaire. L'inauguration a un écho sur la scène internationale en raison de la taille et du design de l'ouvrage.
Depuis son ouverture, le pont Victoria a été modifié pour s'ajuster aux réalités changeantes des transports. En 1898, la structure tubulaire est remplacée par un tablier à poutres en treillis. Cela permet l'ajout d'une seconde voie ferroviaire et de deux voies latérales. Une ligne de tramways est installée en 1901 sur le côté nord. En 1927, les sections latérales sont élargies pour permettre la circulation des automobiles. Lors de la construction de la Voie maritime du Saint-Laurent en 1958, une voie de contournement est aménagée du côté sud pour laisser passer les paquebots sans compromettre la circulation des voitures.
Le pont Victoria est le premier à franchir le Saint-Laurent. Sa construction renforce l'inscription de la métropole au cœur d'un vaste réseau de transport international.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La ligne du temps du Québec [En Ligne]. https://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
LESSER, Gloria. « En 1860, le Prince de Galles inaugure le pont Victoria ». Vie des arts. Vol. 26, no 105 (1981), p. 38-40.
PASSFIELD, Robert W. « Construction of the Victoria Tubular Bridge ». Canal History and Technology Proceedings. No 20 (2001), p. 5-52.
POUSSART, Annick et Pierre WILSON. Montréal, par ponts et traverses. Montréal, Pointe-à-Callière, musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, 1999. 94 p.
PRATT, Michel. « Le pont tubulaire et ferroviaire Victoria ». Histoire Québec. Vol. 16, no 1 (2010), p. 39-41.
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
RADFORTH, Ian. Royal Spectacle: The 1860 Visit of the Prince of Wales to Canada and the United States. Toronto, University of Toronto Press, 2004. 469 p.
Société historique et culturelle du Marigot. Le pont Victoria et la municipalité de Saint-Lambert [En Ligne]. http://marigot.ca/mobile/Petite-histoire-illustree-de-Longueuil/1845-1874/le-pont-victoria-et-la-municipalite-de-saint-lambert.html
Ville de Montréal. « L'histoire ». Ville de Montréal. L'histoire [En ligne]. http://ville.montreal.qc.ca/siteofficieldumontroyal/histoire
YOUNG, John. The Origin of the Victoria Bridge. Montréal, D. Bentley and Co., 1876. 30 p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Inauguration du parc du Mont-Royal

Le parc du Mont-Royal est inauguré le 24 mai 1876. Situé à Montréal sur le sommet le plus élevé de la montagne du même nom, il a une superficie de 2,14 kilomètres carrés.
L'idée d'aménager un espace vert sur le mont Royal émerge dans les années 1860. Parmi ses promoteurs, on retrouve des politiciens et des hommes d'affaires. Ce parc est vu comme un moyen de s'évader de la ville insalubre et de conserver intact un lieu de prestige. En 1867, un comité échevinal spécial est formé à cette fin. Le financement proviendra de trois sources. Le Conseil municipal obtient en 1869 un amendement à sa charte lui permettant d'emprunter une partie de la somme requise pour l'achat des terrains. Le gouvernement du Québec octroie aussi à la Ville un prêt de 350 000 dollars. Enfin, des fonds privés complètent l'équation grâce au mécénat d'hommes d'affaires anglophones.
À l'hiver 1871-1872, le propriétaire d'un terrain du versant sud y abat tous les arbres. Cette coupe à blanc pousse le Conseil municipal à enclencher sans tarder le processus d'expropriation. Toutefois, les fonds s'épuisent rapidement. Au terme de l'année 1872, les coûts atteignent déjà 550 000 dollars pour l'acquisition de 1,5 kilomètre carré. La Ville demande au gouvernement du Québec un prêt d'un million de dollars pour finaliser les expropriations. C'est une somme colossale à l'époque.
Pour concevoir le parc, le Conseil municipal fait appel aux services de l'architecte-paysagiste Frederick Law Olmsted. En 1854, il réalise l'Elm Park à Worchester au Massachusetts, reconnu comme étant le premier parc municipal en Amérique du Nord. Trois ans plus tard, il accepte de dessiner les plans de Central Park à New York. Olmsted est embauché par la Ville de Montréal en 1874. Son design valorise l'équilibre entre les fonctions récréatives du parc et la nature sauvage qui le compose.
L'inauguration est faite par le maire William H. Hingston le 24 mai 1876, jour de la fête de la Reine Victoria. Elle est précédée par un défilé militaire au centre-ville de Montréal. Les travaux d'aménagement se poursuivent jusqu'en 1881. Le parc devient rapidement un lieu de rencontre pour l'élite montréalaise qui habite à proximité.
Pour faciliter l'accès au sommet, la Ville de Montréal autorise en 1885 une société privée à construire un funiculaire. Le tarif est en revanche onéreux pour les familles ouvrières. Sa démolition en 1918 est une occasion pour la Ville de négocier avec la compagnie de tramways un accès en transport collectif. En 1924, une première ligne fait le lien entre le chemin de la Côte-des-Neiges et le sommet. À partir de 1930, la ligne est prolongée selon un tracé sinueux jusqu'au versant est. Après la disparition des tramways, en 1958, la Ville aménage la voie Camillien Houde, qui devient le chemin Remembrance sur le versant ouest.
Depuis son ouverture en 1876, le parc du Mont-Royal a connu des changements. En 1906, la Ville fait construire un belvédère en hémicycle sur le versant sud. La croix du Mont-Royal, érigée en 1924, devient un attrait incontournable du parc. D'autres installations emblématiques sont construites pour fournir du travail aux chômeurs durant la Grande dépression. C'est le cas du chalet du Mont-Royal et du lac aux Castors, conçus respectivement en 1932 et 1938. À partir de 1980, plusieurs travaux de restauration et d'aménagement sont réalisés. Le parc est un pôle touristique majeur à Montréal et un lieu apprécié des Montréalais pour ses fonctions récréatives, culturelles et commémoratives.
La création du parc du Mont-Royal est la première initiative publique au Québec visant à protéger un espace naturel pour le rendre accessible à la population. En 2005, le gouvernement du Québec l'inclut dans la déclaration du site patrimonial du Mont-Royal.
DEBARBIEUX, Bernard. « Le Mont Royal, court essai de géographie historique et culturelle ». BRYANT, Christopher R., dir. et Claude MANZAGOL, dir. Montréal 2001: visages et défis d'une métropole. Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 1998, p. 295-301.
DEBARBIEUX, Bernard et Claude MAROIS. « Le mont Royal. Forme naturelle, paysages et territorialités urbaines ». Cahiers de géographie du Québec. Vol. 41, no 113 (1997), p. 171-197.
DROUIN, Martin. « L’appropriation d’un espace urbain : le mont Royal ». Cap-aux-diamants. Vol. 110 (2012), p. 54-55.
KREDL, Lawrence Peter. The Origin and Development of Mount Royal Park, Montreal 1874-1900: Ideal vs Reality. York University, 1983. 189 p.
Les amis de la montagne. Le Mont-Royal [En Ligne]. https://www.lemontroyal.qc.ca/fr
MARCHAND, Denys. « Une petite chronique aléatoire du mont Royal ». Trames. Vol. 2, no 1 (1989), p. 36-49.
MURRAY, A. L. « Frederick Law Olmsted and the Design of Mount Royal Park, Montreal (1874) ». Journal of the Society of Architectural Historians. Vol. 26, no 3 (1967), p. 163-171.
Musée McCord; Bellman, David, Éd. Mont-Royal : Montréal = Mount Royal : Montreal. Ottawa, Racar, 1977. 48 p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Inauguration du Monument-National

Le Monument-National est inauguré au cours des festivités de la Saint-Jean-Baptiste de 1893. L'Association Saint-Jean-Baptiste de Montréal, instigatrice du projet de construction de cet immeuble et responsable de l'organisation de cette fête, lui dédie cette édition de la Saint Jean-Baptiste. Amorcée en 1891, la construction de l'édifice ne sera terminée qu'en 1894. Des centaines de sociétés Saint-Jean-Baptiste, réparties en divers endroits au Canada et aux États Unis, sont conviées à Montréal pour souligner l'inauguration du Monument. Cette convergence se veut représentative du rôle névralgique et rassembleur attribué à l'édifice par ses artisans, selon eux la maison mère de la culture francophone d'Amérique du Nord. Le Monument doit abriter le siège social de l'Association Saint-Jean-Baptiste de Montréal, mais aussi un théâtre, des bureaux, une bibliothèque et des salles de cours, entre autres.
D'abord, une traditionnelle cérémonie d'ouverture de la Saint-Jean-Baptiste a lieu samedi 24 juin dans le parc Sohmer, à Montréal, lieu privilégié des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste de 1889 à 1897. Plusieurs dignitaires s'y trouvent et prennent la parole, notamment Laurent-Olivier David, président de l'Association Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Alphonse Desjardins, maire de Montréal et Honoré Mercier, ancien premier ministre du Québec, accompagné d'autres personnalités et de délégués du gouvernement français.
Le 25 juin en soirée est organisé un banquet entièrement dédié à l'inauguration du Monument-National, dont la finition est loin d'être complétée. La célébration se déroule dans la grande salle du Monument, terminée in extremis et richement décorée pour l'occasion. Les référents à la papauté, à la royauté britannique ainsi qu'à la France fusent dans la décoration et les discours pour cet événement résolument patriotiques. Ces trois éléments sont perçus par plusieurs nationalistes de l'époque comme les fondements de l'identité canadienne-française : la fidélité à la couronne britannique, l'attachement à la culture et à l'héritage français ainsi que l'observation de la religion catholique dans plusieurs sphères de la vie publique et domestique. Comme la cérémonie du parc Sohmer, le banquet réunit le président de l'Association, le maire de Montréal et les délégués du gouvernement français. S'ajoutent à eux, notamment, Wilfrid Laurier ainsi que des juges, des personnalités influentes ainsi que des représentants de communautés francophones des États-Unis et de l'Ouest canadien.
Un grand congrès a lieu, le lendemain 26 juin, au Monument-National. Il rassemble diverses sociétés et associations Saint-Jean-Baptiste d'Amérique du Nord afin d'accroitre leur cohésion sur diverses questions concernant la situation des francophones. Les discussions portent notamment sur la situation des communautés canadiennes-françaises dans le nord-est des États Unis ainsi que sur la question des écoles du Manitoba.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La ligne du temps du Québec [En Ligne]. https://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
LACHAPELLE, Jacques. « Monument National ». Commission des biens culturels du Québec. Les chemins de la mémoire. Monuments et sites historiques du Québec. Tome II. Québec, Les Publications du Québec, 1991, p. 84-86.
LAMONDE, Yvan. Histoire sociale des idées au Québec 1760-1896. Montréal, Fides, 2000. 572 p.
LAMONDE, Yvan et Raymond MONPETIT. Le parc Sohmer de Montréal 1889-1919 : un lieu populaire de culture urbaine. Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1986. 231 p.
LARRUE, Jean-Marc. Le monument inattendu : Le Monument National, 1893-1993. Cahiers du Québec : Histoire, 106. LaSalle, Éditions Hurtubise HMH, 1993. 322 p.
RUMILLY, Robert. Histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal : des Patriotes au Fleurdelisé 1834-1948. Montréal, Les éditions de l'Aurore, 1975. 564 p.
RUMILLY, Robert. Histoire de Montréal. Vol. 3. Montréal, Fides, 1972. 524 p.
s.a. « La fête Saint-Jean-Baptiste ». La Minerve, 26 juin 1893, p. 2.
s.a. « La St-Jean-Baptiste à Montréal ». Le Courrier du Canada, 27 juin 1893, p. 3.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Carnaval d’hiver de Québec de 1894

Le carnaval de Québec de 1894 est considéré comme la première édition d’envergure de cet événement hivernal, qui est récurrent depuis 1955.
À l’automne 1893, Frank Carrel, propriétaire du Quebec Daily Telegraph, lance un appel dans son journal pour qu’un carnaval soit tenu à l’hiver suivant. Il espère ainsi ragaillardir la ville durement touchée par le déclin de ses activités portuaires. Carrel s’inspire du succès rencontré par le carnaval tenu à Montréal l’hiver précédent. Les retombées financières escomptées rallient facilement le milieu des affaires. En peu de temps, un comité organisateur se forme, dans lequel figurent des commerçants en vue comme Zéphirin Paquet et Jean-Baptiste Laliberté. Henri-Gustave Joly de Lotbinière est choisi pour en être le président, et le gouverneur général et son épouse, respectivement lord et lady Aberdeen, se voient décerner la présidence d’honneur.
L’organisation se fait promptement. Le carnaval est inauguré le 29 janvier 1894 et doit se conclure le 3 février. Pour l’occasion, les citoyens embellissent leurs quartiers avec des arches, des sculptures, des statues de glace ainsi que diverses autres structures en neige. Les cérémonies d’ouvertures se tiennent au Palais de glace, conçu selon les plans de l’architecte François-Xavier Berlinguet et situé en face du parlement.
Les loisirs hivernaux sont à l’honneur dans le calendrier des activités. Le carnaval donne lieu à des courses de canots à glace, de raquettes et de chevaux, à des spectacles de patinage artistique, à des parties de hockey, de curling et de souque à la corde. Une mascarade a lieu au Québec Skating Rink, près de la porte Saint-Louis, ainsi qu’un bal du gouverneur au parlement. Une attaque pyrotechnique sur le palais de glace est simulée, dont la défense est assurée par la garnison de Québec. Enfin, un long défilé de chars allégoriques sillonne plusieurs quartiers de la ville.
Le carnaval survient quelques semaines après l’inauguration du Château Frontenac, renforçant ainsi la vocation touristique de Québec. En effet, environ 25 000 visiteurs provenant de l’étranger assistent aux festivités et contribuent à la notoriété de la ville.
Faute de structure organisationnelle permanente, les carnavals subséquents varient en ampleur et en qualité. Pour cette même raison, la régularité annuelle de l’événement n’est pas assurée. Ce n’est qu’en 1955 que la tradition hivernale moderne fait un retour en force et est pérennisée.
JEAN, Michèle et Alyne LEBEL. « Carnaval: la cuvée 1894 ». Cap-aux-diamants. Vol. 1, no 4 (1986), p. 24-29.
LACROIX, Georgette. Le Carnaval de Québec: Une histoire d’amour. Montréal, Les éditions Quebecor, 1984. 199 p.
PROVENCHER, Jean. Le Carnaval de Québec : la grande fête de l’hiver. Sainte-Foy, Québec, Éditions MultiMondes, 2003. 127 p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Fondation de la Caisse populaire de Lévis

La première caisse Desjardins est fondée à Lévis le 6 décembre 1900 par Alphonse Desjardins.
En 1897, alors que Desjardins est sténographe à la Chambre des communes à Ottawa, il assiste à un débat qui lui fait prendre conscience des conséquences de l'usure, soit le fait de prendre un haut taux d'intérêt sur un prêt d'argent. Intéressé par ce sujet, il se documente sur les pratiques usuraires. Alphonse Desjardins lie ce phénomène aux questions sociales qui agitent son époque. Selon lui, l'association et le développement local permettraient de répondre aux maux sociaux, de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des classes populaires et à la libération économique des Canadiens français, en plus de freiner leur exode vers les États-Unis. Il puise ses idées dans les écrits du Britannique William Wolff (People's Banks), des caisses d'épargne et de crédit populaire en Europe et aux États-Unis. Enfin, Desjardins entretient également des relations épistolaires avec des acteurs des mouvements coopératifs et mutualistes. En plus des idées du mouvement coopératif, Alphonse Desjardins s'inspire aussi de la doctrine sociale de l'Église catholique. Ses projets s'inscrivent dans la lignée de l'encyclique papale Rerum novarum sur la condition des ouvriers, publiée en 1891.
Entre 1897 et 1900, il prépare son projet de coopérative de crédit et d'épargne à capital variable et à responsabilité limitée.
Son modèle de caisse populaire s'appuie sur le cadre de la paroisse. Il vise à encourager la pratique et l'attrait de l'épargne, à permettre aux classes populaires d'administrer indépendamment leur propre capital sans l'intervention de l'État et à rendre le crédit plus facilement accessible.
Le 6 décembre 1900, plus de 130 citoyens assistent à l'assemblée de fondation de la Caisse populaire de Lévis, première coopérative d'épargne et de crédit en Amérique du Nord. Celle-ci entre en activité le 23 janvier 1901.
Dorimène Roy-Desjardins, l'épouse d'Alphonse Desjardins, joue un rôle important dans les activités de l'institution. Jusqu'en 1906, Alphonse Desjardins est souvent absent. Il travaille alors à Ottawa comme sténographe français au Parlement et se déplace fréquemment pour donner des conférences. Dorimène Roy-Desjardins s'occupe de la comptabilité de la caisse et partage la fonction de gérant suppléant avec Théophile Carrier. Au cours de ces années, elle participe aussi à la préparation des statuts et des règlements régissant les caisses populaires.
Trois autres caisses sont créées entre 1900 et 1905: Saint-Joseph de Lévis (1902), Hull (1903) et Saint-Malo à Québec (1905). Le soutien du clergé local favorise le développement rapide du réseau des caisses populaires.
Malgré ce développement rapide, l'absence de reconnaissance juridique crée une situation d'incertitude pour les caisses. Pour y remédier, Alphonse Desjardins entreprend plusieurs démarches auprès des gouvernements provincial et fédéral. La situation est finalement régularisée en 1906 avec l'adoption de la Loi concernant les syndicats coopératifs par l'Assemblée législative du Québec. Un an plus tard, un projet de loi sur la coopération est également adopté à la Chambre des communes d'Ottawa, mais il n'est pas entériné par le Sénat, qui estime qu'une telle loi empiéterait sur les juridictions des provinces.
Cette reconnaissance juridique lance l'expansion du réseau des caisses populaires au Québec et en Ontario, ainsi que dans les paroisses franco-américaines de la Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, où elles prennent le nom de Credit Unions. Le mouvement des caisses prend de l'expansion au fil du 20e siècle, se constitue en fédération en 1932 et diversifie ses activités économiques. Toujours en activité, la caisse Desjardins de Lévis célèbre ses 125 ans en 2025.
Conseil du statut de la femme et Réseau québécois en études féministes. Ligne du temps de l'histoire des femmes au Québec [En Ligne]. http://www.histoiredesfemmes.quebec/
LAMBERT, Maude-Emmanuelle et Yves ROBY. « Alphonse Desjardins ». Historica Canada. L'encyclopédie canadienne [En ligne]. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/alphonse-desjardins
LÉVESQUE, Benoît et Martin PETITCLERC. « L’économie sociale au Québec à travers les crises structurelles et les grandes transformations (1850-2008) ». Économie et Solidarités. Vol. 39, no 2 (2008), p. 14-37.
POULIN, Pierre. Histoire du Mouvement Desjardins: La percée des caisses populaires, 1920-1944. Vol. 2. Montréal, Québec/Amérique, 1994. 449 p.
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
s.a. Desjardins, À propos de Desjardins [En Ligne]. http://www.desjardins.com
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Émeutes de la conscription à Québec

Les émeutes de la conscription à Québec s'inscrivent dans le contexte de la participation du Canada à la Première Guerre mondiale. En 1914, la déclaration de guerre de la Grande-Bretagne à l'Allemagne engage le Canada dans le conflit. Durant les premières années de la guerre, les effectifs réguliers de l'armée canadienne et l'enrôlement volontaire suffisent à combler les besoins en hommes. Toutefois, avec le prolongement des affrontements, la nécessité de recruter de nouvelles troupes se fait plus pressante. Le gouvernement fédéral, dirigé par Robert Borden, décide d'enrôler des combattants auprès de la population et adopte, en 1917, la loi sur la conscription rendant le service militaire obligatoire. La mesure est impopulaire dans la province de Québec, où l'armée est vue comme une institution entièrement anglophone. En réaction, de nombreuses manifestations éclatent dans les grandes villes. Le taux élevé de demandes d'exemption et la faiblesse du nombre de conscrits ayant répondu à l'appel résultent en l'envoi de forces policières fédérales au Québec afin de retrouver les hommes qui tardent à se présenter aux bureaux d'enregistrement de l'armée.
À Québec, les manifestations atteignent leur paroxysme au cours de la fin de semaine de Pâques, soit du 28 mars au 1er avril 1918. Le 28 mars, l'arrestation d'un homme n'ayant pas avec lui ses papiers pour prouver son exemption du service militaire provoque une émeute dans le quartier Saint-Roch. Une foule de près de 2 000 personnes attroupée à la place Jacques-Cartier attaque le poste de police où sont réfugiés les agents fédéraux. Le lendemain, le bureau d'enregistrement de l'armée, logé dans l'édifice de l'Auditorium (Capitole), est saccagé et incendié par les émeutiers encouragés par une foule de 20 000 personnes réunie au carré d'Youville (place d'Youville). La population proteste contre le zèle exprimé par les policiers dans la recherche des conscrits récalcitrants. Le 30 mars, devant le manège militaire, les manifestants sont dispersés par la cavalerie. Le lendemain, un contingent de 2 000 soldats en provenance de l'Ontario et de la Nouvelle-Écosse arrive dans la capitale pour prêter main-forte aux autorités municipales et à l'armée locale. Le 1er avril, une confrontation éclate dans le quartier Saint-Roch entre les troupes fédérales et les contestataires. Repoussée à la limite du quartier Saint-Sauveur, la foule refuse de se disperser malgré les ordres des militaires. Les soldats n'hésitent pas à tirer en direction de celle-ci. Bilan de l'altercation: quatre morts, des dizaines de blessés et plus d'une soixantaine de personnes sont arrêtées.
Le 4 avril, la loi martiale, qui suspend les droits civils, est instaurée pour la ville de Québec. Les militaires contrôlent les allées et venues de la population et surveillent tous les endroits stratégiques. Le calme revient progressivement, mais la crise accentue les divisions entre les communautés francophone et anglophone.
L'enquête du coroner, en plus de révéler que les victimes n'étaient pas des manifestants, blâme les autorités et exige des compensations pour les familles des victimes. Ces indemnisations ne viendront jamais.
Assemblée nationale du Québec. Par ici la démocratie. Ligne du temps [En Ligne]. http://paricilademocratie.com/
BLAIS, Christian, Gilles GALLICHAN, Frédéric LEMIEUX et Jocelyn SAINT-PIERRE. Québec: quatre siècles d'une capitale. Québec, Assemblée nationale du Québec - Les Publications du Québec, 2008. 692 p.
LEBEL, Jean-Marie. Québec 1608-2008 : les chroniques de la capitale. Québec, Les Presses de l'Université Laval, 2008. 760 p.
LEBEL, Jean-Marie et Alain ROY. Québec, 1900-2000 : le siècle d'une capitale. Sainte-Foy, Éditions MultiMondes, 2000. 157 p.
VALLIÈRES, Marc, dir. Histoire de Québec et de sa région. Les régions du Québec, 18. Québec, Presses de l'Université Laval, 2008. 2523 p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Fondation du Comité provincial pour le suffrage féminin

Le Comité provincial pour le suffrage féminin est une association militante mise sur pied en janvier 1922 pour l'obtention du suffrage féminin aux élections provinciales québécoises. Sa fondation constitue un jalon important dans l'histoire de la lutte pour l'égalité politique des femmes au Québec.
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la lutte pour le droit de vote des femmes s'intensifie au Québec et au Canada. Depuis 1913, la Montreal Suffrage Association, premier mouvement québécois militant exclusivement pour le suffrage féminin, limite son action au droit de vote des femmes au palier fédéral. Certaines associations féminines, comme la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, réclament ce droit, mais aucune organisation ne se consacre exclusivement à cette cause.
En 1918, les femmes du Québec et du Canada obtiennent le droit de voter aux élections fédérales et, en 1919, de se porter candidate. De 1916 à 1922, les femmes obtiennent le droit de vote dans toutes les provinces canadiennes, sauf au Québec.
La Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste évoque en mars 1920 la fondation d'un « comité de la femme » et d'un « programme civique » pour encourager les Québécoises à participer à la vie citoyenne. L'importante participation des femmes lors du scrutin fédéral du 6 décembre 1921 raffermit l'idée de fédérer les Québécoises autour de la cause du suffrage féminin.
Le 14 janvier 1922, des membres de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste et du Montreal Council of Women tiennent une réunion conjointe au cours de laquelle elles fondent le Comité provincial pour le suffrage féminin. Coprésidé par Marie Lacoste Gérin-Lajoie et Anna Marks Lyman, le Comité transcende les divisions linguistiques et confessionnelles et regroupe plusieurs figures marquantes de l'époque, notamment Carrie Derick, Grace Julia Parker Drummond, Octavia Grace Ritchie England, Idola Saint-Jean et Thérèse Casgrain. Cette rencontre a lieu à la résidence de Mme Gérin-Lajoie, à Montréal.
Le 9 février 1922, une délégation de plus de 400 femmes du Comité se rend au Parlement de Québec pour revendiquer l'obtention du suffrage féminin. À leur demande, le député libéral Henry Miles dépose un premier projet de loi à l'Assemblée législative de la province de Québec pour accorder le droit de vote aux femmes. La députation étant plutôt opposée à cette idée, le projet de loi n'est pas présenté. Cet événement inspire néanmoins une tradition, celle du « Pèlerinage au Parlement », que les militantes vont effectuer annuellement à compter de 1926 jusqu'à ce qu'elles aient gain de cause en 1940.
En mai 1922, le Comité est constitué en corporation et Marie Lacoste Gérin-Lajoie se rend à Rome à l'occasion du congrès de l'Union internationale des ligues catholiques féminines. Elle souhaite obtenir un appui des autorités catholiques en faveur du suffrage féminin en vue de sensibiliser l'épiscopat du Québec. Ses démarches n'ont toutefois pas les effets escomptés. Considérant qu'elle ne peut faire davantage tant que les évêques québécois ne changeront pas d'avis, elle démissionne de la présidence du Comité en novembre 1922.
En 1927, une scission s'opère au sein du Comité. Idola Saint-Jean fonde l'Alliance canadienne pour le vote des femmes du Québec. Le Comité se réorganise l'année suivante sous la houlette de Thérèse Casgrain, et devient la Ligue des droits de la femme.
La fondation du Comité provincial pour le suffrage féminin représente un moment charnière dans l'histoire des droits des femmes au Québec. Le Comité a fait œuvre pionnière en pavant la voie aux organisations qui lui succède dans la lutte pour l'obtention du droit de vote des Québécoises.
Cet événement historique est désigné pour les motifs suivants:
La fondation du Comité provincial pour le suffrage féminin, le 14 janvier 1922, est un jalon important de l'histoire de la lutte pour l'égalité politique des femmes au Québec. Coprésidé par Marie Lacoste Gérin-Lajoie, présidente de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, et Anna Marks Lyman, présidente du Montreal Council of Women, le Comité est la première association militante ayant comme principale revendication le droit de vote des femmes aux élections provinciales québécoises. Transcendant les divisions linguistiques et confessionnelles, le Comité regroupe plusieurs figures marquantes de l'époque, notamment Carrie Derick, Grace Julia Parker Drummond, Octavia Grace Ritchie England, Idola Saint-Jean et Thérèse Casgrain. Malgré l'opposition de la hiérarchie du clergé catholique et de la grande majorité des députés, les militantes font valoir leur cause de différentes manières, dont la plus connue est le « pèlerinage au Parlement ». Cette manifestation est organisée pour la première fois le 9 février 1922 alors qu'une délégation de plus de 400 femmes se rend à l'hôtel du Parlement pour présenter ses revendications. Cette manifestation est répétée annuellement à partir de 1926 jusqu'à ce que les femmes obtiennent le droit de vote et d'éligibilité aux élections québécoises, le 18 avril 1940.
Assemblée nationale du Québec. « Journal des débats de l'Assemblée (Débats reconstitués), 15e législature, 3e session - 9 février 1922 ». Assemblée nationale du Québec. Assemblée nationale du Québec [En ligne]. http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/13-3/journal-debats/19150209/87245.html
Assemblée nationale du Québec. Par ici la démocratie. Ligne du temps [En Ligne]. http://paricilademocratie.com/
BAILLARGEON, Denyse. Brève histoire des femmes au Québec. Montréal, Boréal, 2012. 281 p.
BAILLARGEON, Denyse. « Les Québécoises et le vote ». Bulletin d'histoire politique. Vol. 23, no 2 (2015), p. 165-172.
BAILLARGEON, Denyse. Repenser la nation : l’histoire du suffrage féminin au Québec. Montréal, Éditions du remue-ménage, 2019. 235 p.
COHEN, Yolande. « Retours sur le droit de vote des femmes au Québec avant 1940 : le rôle du parti libéral ». Bulletin d'histoire politique. Vol. 20, no 2 (2012), p. 13-24.
Collectif CLIO (Le). L’histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles. Montréal, Éditions Quinze, 1982. 521 p.
Conseil du statut de la femme et Réseau québécois en études féministes. Ligne du temps de l'histoire des femmes au Québec [En Ligne]. http://www.histoiredesfemmes.quebec/
DARSIGNY, Maryse. « Les femmes à l'isoloir : la lutte pour le droit de vote ». Cap-aux-Diamants. No 21 (1990), p. 19-21.
DUPIRE, Louis. « La session provinciale : M. Taschereau et le suffrage féminin ». Le Devoir, 10 février 1922, p. 1.
Élections Québec. « Droit de vote et d'éligibilité des Québécoises ». Élections Québec. Élections Québec [En ligne]. https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/vote/droit-de-vote-des-quebecoises.php
GÉRIN-LAJOIE, Marie. « Le vote féminin et la question familiale ». La Bonne Parole. Vol. 10, no 2 (1922), p. 3.
LAMOUREUX, Diane. Citoyennes ? : femmes, droit de vote et démocratie. Montréal, Éditions du remue ménage, 1989. 195 p.
LANTHIER, Stéphanie. « Idola Saint-Jean ». Historica Canada. L'encyclopédie canadienne [En ligne]. www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/idola-saint-jean
LEMOYNE, Georgette. « Madame Gérin-Lajoie et le suffrage féminin ». La Bonne Parole. Vol. 35, no 11 (1945), p. 32-34.
MCCALLUM, Margaret E. « Marie Gérin-Lajoie ». Historica Canada. L'encyclopédie canadienne [En ligne]. www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/marie-gerin-lajoie-nee-lacoste
SICOTTE, Anne-Marie. « Lacoste, Marie ». Université Laval/University of Toronto. Dictionnaire biographique du Canada [En ligne]. http://www.biographi.ca/fr/bio/lacoste_marie_17E.html
SICOTTE, Anne-Marie. Marie Gérin-Lajoie : conquérante de la liberté. Montréal, Éditions du Remue-Ménage, 2005. 503 p.
TRIFIRO, Luigi. « Une intervention à Rome dans la lutte pour le suffrage féminin au Québec (1922) ». Revue d'histoire de l'Amérique française. Vol. 32, no 1 (1978), p. 3-18.
s.a. « Le suffrage féminin : "un attentat contre les traditions fondamentales de notre race et de notre foi", déclare Mgr P.-E. Roy ». La Presse, 18 février 1922, p. 1.
s.a. « Le vote des femmes, au provincial ». La Presse, 30 janvier 1922, p. 2.
s.a. « Un comité provincial du suffrage féminin ». La Presse, 19 janvier 1922, p. 10.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Entrée en vigueur de la Loi relative à la conservation des monuments et des objets d’art ayant un intérêt historique ou artistique

Le 21 mars 1922, la Loi relative à la conservation des monuments et des objets d’art ayant un intérêt historique ou artistique, aussi connue sous le nom de Loi des monuments historiques ou artistiques, est sanctionnée.
L’adoption de cette loi s’inscrit dans le contexte des bouleversements engendrés par l’urbanisation et l’industrialisation qui font surgir des craintes chez une partie de l’élite canadienne-française pour la pérennité des témoins matériels de l’histoire. Quelques voix s’élèvent pour réclamer des actions du gouvernement afin d’empêcher la disparition de ce qu’on nomme alors les « reliques du passé ». Par exemple, le juge Arthur Aimé Bruneau s’insurge dans les journaux contre la destruction de bâtiments anciens et Marie-Louise Marmette Brodeur interpelle le premier ministre du Québec, Louis-Alexandre Taschereau, pour qu’il empêche la vente du manoir Louis Joseph Papineau, à Montebello, et la dilapidation de sa bibliothèque. Ces interventions contribuent à l’émergence de cette question d’intérêt public.
Le 27 février 1922, le secrétaire de la province, Athanase David, dépose à l’Assemblée législative le projet de loi 170 relatif à la conservation des monuments et des objets d’art ayant un intérêt historique ou artistique. Il appert que ce serait Adélard Turgeon, président du Conseil législatif, qui aurait convaincu le premier ministre Taschereau de l’importance de poser un tel geste législatif. Le projet de loi est fortement inspiré de la Loi relative aux monuments historiques qui a été promulguée par le gouvernement français en 1913, et qui est la synthèse des lois antérieures. Il s’agit de la première loi de sauvegarde du patrimoine au Québec et au Canada.
La Loi des monuments historiques ou artistiques est adoptée par l’Assemblée législative le 7 mars 1922 et entre en vigueur dès sa sanction. Elle a comme principal objectif de permettre le classement de monuments et d’objets à caractère possédant un intérêt à l’échelle nationale au niveau de l’histoire ou de l’art. Pour ce faire, la Loi crée la Commission des monuments historiques qui est composée de cinq membres bénévoles. Le 12 avril 1922, le gouvernement annonce la nomination d’Adélard Turgeon, de Pierre Georges Roy, d’Édouard-Zotique Massicotte, de William Douw Lighthall et de Victor Morin comme membres de cette Commission. Le 14 juin suivant, Adélard Turgeon est choisi comme président.
En 1929, les trois premiers monuments historiques sont classés par la Commission. Ces classements sont par la suite entérinés par le gouvernement, comme le prévoit la loi. Il s’agit de la maison des Jésuites-de-Sillery, du château De Ramezay, à Montréal, et de l’église de Notre-Dame-des-Victoires, à Québec. La Commission dresse aussi un premier inventaire des monuments historiques. Trois ouvrages publiés entre 1922 et 1927 témoignent de ces efforts: Les monuments commémoratifs de la province de Québec (1923), Les vieilles églises de la province de Québec (1925) ainsi que Vieux manoirs, vieilles maisons (1927). La Commission favorise aussi la commémoration de différents monuments, personnages, événements et lieux historiques par l’installation de plaques commémoratives le long des routes, encourageant par le fait même le tourisme.
Somme toute, la Loi des monuments historiques ou artistiques a contribué à introduire les premières mesures de valorisation et de protection du patrimoine culturel dans la législation québécoise. En 1952, cette loi a été refondue dans la Loi des monuments et sites historiques ou artistiques. Elle constitue l’ancêtre de la Loi sur le patrimoine culturel, qui a été adoptée en 2011 et qui a été modifiée en 2021.
BRUNELLE-LAVOIE, Louise, Alain GELLY et Corneliu KIRJAN. La passion du patrimoine. La Commission des biens culturels du Québec 1922-1994. Sillery, Septentrion, 1995. 300 p.
HARVEY, Fernand. La vision culturelle d’Athanase David. Montréal, Delbusso, 2012. 265 p.
MORISSET, Lucie K. « Un ailleurs pour l’Amérique : « Notre » patrimoine et l’invention du monument historique au Québec ». Globe. Vol. 10, no 1 (2007), p. 73-105.
OUELLET, Pierre-Olivier. « « Nos routes se couvrent de touristes à la recherche de nos reliques du passé » Les débuts de la Commission des monuments historiques (1922-1928) ». Revue d’histoire de l’Amérique française. Vol. 61, no 2 (2007), p. 235-251.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Réalisation de travaux publics pendant la Grande dépression

Le 29 octobre 1929, les cours de la bourse de New York s'effondrent. Le krach se répercute sur d'autres bourses, dont celle de Montréal. L'événement marque le début d'une profonde dépression économique, l'une des plus importantes de l'histoire moderne, qui affectera durablement la décennie 1930 en occident. Cette période est connue comme étant la « Grande dépression ».
Le krach provoque une hausse importante du chômage au Québec, alors que les mesures d'aide sociale sont très peu nombreuses. Plusieurs personnes et familles sont réduites à la misère. Pour remédier à la situation, les gouvernements mettent rapidement en place des mesures d'aide. L'intervention gouvernementale prend différentes formes, comme le secours direct, le soutien à la colonisation ainsi que l'aide financière pour la réalisation de travaux publics.
La Loi pour remédier au chômage est adoptée par le gouvernement fédéral dès 1930. Elle est assortie d'un budget de 20 millions de dollars, notamment pour la réalisation de travaux publics. Par la suite, le gouvernement du Québec sanctionne la Loi de l'aide aux chômeurs, le 11 décembre 1930. Cette loi permet à la province d'accepter l'aide financière du gouvernement fédéral, en plus de baliser la contribution provinciale et d'établir le processus de distribution de l'argent. Le Canada paie 25 % des travaux publics, la province l'équivalent. Le montant restant est assumé par les municipalités. Cette loi est la première, mais elle ne sera pas la dernière en matière de travaux publics. Des lois similaires sont sanctionnées d'année en année.
Les municipalités répondent rapidement à l'appel du gouvernement en matière de travaux publics puisque leur population est durement frappée par la Grande dépression. Elles proposent des projets au gouvernement, et les travaux réalisés sont très variés d'un endroit à l'autre. La loi du 11 décembre permet même aux municipalités de subventionner des travaux sur des églises. Les travaux publics visent d'abord à se doter d'équipements modernes comme des égouts et des aqueducs (Hull, Québec) ainsi que des installations portuaires (Chicoutimi). Ils comprennent ensuite plusieurs projets d'aménagements urbains comme des parcs et des promenades (Montréal, Salaberry-de-Valleyfield, Shawinigan). Ils permettent aussi la construction d'équipements sportifs, comme des piscines (Montréal) et des amphithéâtres (Saint-Hyacinthe), culturels, comme des salles de spectacle (Québec), et civiques comme des hôtels de ville (Chicoutimi).
Plusieurs municipalités québécoises réalisent des travaux publics dans le cadre des mesures d'aides gouvernementales. Elles y voient un moyen de soulager leurs citoyens, mais également de se doter d'infrastructures modernes. Nous pensons d'abord à la capitale qui se dote du palais Montcalm et d'un réservoir sous les plaines d'Abraham ainsi qu'à la métropole qui se dote notamment de bains publics et aménage l'île Sainte-Hélène. Plusieurs autres villes moins grandes réalisent aussi des travaux publics comme Shawinigan (promenade Saint-Maurice), Grand-Mère [maintenant Shawinigan] (parc de la Rivière-Grand-Mère), Drummondville, Saint-Hyacinthe (stade L.-P.-Gaucher), Salaberry-de-Valleyfield (parc Delpha-Sauvé), Trois-Rivières (parc de l'Exposition), Chicoutimi [maintenant Saguenay] (hôtel de ville) et Hull (aqueduc et égout).
Les travaux publics réalisés pendant la Grande dépression marquent le paysage urbain de plusieurs villes québécoises. Ils ont, en effet, laissé des infrastructures de qualité destinées aux citoyens. Parmi les réalisations les plus connues, citons notamment le palais Montcalm à Québec, le Jardin botanique ainsi que le chalet et le lac aux Castors dans le parc du Mont-Royal à Montréal.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Fondation du Jardin botanique de Montréal

Le Jardin botanique de Montréal est fondé le 9 juin 1931. Situé dans l'est de Montréal, il renferme plus de 22 000 espèces de plantes, exposées dans 10 serres, un arboretum et une trentaine de jardins thématiques.
Le Jardin botanique est l'œuvre du frère Marie-Victorin, Conrad Kirouac (1885-1944), un religieux des Frères des Écoles chrétiennes. Il est spécialiste de la flore québécoise et professeur à l'Institut de botanique de l'Université de Montréal. La création du Jardin répond à trois objectifs: conserver le patrimoine floral du Québec, populariser la botanique et enrichir la culture scientifique francophone en plein développement durant l'entre-deux-guerres. Après avoir lancé l'idée en 1925, le frère Marie-Victorin met sur pied en 1930 l'Association du jardin botanique de Montréal afin de faire cheminer le projet auprès de l'administration municipale. Il connaît bien le maire Camillien Houde, élu en 1928, car il fut son enseignant au Collège LaSalle à Longueuil.
Le 9 juin 1931, Marie-Victorin parvient à convaincre le Conseil municipal de la faisabilité et de l'intérêt pour la Ville d'une telle institution. Il faut toutefois attendre le mois de décembre 1931 pour que les travaux puissent débuter. L'aménagement du Jardin botanique fait partie de la stratégie de Montréal pour atténuer le chômage en période de crise économique. L'architecte municipal, Lucien Kérouak, est responsable de la construction des bâtiments. Les travaux paysagistes sont confiés à l'horticulteur allemand Henry Teuscher, recommandé par le Jardin botanique de New York. L'architecte-paysagiste Frederick Gage Todd collabore également au projet.
Le site retenu se trouve dans l'immense parc Maisonneuve, créé par la municipalité du même nom avant la Première Guerre mondiale. Amorcés en 1931, les travaux sont suspendus en 1933, car la Ville n'a plus d'argent pour financer son programme de travaux publics.
Le 24 avril 1936, la Ville de Montréal crée un conseil d'administration conjoint avec le frère Marie-Victorin et libère des sommes suffisantes pour achever les travaux. En outre, le gouvernement du Québec, dirigé par Maurice Duplessis, contribue financièrement au projet. Le chantier, relancé en 1936, devient l'un des plus imposants à Montréal. Plus de 700 ouvriers y travaillent et onze millions de dollars sont investis. Le Jardin botanique ouvre ses portes en 1939. La même année, le frère Marie-Victorin y déménage son laboratoire et l'Institut de botanique de l'Université de Montréal, ce qui permet de solidifier les liens entre le Jardin et le milieu universitaire. L'institution est à la fois un espace récréatif, un centre de formation et un pôle de recherche scientifique.
En 1956, la Ville retire au directeur scientifique sa place au conseil d'administration et l'accorde à un fonctionnaire municipal. L'établissement, jadis géré en collaboration avec le milieu scientifique, est désormais un service public sous la seule responsabilité du Conseil municipal. Le directeur scientifique poursuit néanmoins la coordination des affaires universitaires.
Le Jardin connaît un essor important à partir des années 1980 sous l'effet conjugué des préoccupations environnementales, de l'augmentation de son budget et de l'intérêt croissant pour la flore internationale. De nouvelles installations accentuent sa vocation touristique, dont les jardins du Japon, de Chine et des Premières Nations, ainsi que l'Insectarium.
La fondation du Jardin botanique en 1931 est une étape importante dans l'avancement de la culture scientifique québécoise. Il est reconnu comme l'un des plus importants au monde.
AUDET, René. « Frère Marie-Victorin, environnementaliste ». Bulletin d'histoire politique. Vol. 23, no 2 (2015), p. 48-65.
BOUCHARD, André et Francine HOFFMAN. Le Jardin botanique de Montréal: esquisse d'une histoire. Saint-Laurent, Fides, 1998. 111 p.
CAILLOUX, Marcel. « Souvenirs du frère Marie-Victorin, de son Institut et de son Jardin botanique ». Liberté. Vol. 39, no 6 (1997), p. 68-84.
CLERK, Nathalie. « Le Jardin Botanique de Montréal ». Journal of the Society for the Study of Architecture in Canada/Journal de la société pour l'étude de l'architecture au Canada. Vol. 34, no 2 (2009), p. 113-139.
DAGENAIS, Michèle. « Le Jardin botanique de Montréal: une responsabilité municipale? ». Revue d'histoire de l'Amérique française. Vol. 52, no 1 (1998), p. 3-22.
Espace pour la vie. « 80 ans d’histoire et d’Archives au Jardin botanique de Montréal ». Ville de Montréal. Ville de Montréal - Portail officiel [En ligne]. http://montrealweb.ville.montreal.qc.ca/jardin/archives/histoire/histoire_accueil.php.
GINGRAS, Yves. « Le frère Marie-Victorin, l’âme du Jardin botanique ». Quatre-temps. Vol. 30, no 2-3 (2006), p. 16-19.
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Grève des midinettes de 1937

Le 15 avril 1937, 5000 couturières membres de l'Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames (UIOVD) déclenchent une grève générale de trois semaines dans plusieurs usines de Montréal.
L'industrie québécoise de la confection s'est installée principalement à Montréal à la fin du XIXe siècle. Cela s'explique par la position stratégique de l'île. Les coûts de production sont plus bas qu'ailleurs, car la main-d'œuvre est multiculturelle et composée en majorité de femmes sous-payées. Elles travaillent dans les ateliers et les usines situées le long secteur des rues Saint-Laurent, Sainte-Catherine et De Bleury. On les surnommera les midinettes.
Les traditions syndicales du secteur de la confection vestimentaire proviennent des ouvriers masculins qualifiés (tailleurs, coupeurs) au XIXe siècle. À partir des années 1930, les militants syndicaux tentent de rejoindre les travailleuses non qualifiées selon une approche industrielle. La Dépression des années 1930 précarise davantage les emplois et accentue le rapport de force des employeurs. En 1937, la semaine de travail dans la confection est évaluée à 55 heures et le salaire hebdomadaire est nettement inférieur à la moyenne du secteur manufacturier.
En réponse à ces dures conditions, les syndicats intensifient leurs activités de recrutement. En septembre 1936, la centrale new-yorkaise de l'UIOVD envoie deux organisateurs, Bernard Shane et Rose Pesotta, pour syndiquer les midinettes montréalaises. Ils s'adjoignent une militante juive native de la région de Québec, Léa Roback, comme liaison dans les usines. Claude Jodoin est assigné comme négociateur auprès des employeurs. Une unité locale représentant les ouvrières est fondée à Montréal le 15 janvier 1937.
À la fin de mars 1937, le syndicat s'estime assez fort pour négocier un contrat de travail avec les 80 employeurs regroupés dans la Guilde des manufacturiers du vêtement pour dames. Les midinettes ont un cahier de revendications étoffé: reconnaissance syndicale, semaine de 44 heures, hausse salariale générale de 50%, interdiction du travail à domicile, fin du favoritisme, heures supplémentaires payées à temps et demi. En l'absence de réponse de la Guilde, les syndiquées votent la grève le 7 avril et la déclenchent le 15 du même mois.
Les grévistes reçoivent l'appui du Conseil des métiers et du travail de Montréal, porte-parole des syndicats internationaux de métier sur le territoire montréalais. Claude Jodoin agit comme négociateur de l'UIOVD. La centrale new-yorkaise, membre de la Fédération américaine du travail, y investit des ressources importantes et met sur pied un fonds de grève. Le contexte politique n'aide pas les midinettes. Le premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, brandit sans succès la Loi du cadenas, adoptée en mars 1937, pour casser la grève. Quelques escarmouches surviennent avec les briseurs de grève: 13 femmes et 8 hommes sont incarcérés pendant le conflit.
L'enlisement du conflit divise le patronat. Deux groupes d'employeurs se forment pour dénouer l'impasse. Le premier tente sans succès de s'entendre avec les travailleuses, moins nombreuses, affiliées à la Confédération des travailleurs catholiques du Canada. L'autre groupe négocie avec l'UIOVD et signe un contrat de travail à la hâte le 10 mai 1937. La grève s'achève la même journée et les midinettes obtiennent la majorité de leurs revendications. La fin de la grève a un écho à l'Assemblée législative du Québec. En septembre 1937, le gouvernement instaure un salaire minimum légal et crée un tribunal d'arbitrage pour les conflits de travail.
La grève d'avril 1937 permet aux travailleuses de la confection d'avoir une visibilité militante dans l'espace public et de s'initier aux activités politiques et syndicales. Elle frappe l'imaginaire et met en lumière la contribution de communauté juive au progrès des conditions de travail au Québec.
BAILLARGEON, Denyse. Brève histoire des femmes au Québec. Montréal, Boréal, 2012. 281 p.
BANTEY, Edward. Les/The Midinettes, 1937-1962. Montréal, Montréal, International Ladies' Garment Workers' Union, 1962. 123 p.
CHARPENTIER, Alfred. « La Grève dans le textile dans le Québec en 1937 ». Relations industrielles. Vol. 20, no 1 (1965), p. 86-127.
Conseil du statut de la femme et Réseau québécois en études féministes. Ligne du temps de l'histoire des femmes au Québec [En Ligne]. http://www.histoiredesfemmes.quebec/
GAGNON, Gemma. La syndicalisation des femmes dans l'industrie montréalaise du vêtement, 1936-1937. Université du Québec à Montréal, 1990. 256 p.
GANNAGE, Charlene. Double Day, Double Bind : Women Garment Workers. Toronto, Women's Press, 1986. 235 p.
LÉVESQUE, Andrée. « Les Midinettes de 1937: culture ouvrière, culture de genre, culture ethnique ». LAMONDE, Yvan, dir. et Denis SAINT-JACQUES, dir. 1937: un tournant culturel. Québec, Les Presses de l'Université Laval, 2009, p. 71-88.
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
ROUILLARD, Jacques. Le syndicalisme québécois: deux siècles d'histoire. Montréal, Boréal, 2004. 335 p.
s.a. « La grève des midinettes – Conseil conjoint montréalais de la ILGWU ». s.a. Le musée interactif du Montréal juif [En ligne]. http://mimj.ca/location/1913
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Obtention du droit de vote et d'éligibilité pour les femmes québécoises

Le 18 avril 1940, l'Assemblée législative du Québec adopte la Loi accordant aux femmes le droit de vote et d'éligibilité. Cet événement est un jalon important de la lutte pour l'égalité politique des femmes au Québec.
Les mouvements en faveur du droit de vote pour les femmes au Québec et au Canada naissent à la fin du XIXe siècle. La première organisation à réclamer le droit de vote pour les femmes est la Women's Christian Temperance Union, un organisme qui combat essentiellement l'alcoolisme et qui a une succursale à Montréal à compter de 1887. La lutte pour l'obtention du droit de vote pour les femmes se concrétise en 1913 par la fondation de la Montreal Suffrage Association, un organisme présidé par Carrie Derrick. Le mandat de l'association est de promouvoir le suffrage féminin au fédéral. En 1918, les femmes du Québec et du Canada obtiennent le droit de voter aux élections fédérales et, en 1919, de se faire élire à la Chambre des communes. De 1916 à 1922, les femmes obtiennent le droit de vote dans toutes les provinces canadiennes, sauf au Québec.
La lutte des femmes pour l'obtention du droit de vote aux élections québécoises commence véritablement en 1921 avec la fondation du Comité provincial pour le suffrage féminin par Marie Lacoste Gérin-Lajoie, présidente de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, et Anna Marks Lyman, présidente du Montreal Council of Women. Carrie Derick, Grace Julia Parker Drummond, Octavia Grace Ritchie England, Idola Saint-Jean et Thérèse Casgrain font aussi partie du comité. L'objectif de ce comité est de forcer l'Assemblée législative à débattre de la question du suffrage féminin. Des obstacles se dressent toutefois sur la voie des militantes: le clergé catholique et la grande majorité des journalistes et des parlementaires, de même que plusieurs femmes, s'y opposent vigoureusement. Le Comité se présente une première fois au Parlement de Québec le 9 février 1922 pour réclamer le suffrage féminin. En mars de la même année, le député libéral Henry Miles dépose un projet de loi sur le suffrage féminin, qui est rejeté.
Par la suite, la revendication est reprise par l'Alliance canadienne pour le vote des femmes du Québec, créée en 1927 par Idola Saint-Jean, et la Ligue des droits de la femme, créée en 1929 par Thérèse Casgrain, à partir du Comité provincial pour le suffrage féminin. En travaillant de pair, ces deux groupes réclament le droit de vote pour les femmes aux élections provinciales en organisant des manifestations et des campagnes médiatiques. À leur demande, un député favorable à leur cause dépose chaque année un projet de loi à l'Assemblée législative. Ces projets sont continuellement rejetés.
Défait aux urnes en 1936, le Parti libéral du Québec organise un congrès en mai 1938 afin de préparer son programme électoral. Thérèse Casgrain, alors vice-présidente du Club des femmes libérales du Canada, participe au congrès avec une délégation féminine. Ces femmes parviennent à faire ajouter le suffrage féminin au programme du parti. Élus en 1939, les libéraux d'Adélard Godbout remplissent leur promesse dans la première année de leur mandat.
Le projet de loi accordant aux femmes le droit de vote et d'éligibilité est présenté en Chambre le 9 avril 1940. Deux jours plus tard, en deuxième lecture, 67 députés votent en faveur du projet et 9 contre. Le 18 avril, le projet est adopté sur division en troisième lecture. Le 25 avril, le Conseil législatif adopte la loi, qui reçoit la sanction royale du lieutenant-gouverneur le jour même.
En 1944, les femmes votent pour la première fois dans le cadre d'une élection générale québécoise. Il faut toutefois attendre en 1961 pour voir une première femme, Marie-Claire Kirkland-Casgrain, être élue à titre de députée. L'année suivante, elle devient la première femme à être assermentée comme ministre. En 2012, Pauline Marois est la première femme élue première ministre du Québec.
Assemblée nationale du Québec. Par ici la démocratie. Ligne du temps [En Ligne]. http://paricilademocratie.com/
BAILLARGEON, Denyse. Brève histoire des femmes au Québec. Montréal, Boréal, 2012. 281 p.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La ligne du temps du Québec [En Ligne]. https://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
BOILEAU, Gilles. « C'est Adélard Godbout qui a donné le droit de vote des femmes ». Histoire du Québec. Vol. 10, no 2 (2004), p. 11-14.
Collectif Clio. L'histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles. Montréal, Le Jour, 1992. 646 p.
Conseil du statut de la femme et Réseau québécois en études féministes. Ligne du temps de l'histoire des femmes au Québec [En Ligne]. http://www.histoiredesfemmes.quebec/
DARSIGNY, Maryse. « Les femmes à l'isoloir : la lutte pour le droit de vote ». Cap-aux-Diamants. No 21 (1990), p. 19-21.
LAPLANTE, Laurent. « Les femmes et le droit de vote : l'épiscopat rend les armes ». Cap-aux-Diamants. No 21 (1990), p. 23-25.
LAVIGNE, Marie. « 18 avril 1940 - L'adoption du droit de vote des femmes : le résultat d'un long combat ». GRAVELINE, Pierre, dir. Dix journées qui ont fait le Québec. Montréal, VLB, 2013, p. 161-186.
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
Bulletin / Bibliothèque de l'Assemblée nationale. Vol. 39, no 1 (2010), 47 p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Première conférence de Québec

La première conférence de Québec, aussi connue sous le nom de code Quadrant, se déroule du 11 au 24 août 1943 dans la citadelle de Québec ainsi que dans le château Frontenac. Cette conférence bilatérale survient dans un contexte d'accroissement des rencontres stratégiques des forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale, après celles de Casablanca et de Washington. Elle rassemble le président américain Franklin D. Roosevelt, le premier ministre britannique Winston Churchill, leurs états majors respectifs ainsi que des délégués militaires de plusieurs pays alliés. Le gouverneur général du Canada, le comte d'Athlone, et le premier ministre, William Lyon Mackenzie King, sont présents en qualité d'hôte, mais ne prennent pas part aux discussions.
La tenue de la conférence a des répercussions sur la ville de Québec. Les médias sont tenus au secret et les communications sont étroitement surveillées et contrôlées. Des batteries antiaériennes et des patrouilles assurent la sécurité des airs tandis que les lieux de rencontre sont ceinturés par d'imposants périmètres de sécurité. Pour sa part, le château Frontenac est complètement vidé de ses hôtes et toutes les réservations sont annulées afin de pouvoir accueillir les participants de la conférence.
Le premier chef d'État qui arrive à Québec est Winston Churchill, le 10 août 1943. Il est accompagné de son épouse Clementine et de leur fille Mary. Le lendemain, Churchill et King sont reçus dans la salle du Conseil exécutif de l'Assemblée législative par le premier ministre Adélard Godbout et son cabinet. Les premières séances de la conférence s'amorcent le même jour entre les chefs d'états-majors combinés, qui sont responsables de la préparation de la stratégie militaire conjointe de la Grande Bretagne et des États-Unis. Le 17 août, en fin de journée, le président Roosevelt arrive dans la ville. Le jour suivant, les photos officielles de la conférence sont prises à la citadelle. Plusieurs de ces clichés passent à la postérité.
Ce n'est qu'une fois Churchill et Roosevelt réunis que se prennent des décisions à partir du travail effectué par les chefs d'états-majors combinés. Parmi les sujets abordés, il y a l'imminente capitulation de l'Italie qui soulève la question de l'ouverture d'un nouveau front en Europe. Conséquemment, et malgré les nombreux points abordés, les efforts sont concentrés sur la planification d'un débarquement en Normandie, nommé opération Overlord. Prévue pour le mois de mai 1944, son organisation est placée sous le commandement du général américain Dwight D. Eisenhower. Le projet Manhattan est également évoqué et il est décidé que l'Union des républiques socialistes soviétiques ne pourra pas être informée des développements du projet. Enfin, on s'entend pour intensifier la lutte contre le Japon.
Le 23 août, King participe avec Churchill à un défilé motorisé dans les rues de Québec. La rencontre se termine le 24 août avec une conférence de presse couverte par de nombreux journalistes. Ces derniers, ne pouvant avoir accès à ce qui s'est discuté derrière les portes closes, se rabattent sur la couverture des manifestations mondaines en marge des discussions. À la suite de la conférence, Roosevelt quitte pour Ottawa tandis que Churchill reste quelques jours supplémentaires à Québec.
La conférence de Québec de 1943 lance la préparation de l'opération Overlord et marque l'implication grandissante des États-Unis dans la poursuite de la guerre. La tenue de cette conférence, et celle de 1944, permettent à Québec de figurer parmi les villes qui ont eu le privilège d'accueillir une conférence interalliée au cours de la Deuxième Guerre mondiale.
Assemblée nationale du Québec. Par ici la démocratie. Ligne du temps [En Ligne]. http://paricilademocratie.com/
BLAIS, Christian, Gilles GALLICHAN, Frédéric LEMIEUX et Jocelyn SAINT-PIERRE. Québec: quatre siècles d'une capitale. Québec, Assemblée nationale du Québec - Les Publications du Québec, 2008. 692 p.
LEBEL, Jean-Marie. Québec 1608-2008 : les chroniques de la capitale. Québec, Les Presses de l'Université Laval, 2008. 760 p.
MARSH, James. « Conférences de Québec (1943 et 1944) ». Historica Canada. L'encyclopédie canadienne [En ligne]. http://www.thecanadianencyclopedia.com
Office of the Combined Chiefs of Staff. Quadrant Conference (Quebec), Papers and Minutes of Meetings, August 1943. s.l. Office of the Combined Chiefs of Staff, 1943. 520 p.
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
RICARD-CHÂTELAIN, Baptiste. « Quand l'histoire s'est écrite à Québec ». Le Soleil, 17 août 2013, s.p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Création d'Hydro-Québec

Le 14 avril 1944, l'Assemblée législative de la province de Québec adopte la Loi établissant la Commission hydroélectrique de Québec, créant ainsi l'entreprise publique connue sous le nom d'Hydro-Québec, responsable de la production, du transport et de la distribution de l'électricité sur tout le territoire québécois.
Antérieurement à la création d'Hydro-Québec, les ressources énergétiques du Québec sont exploitées en majeure partie par des entreprises privées. La Montreal Light, Heat and Power Consolidated, l'une de ces puissantes compagnies, exerce un monopole sur l'île de Montréal et engrange des profits considérables, tout en offrant des services plus ou moins adéquats.
La lutte contre le trust de l'électricité prend son essor au début des années 1930. Télesphore-Damien Bouchard, député libéral et maire de Saint-Hyacinthe, qui prône la municipalisation des services d'électricité, et le dentiste Philippe Hamel, qui milite pour la nationalisation des compagnies, figurent parmi les chefs de file du mouvement. En 1933, l'École sociale populaire prend position en faveur de la création d'une hydro provinciale. Face aux pressions populaires croissantes, le gouvernement de Louis-Alexandre Taschereau crée en 1934 la Commission de l'électricité (Commission Lapointe), qui dénoncera dans son rapport les pratiques des compagnies, sans pour autant recommander la nationalisation.
La nationalisation de l'électricité devient un enjeu électoral en 1936, alors que l'Union nationale s'engage dans cette voie. Une fois élue, l'Union nationale crée plutôt le Syndicat national de l'électricité, une entreprise publique chargée de construire des centrales hydroélectriques dans certaines régions du Québec. En 1939, le Parti libéral est reporté au pouvoir au terme d'une campagne pendant laquelle son chef Adélard Godbout promet l'étatisation de la Montreal Light Heat and Power Consolidated.
Malgré la campagne d'opposition de la compagnie et de la presse d'affaires, le projet de loi visant la création d'une hydro québécoise, l'étatisation de la Montreal Light, Heat and Power Consolidated et l'électrification rurale est déposé le 23 mars 1944. Adoptée et sanctionnée le 14 avril 1944, la loi donne le mandat à Hydro-Québec « de fournir l'énergie aux municipalités, aux entreprises industrielles ou commerciales et aux citoyens de cette province aux taux les plus bas compatibles avec une saine administration financière ».
Le lendemain de l'adoption de la loi, les commissaires d'Hydro-Québec prennent possession des actifs électriques et gaziers de la Montreal Light, Heat and Power Consolidated et de ses deux filiales. La nouvelle société d'État acquiert ainsi quatre centrales hydroélectriques en activité et le monopole du transport et de la distribution de l'électricité et du gaz sur l'île de Montréal. Le processus de compensation des expropriés prendra fin en 1953.
La création d'Hydro-Québec a des retombées économiques majeures. Par cette expropriation, l'État québécois prend possession du marché montréalais de l'électricité. À court terme, cette prise de contrôle entraine la réduction des tarifs, ce qui favorise le développement du marché domestique et l'extension du réseau de distribution. À plus long terme, la création d'Hydro-Québec contribue à l'électrification des régions du Québec et au développement d'une expertise québécoise en production et en transport d'énergie hydroélectrique.
En 1963, le gouvernement de Jean Lesage complète la nationalisation de l'électricité en permettant à Hydro-Québec d'acquérir et d'intégrer à son réseau les actifs de onze autres compagnies privées d'électricité. Hydro-Québec devient alors un véritable levier économique. Elle contribue à l'autonomie de l'État québécois et à nourrir la fierté de sa population.
De nos jours, Hydro-Québec est l'un des plus importants producteurs d'hydroélectricité au monde et continue de jouer un rôle déterminant dans le développement économique du Québec.
Cette désignation repose sur les motifs suivants:
Le 14 avril 1944, le gouvernement d'Adélard Godbout fait adopter par l'Assemblée législative de la province de Québec une loi donnant naissance à Hydro-Québec et étatisant les actifs de la Montreal Light, Heat and Power Consolidated. La nouvelle entreprise publique acquiert ainsi quatre centrales en activité et le monopole du transport et de la distribution de l'électricité et du gaz sur l'île de Montréal.
La création d'Hydro-Québec a des retombées économiques majeures. À court terme, la prise de possession du marché montréalais de l'énergie entraine la réduction des tarifs des consommateurs, ce qui favorise l'expansion du marché domestique et l'extension du réseau de distribution. À plus long terme, la création d'Hydro-Québec contribue à l'électrification des campagnes et au développement d'une expertise québécoise dans le secteur de l'énergie hydroélectrique.
La création d'Hydro-Québec constitue la première phase du processus de nationalisation de l'électricité au Québec. Ce processus est complété en 1963 par le gouvernement de Jean Lesage qui permet à Hydro-Québec d'acquérir et d'intégrer à son réseau les actifs de onze autres compagnies privées d'électricité. Hydro-Québec devient un véritable levier économique qui contribuera dès lors à l'autonomie de l'État québécois.
De nos jours, Hydro-Québec est responsable de la production, du transport et de la distribution de l'électricité sur tout le territoire québécois. L'entreprise continue de jouer un rôle déterminant dans le développement économique du Québec et est l'un des plus importants producteurs d'hydroélectricité au monde.
Archemi inc. Aménagement des Cèdres, Inventaire du patrimoine bâti et technologique, vol. 1 - Rapport principal. Montréal, 2004. 161 p.
GALLICHAN, Gilles, dir. et Assemblée nationale du Québec. Hydro-Québec : débats parlementaires, Loi 17 - 1944. Québec, econstitution des débats, Bibliothèque de l'Assemblée nationale, 1994. 156 p.
BELLAVANCE, Claude, Roger LEVASSEUR et Yvon ROUSSEAU. « De la lutte antimonopoliste à la promotion de la grande entreprise. L'essor de deux institutions: Hydro-Québec et Desjardins, 1920-1965 ». Recherches sociographiques. Vol. XL, no 3 (1999), p. 551-578.
BELLAVANCE, Claude. « Les origines économiques et techniques de la nationalisation de l'électricité au Québec : l'expérience du régime mixte, de 1944 à 1963 ». Annales historiques de l'électricité. Vol. 1, no 1 (2003), p. 37-52.
BELLAVANCE, Claude. Shawinigan Water and Power (1898-1963). Formation et déclin d'un groupe industriel au Québec. Montréal, Boréal, 1994. 448 p.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La ligne du temps du Québec [En Ligne]. https://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
BLAIS, Christian. Histoire parlementaire du Québec, 1928-1962 : la crise, la guerre, le duplessisme, l'État providence : introduction. Québec, Septentrion, 2015. s.p.
BOLDUC, André. « L'histoire de l'électricité au Québec ». Hydro-Québec. Hydro-Québec [En ligne]. http://www.hydroquebec.com/comprendre/histoire/index.html
BOLDUC, André, Clarence HOGUE et Daniel LAROUCHE. Québec : un siècle d'électricité. Montréal, Libre expression, 1984. 430 p.
BROUILLETTE, Benoît. « Notre Milieu. Combustible et force motrice ». Le Devoir, 4 mars 1941, p. p.2.
DORION, Marie-Josée. Les coopératives et l'électrification rurale du Québec, 1945-1964. Université du Québec à Trois-Rivières, 2008. 628 p.
FAUCHER, Albert. « La question de l'électricité au Québec durant les années trente ». L'Actualité économique. Vol. 68, no 3 (1992), p. 415-432.
GALLICHAN, Gilles. « De la Montreal Light, Heat and Power à Hydro-Québec ». BÉLANGER, Yves et Robert COMEAU. Hydro-Québec : autres temps, autres défis. Les leaders du Québec contemporain. Québec, Université du Québec, 1995, p. 63-70.
LEROUX, Carole. « La passionnante histoire de la nationalisation de l'électricité au Québec ». L'Écho. Journal du Syndicat professionnel des ingénieurs d'Hydro-Québec. Vol. 49, no 6 (2013), p. p.7.
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
SAVARD, Stéphane. Hydro-Québec et l'État québécois, 1944-2005. Québec, Septentrion, 2013. 435 p.
Société d'aménagement technologique Inc. (SOTAR). Inventaire du patrimoine bâti et technologique d'Hydro-Québec : évaluation comparative des installations hydroélectriques. Vol. 1. s.l. 1995. s.p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Adoption du fleurdelisé comme drapeau officiel du Québec

Le 21 janvier est le jour du Drapeau du Québec en vertu de la Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec. Ce jour commémore la première levée du fleurdelisé sur le mât de la tour centrale de l’hôtel du Parlement du Québec, le 21 janvier 1948. Le matin même, le gouvernement du Québec lui avait accordé par décret le statut de drapeau officiel.
Sur ce premier drapeau, quatre fleurs de lys blanches pointées vers le centre rappellent l’écu de France sur champ azur, symbole de la monarchie française, tandis que la croix blanche évoque celle plantée par Jacques Cartier à Gaspé, en 1534. Dès le lendemain, il est remplacé par un drapeau sur lequel les fleurs de lys sont redressées, comme c’est le cas aujourd’hui sur le drapeau officiel du Québec.
Assemblée nationale du Québec. Par ici la démocratie. Ligne du temps [En Ligne]. http://paricilademocratie.com/
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La ligne du temps du Québec [En Ligne]. https://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Lancement du manifeste Refus global

Considéré comme un moment charnière de l'histoire culturelle du Québec, le lancement du manifeste collectif intitulé Refus global s'inscrit dans le mouvement d'affirmation de la modernité dans le domaine des arts québécois. Ce mouvement s'est amorcé au cours des années 1930 et a culminé avec la Révolution tranquille.
Le manifeste Refus global est un condensé des réflexions des automatistes, un groupe de jeunes artistes d'avant-garde formé à Montréal à compter de 1941 autour de Paul-Émile Borduas, peintre et professeur à l'École du meuble. Inspirés par le surréalisme français et plus particulièrement par l'écrivain André Breton, les membres de ce groupe rejettent toute forme d'académisme et conçoivent plutôt l'art comme l'expression du subconscient, libre des limites imposées par les règles disciplinaires, laissant toute la place à la spontanéité et à l'expérimentation. À partir de 1944, leurs oeuvres sont montrées au public lors d'expositions collectives à Montréal, mais aussi à Toronto, New York et Paris.
À la suite de la publication à Paris en 1947 du manifeste Ruptures inaugurales par des artistes surréalistes, le groupe des automatistes sent le besoin de faire connaître ses positions par une manifestation écrite. Entre décembre 1947 et février 1948, les premières versions de Refus global sont rédigées par Borduas. Le manifeste en préparation circule chez les avant-gardes montréalaises et déclenche la parution du manifeste Prisme d'yeux signé par un groupe réuni autour d'Alfred Pellan. Pour financer la publication de Refus global, le photographe Maurice Perron fonde la maison d'édition Mithra-Mythe et organise une souscription auprès d'amis. Les textes du recueil sont dactylographiés par Pierre Gauvreau et sont imprimés sur une machine Gestetner. Ils sont par la suite assemblés de manière artisanale.
Le 9 août 1948, les automatistes lancent leur manifeste à la librairie d'Henri Tranquille, à Montréal. À cette occasion, les 400 exemplaires numérotés du tirage original sont mis en vente au coût d'un dollar chacun. Le recueil présente neuf textes différents, dont l'essai principal écrit par Paul-Émile Borduas qui donne son titre au collectif. Cet essai est cosigné par Madeleine Arbour, Marcel Barbeau, Muriel Guilbault, Pierre Gauvreau, Claude Gauvreau, Louise Renaud, Fernand Leduc, Thérèse Renaud-Leduc, Jean-Paul Riopelle, Françoise Riopelle, Jean-Paul Mousseau, Marcelle Ferron, Françoise Sullivan, Bruno Cormier et Maurice Perron. Il est accompagné de deux autres textes de Borduas, de trois « objets dramatiques » de Claude Gauvreau et de courts essais de Cormier et de Sullivan, de même que d'un texte pamphlétaire de Leduc. Douze planches d'illustrations et de photos complètent le document. La couverture est l'oeuvre de Riopelle et de Claude Gauvreau.
Par le manifeste Refus global, Borduas et les automatistes revendiquent une plus grande liberté dans l'acte de création, mais aussi dans la manière d'exister. Le manifeste critique de manière virulente la société dominante et son conservatisme, de même que le contrôle exercé sur les esprits par les pouvoirs religieux et politique. Plus qu'un manifeste d'artistes, Refus global est un projet de société porté par des citoyens en quête d'un monde plus libre et ouvert aux manifestations des avant-gardes internationales.
Le manifeste n'obtient pas de succès en librairie, mais sa parution provoque une controverse. Le gouvernement, l'Église et plusieurs journaux condamnent le texte jugé scandaleux et subversif. Le prix à payer par certains signataires du manifeste est plutôt lourd. Borduas perd son poste de professeur à l'École du meuble et s'exile à New York, puis à Paris, où se retrouveront également les Riopelle, Leduc et Ferron.
Le manifeste est laissé dans l'oubli durant les années suivant sa publication. Il est redécouvert dans les années 1960 et 1970 et consacré parmi les œuvres marquantes du Québec.
Cet événement historique a été désigné pour les motifs suivants:
« Le lancement du manifeste Refus global est considéré comme un moment charnière de l'histoire culturelle du Québec. Ce manifeste est l'œuvre d'un groupe de jeunes artistes d'avant-garde, les Automatistes, formés à Montréal à compter de 1941 autour de Paul-Émile Borduas, peintre et professeur à l'École du meuble. En 1947, à la suite de la publication à Paris de Rupture inaugurale par les artistes surréalistes français, les Automatistes souhaitent faire connaître leur pensée par une manifestation écrite du même ordre. L'ébauche de ce texte est rédigée par Borduas pendant les vacances de Noël. En janvier 1948, au cours de rencontres, les Automatistes discutent autour de ce premier jet. En février, la parution de Prisme d'yeux, un manifeste signé par un groupe d'artistes québécois réunis autour de Jacques de Tonnancour et d'Alfred Pellan, force toutefois les Automatistes à revoir le contenu de leur document au cours de l'hiver et du printemps, ce qui entrainera des dissidences au sein de leur groupe. Le 9 août 1948, les Automatistes lancent, à la librairie Tranquille à Montréal, un recueil intitulé Refus global, qui comprend le manifeste écrit par Borduas et qui donne son titre au collectif. Le manifeste est contresigné par quinze artistes du mouvement automatiste, soit : Madeleine Arbour, Marcel Barbeau, Bruno Cormier, Marcelle Ferron, Muriel Guilbault, Claude Gauvreau, Pierre Gauvreau, Fernand Leduc, Jean-Paul Mousseau, Thérèse Renaud-Leduc, Louise Renaud, Maurice Perron, Françoise Riopelle, Jean Paul Riopelle et Françoise Sullivan. Dans ce texte, les cosignataires revendiquent une plus grande liberté, non seulement dans l'acte de création, mais aussi dans la manière d'exister, et critiquent sévèrement les cadres de la société de l'époque. La parution du manifeste provoque une vive controverse, qui a de lourdes conséquences pour certains signataires. C'est le cas pour Paul Émile Borduas, qui perdra son poste à l'École du meuble et s'exilera à New York, puis à Paris, où se retrouvent certains automatistes. Le lancement du manifeste Refus global s'inscrit néanmoins dans le mouvement d'affirmation de la modernité dans le domaine des arts québécois et sert de prélude à la Révolution tranquille. »
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La ligne du temps du Québec [En Ligne]. https://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
Conseil du statut de la femme et Réseau québécois en études féministes. Ligne du temps de l'histoire des femmes au Québec [En Ligne]. http://www.histoiredesfemmes.quebec/
DESCHAMPS, Brigitte. « Refus global: de la contestation à la commémoration ». L'automatisme en mouvement. Vol. 34, no 2-3 (1998), p. 175-190.
DUBOIS, Sophie. Refus global : histoire d'une réception partielle. Nouvelles études québécoises, 16. Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, 2017. 429 p.
GAGNON, François-Marc. « Borduas, Paul-Émile ». Université Laval/University of Toronto. Dictionnaire biographique du Canada [En ligne]. http://www.biographi.ca/
GAGNON, François-Marc. « Refus Global ». Historica Canada. L'encyclopédie canadienne [En ligne]. http://www.thecanadianencyclopedia.com/
MAYER, Jonathan. Les échos du refus global. Montréal, Michel Brulé, 2008. 240 p.
Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire. Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire [En Ligne]. https://mbamsh.com/
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
Vie des arts. Vol. 42, no 170 (1998).
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Grève de l’amiante

Le 14 février 1949 commence l’un des conflits de travail les plus longs et les plus violents de l’histoire du Québec: la grève de l’amiante. Celle-ci paralyse les principales mines d’amiante du Québec pendant près de 5 mois, à une époque où 85 % de l’amiante dans le monde provient du Québec et que ce minerai est utilisé dans la construction et la fabrication de nombreux produits. Les travailleurs revendiquent notamment un meilleur salaire, des jours fériés payés, une pension ainsi que des mesures pour limiter la poussière d’amiante qui est à l’origine de plusieurs maladies. La grève est marquée par la répression policière et le conflit entre le premier ministre Maurice Duplessis et l’archevêque de Montréal, monseigneur Joseph Charbonneau, qui soutient les grévistes. Si elle se solde par peu de gains pour les travailleurs, la grève de l’amiante a d’importantes répercussions sociales et politiques qui contribuent à ouvrir la voie à la Révolution tranquille.
Assemblée nationale du Québec. Par ici la démocratie. Ligne du temps [En Ligne]. http://paricilademocratie.com/
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La ligne du temps du Québec [En Ligne]. https://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
DAVID, Hélène et Danny KUCHARSKY. « Grève de l’amiante de 1949 ». Historica Canada. L’encyclopédie canadienne [En ligne]. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/greve-de-lamiante
MARSH, James H. « La grève de l’amiante : moment charnière de l’histoire du Québec ». Historica Canada. L’encyclopédie canadienne [En ligne]. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/la-greve-de-lamiante-editorial
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Deuxième phase de nationalisation de l'électricité au Québec

Le 30 avril 1963 marque le début de la deuxième phase de nationalisation de l'électricité au Québec alors que la société d'État Hydro-Québec amorce l'achat des actions de onze compagnies privées. Hydro-Québec devient ainsi la plus importante entreprise publique du Québec.
La première phase de nationalisation de l'électricité, réalisée en 1944, a permis à Hydro-Québec de devenir propriétaire de la compagnie privée Montreal Light Heat and Power Consolidated et de ses filiales. La société d'État fait alors partie de plus de 40 compagnies d'électricité cohabitant au Québec. Des entreprises privées telles que la Shawinigan Water and Power Company (SWPC), la Gatineau Power Company et la Southern Canada Power Ltd. détiennent les monopoles de l'électricité dans les différentes régions du Québec. N'étant pas soumises à la concurrence du marché, ces compagnies peuvent se permettre de faire payer des tarifs d'électricité exorbitants aux consommateurs, spécialement dans le cas où ceux-ci vivent dans des régions à faible taux de population, situées loin des sources de production. La coexistence de plusieurs entreprises d'électricité mène à une multiplication des coûts de transport, de production et d'administration, alors que le service offert demeure insatisfaisant.
En 1962, René Lévesque (1922-1987), ministre des Richesses naturelles sous le gouvernement libéral de Jean Lesage (1912-1980), amène l'idée d'intégrer sous une même gestion la production hydroélectrique et la distribution de l'électricité. Un des arguments est que les différents réseaux de transport devraient être unifiés de manière à servir équitablement et à juste prix l'ensemble des citoyens québécois. Selon René Lévesque, ces changements doivent être réalisés par le biais de l'État, et plus précisément par Hydro-Québec. Plutôt que de viser uniquement l'accumulation de bénéfices, une entreprise publique utiliserait les richesses naturelles du Québec pour le bien de la collectivité. Le gouvernement du Québec tout comme les Québécois bénéficieraient des retombées économiques de la société d'État.
Une lutte de relations publiques acharnée s'amorce alors entre le gouvernement, avec René Lévesque comme porte-parole, et les compagnies privées d'électricité, en particulier la SWPC. L'affrontement est également politique, puisque la question de la nationalisation de l'électricité devient l'enjeu principal de la campagne électorale provinciale de 1962. En plus de revêtir un caractère social important, le projet d'étatisation de l'électricité est intimement lié au développement économique du Québec. Avec le slogan « Maîtres chez nous », l'administration Lesage souhaite briser les obstacles qui se dressent devant l'essor économique des Canadiens français.
C'est en votant que les citoyens décident de la nationalisation. Le 14 novembre 1962, le gouvernement libéral de Jean Lesage est réélu. Après maintes négociations concernant le prix d'achat des actions des compagnies privées, le projet de nationalisation de l'électricité est mené à terme le 30 avril 1963 alors qu'Hydro-Québec amorce l'achat de onze compagnies d'électricité. En décembre de la même année, la société d'État achète 45 coopératives d'électricité. Entre 1963 et 1977, Hydro-Québec acquiert 27 réseaux privés ou municipaux et les intègre à son propre réseau. La deuxième phase de la nationalisation de l'électricité se fait donc sous la forme d'achats graduels d'actions de gré à gré.
À l'issue de cette deuxième phase de nationalisation de l'électricité en 1963, Hydro-Québec favorise le français comme langue de travail, emploie une dizaine de milliers de personnes, dessert plus de 1 350 000 clients et détient des actifs de plus de deux milliards de dollars. En quelques années, Hydro-Québec réduit les tarifs d'électricité pour la clientèle résidentielle et uniformise aussi bien sa gestion administrative que le service d'électricité offert dans toute la province.
Archemi inc. Aménagement des Cèdres, Inventaire du patrimoine bâti et technologique, vol. 1 - Rapport principal. Montréal, 2004. 161 p.
BELLAVANCE, Claude. « Un long mouvement d'appropriation de la première à la deuxième nationalisation ». BÉLANGER, Yves et Robert COMEAU. Hydro-Québec : autres temps, autres défis. Les leaders du Québec contemporain. Québec, Université du Québec, 1995, p. 71-78.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La ligne du temps du Québec [En Ligne]. https://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
BOLDUC, André, Alain CHANLAT et Daniel LAROUCHE. Gestion et culture d'entreprise : le cheminement d'Hydro-Québec. Montréal, Québec Amérique, 1984. 250 p.
BOLDUC, André, Clarence HOGUE et Daniel LAROUCHE. Québec : un siècle d'électricité. Montréal, Libre expression, 1984. 430 p.
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Secrétariat aux relations canadiennes. Le Québec au fil du temps [En Ligne]. https://www.sqrc.gouv.qc.ca/relations-canadiennes/federalisme/quebec-fil-du-temps.asp
JOBIN, Carol. Les enjeux économiques de la nationalisation de l'électricité (1962-1963). Montréal, Éditions Coopératives Albert Saint-Martin, 1978. 206 p.
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
SAVARD, Stéphane. Hydro-Québec et l'État québécois, 1944-2005. Québec, Septentrion, 2013. 435 p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Inauguration du métro de Montréal

Le métro de Montréal est inauguré le 14 octobre 1966 et comprend initialement 20 stations réparties sur deux lignes.
L'idée de creuser un réseau de transport souterrain à Montréal remonte à la fin du XIXe siècle, mais elle n'a pas été concrétisée avant les années 1960. Le projet de métro revient à l'ordre du jour après la Seconde Guerre mondiale pour décongestionner le centre-ville et encourager la croissance urbaine à plus long terme. La disparition des tramways, complétée en 1959, accélère la recherche d'une solution complémentaire aux autobus pour le transport des travailleurs aux heures de pointe. Jean Drapeau gagne l'élection d'octobre 1960 en promettant notamment un métro.
Le projet est porté principalement par Jean Drapeau et par le président du Comité exécutif, Lucien Saulnier. Pour accélérer le processus décisionnel, la Ville de Montréal décide en janvier 1961 de construire le métro à ses frais, sans le concours des autres municipalités de l'île. Trois mois plus tard, en avril, un comité spécial formé d'élus, de fonctionnaires municipaux et de membres de la Commission des Transports est créé pour en étudier la faisabilité. Quant aux aspects techniques, ils relèvent de l'ingénieur et directeur du Service des travaux publics de la Ville, Lucien L'Allier, qui sera surnommé le « père du métro ».
Drapeau et Saulnier soumettent le projet de métro le 20 octobre 1961. Le tracé initial prévoit deux lignes souterraines longeant les deux principales artères commerciales de la ville, soit les rues Sainte-Catherine (est-ouest) et Saint-Denis (nord-sud). Pour y éviter les perturbations, il est construit sous les rues adjacentes.
La Ville fait appel aux ingénieurs George Derou et Jacques Gaston, tous deux à l'emploi de la Régie autonome des transports parisiens, pour étudier l'option de wagons sur pneumatiques. Conçue par la société Michelin et implantée depuis 1956 sur une ligne du métro de Paris, cette technologie novatrice a des avantages que les rails n'offrent pas: modernité, confort, meilleurs accélérations et freinages, électrification complète.
Les travaux débutent le 23 mai 1962. La conception des stations, dont chacune a ses particularités, est confiée à des architectes québécois et leur ornementation, à des artistes émergents. En novembre 1962, Montréal obtient l'Exposition universelle de 1967. Le choix audacieux des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame entraîne la mise en chantier de la ligne jaune vers Longueuil.
Le 14 octobre 1966, la cérémonie d'inauguration du métro se déroule à la station Berri-de-Montigny (Berri-UQAM). Plus de 5000 personnes sont présentes, dont l'archevêque de Montréal, le cardinal Paul-Émile Léger, et des dignitaires venus de France. Le maire Drapeau tient à ce que l'ouverture du métro se fasse moins de deux semaines avant les élections municipales, même si six stations ne sont toujours pas complétées. Elles le seront juste à temps pour l'ouverture de l'Exposition universelle le 28 avril 1967. Le métro aura coûté 213 millions aux contribuables montréalais.
Depuis son inauguration, le métro a connu trois phases d'expansion. En prévision des Jeux olympiques de 1976, la ligne verte est prolongée vers les quartiers de l'est et du sud-ouest. Dans les années 1980, le nombre de stations est porté à 65 grâce à la construction d'un quatrième axe (ligne bleue) et au prolongement de la ligne orange vers le nord-ouest de l'île. Trois autres stations sont ajoutées en 2007 sur le territoire de Laval. De nos jours, le métro en dessert 68 sur quatre lignes pour un total de 71 km de voies.
Construit en moins de quatre ans, le métro de Montréal est un exploit du génie québécois et une étape charnière de l'histoire des transports et de l'aménagement urbain au Québec. Au-delà de son activité première, le métro tient une place particulière comme lieu d'expression artistique dans la culture montréalaise.
ATTAL, Philippe-Enrico. « 1966 : Montréal inaugure le métro le plus moderne au monde ». Revue Historail. Vol. 32 (2015), p. 60-75.
CANTIENI, Graham. The Montreal Metro: Integration of Art and Architecture. Université Concordia, 1987. 92 p.
CLAIROUX, Benoit. Le Métro de Montréal : 35 ans déjà. Montréal, Hurtubise HMH, 2001. 159 p.
GIGNAC, Benoit. Le maire qui rêvait sa ville: Jean Drapeau. Montréal, Éditions La Presse, 2009. 296 p.
GILBERT, Dale. « Métro de Montréal ». Historica Canada. L'encyclopédie canadienne [En ligne]. http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/metro-de-montreal/
GILBERT, Dale. « Penser la mobilité, penser Montréal. La planification du tracé du réseau initial de métro, 1960-1966 ». Revue d'histoire de l'Amérique française. Vol. 68, no 1-2 (2014), p. 57-83.
PRÉVOST, Robert. Cent ans de transport en commun motorisé. Montréal, Proteau, 1993. 318 p.
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
Société de transport de Montréal. Histoire du métro [En Ligne]. http://www.stm.info/fr/a-propos/decouvrez-la-STM-et-son-histoire/histoire/50-ans-dhistoire-du-metro
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Tenue de l'Exposition universelle de Montréal de 1967

L'Exposition universelle de Montréal est un temps fort de l'histoire contemporaine de la ville de Montréal et du Québec. Cette exposition de première catégorie, reconnue comme la mieux réussie du XXe siècle, se déroule sur les îles de Montréal, au centre du fleuve Saint-Laurent, du 27 avril au 29 octobre 1967.
L'idée d'accueillir l'Exposition universelle à Montréal, à l'occasion du centième anniversaire de la Confédération canadienne, est suggérée en 1957 ou en 1958 par le publiciste Louis-Alphonse Barthe à Pierre Sévigny, ministre fédéral, qui soumet l'idée au premier ministre du Canada, John G. Diefenbaker. En 1958, le président du Sénat canadien, Mark Drouin, déclare à Bruxelles que le Canada devrait être l'hôte de l'Exposition de 1967. L'annonce fait les manchettes et le projet reçoit l'appui des gouvernements du Québec et du Canada, et du maire de Montréal, Sarto Fournier.
La candidature du Canada et de Montréal est soumise au Bureau international des expositions, qui confie toutefois en 1960 l'Exposition universelle de 1967 à l'Union des républiques socialistes soviétiques et à Moscou. L'URSS abandonne cependant l'organisation de l'exposition en avril 1962. Le maire de Montréal, Jean Drapeau, réactive alors la candidature de Montréal. Le 13 novembre 1962, l'organisation de l'Exposition est finalement octroyée au Canada et à Montréal.
Pour organiser l'événement, le Parlement du Canada adopte, le 20 décembre 1962, la loi créant la Compagnie canadienne de l'Exposition universelle de 1967. La Compagnie est financée en vertu d'une entente tripartite signée le 18 janvier 1963 par les gouvernements du Québec et du Canada, et la Ville de Montréal. La Compagnie est dirigée par un commissaire général, Paul Bienvenu, qui démissionne en 1964 et qui est remplacé par Pierre Dupuy. Robert Shaw est nommé commissaire adjoint et Andrew G. Kniewasser, directeur général. L'équipe de direction comprend également Pierre de Bellefeuille au service des exposants, le colonel Edward Churchill à l'aménagement, Philippe II de Gaspé-Beaubien à l'exploitation et Yves Jasmin aux relations publiques.
Pour accueillir l'Exposition de 1967, la Ville de Montréal aménage les îles situées au milieu du fleuve Saint-Laurent, ce qui nécessite des travaux d'envergure, notamment la prolongation du métro. Le plan d'ensemble du site est préparé par Édouard Fiset, architecte et urbaniste. Le thème principal choisi pour l'Exposition est « Terre des Hommes », titre d'un recueil d'essais autobiographiques d'Antoine de Saint-Exupéry, qui invite à la fraternité entre les peuples et au partage d'une conception optimiste de l'humanité et de son devenir.
Le 27 avril 1967, le gouverneur général du Canada, Roland Michener, proclame l'ouverture de l'Exposition universelle de Montréal, en présence du commissaire général Pierre Dupuy, du maire Jean Drapeau, du premier ministre du Québec Daniel Johnson, et du premier ministre du Canada Lester B. Pearson. Le lendemain, l'Expo 67 est ouverte au public. Pendant les 183 jours que dure l'événement, 50 306 648 visiteurs découvrent avec émerveillement les pavillons des 62 pays et des 120 gouvernements participants, les pavillons thématiques et privés, ainsi que le parc d'attractions. L'Expo 67 offre en effet une vitrine exceptionnelle aux idées novatrices. Plusieurs personnalités d'État, dignitaires, journalistes et vedettes internationales se joignent à la fête. L'Expo 67 donne aussi lieu à de nombreuses manifestations artistiques et sportives.
Les retombées économiques et culturelles de l'Exposition universelle de Montréal sont immenses. L'événement permet la réalisation de projets d'infrastructures d'envergure et donne l'occasion à la métropole québécoise de se hisser parmi les grandes villes du monde. Dans le contexte bouillonnant de la Révolution tranquille, l'Expo 67 permet aussi aux Montréalais et aux Québécois de renouveler leur regard sur le monde, et au monde de découvrir le Québec moderne.
Cet événement historique a été désigné pour les motifs suivants:
L'Exposition universelle de Montréal, aussi connue sous le nom d'Expo 67, est un temps fort de l'histoire contemporaine de la ville de Montréal et du Québec. Cette exposition de première catégorie, reconnue comme la mieux réussie du XXe siècle, se déroule sur les îles de Montréal, au centre du fleuve Saint-Laurent, du 27 avril au 29 octobre 1967, à l'occasion du centième anniversaire de la Confédération canadienne. L'événement est organisé par la Compagnie canadienne de l'Exposition universelle, une société de la Couronne fédérale financée par les gouvernements du Québec et du Canada, et par la Ville de Montréal. Ayant pour thème « Terre des Hommes », l'événement invite à la fraternité entre les peuples et au partage d'une conception optimiste de l'humanité et de son devenir. Pendant les 183 jours que dure l'Exposition, 50 306 648 visiteurs découvrent avec émerveillement les pavillons des 62 pays et des 120 gouvernements participants, les pavillons thématiques et privés, ainsi que le parc d'attractions. L'aménagement du site et des pavillons offre une vitrine exceptionnelle aux idées novatrices, notamment en matière d'urbanisme, d'architecture, d'architecture du paysage et de design. Plusieurs personnalités d'État, dignitaires, journalistes et vedettes internationales prennent part à la fête et attirent l'attention sur Montréal. L'Exposition donne aussi lieu à de nombreuses manifestations artistiques et sportives. Les retombées économiques et culturelles de l'Exposition pour la ville de Montréal et le Québec sont immenses. L'événement permet la réalisation de projets d'infrastructures d'envergure et donne l'occasion à la métropole québécoise de se hisser parmi les grandes villes du monde. Dans le contexte bouillonnant de la Révolution tranquille, l'Expo 67 permet aussi aux Montréalais et aux Québécois de renouveler leur regard sur le monde, et au monde de découvrir le Québec moderne.
Compagnie canadienne de l'Exposition universelle de 1967. Expo 67, guide officiel, suivi d'un chapitre spécial sur les fêtes du centenaire. Toronto, Maclean-Hunter, 1967. 352 p.
Compagnie canadienne de l'Exposition universelle de 1967. Rapport général sur l'exposition universelle de 1967. Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1969. s.p.
DESILETS, Luc. Expo67 : 50 ans, 50 souvenirs marquants et autres secrets bien gardés. Laval, Guy Saint-Jean éditeur, 2017. 255 p.
DUPUY, Pierre. Expo 67, ou, La découverte de la fierté. Montréal, Éditions La Presse, 1972. 237 p.
JASMIN, Yves. La petite histoire d'Expo 67 : l'Expo 67 comme vous ne l'avez jamais vue. Québec, Québec/Amérique, 1997. 461 p.
LAMBERT, Maude-Emmanuelle. « Expo 67 ». Historica Canada. L'encyclopédie canadienne [En ligne]. http://www.encyclopediecanadienne.ca/
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Dépôt du rapport Rioux

Le 25 février 1969, la Commission d’enquête sur l’enseignement des arts au Québec (Commission Rioux) dépose son rapport au gouvernement unioniste dirigé par Jean-Jacques Bertrand.
Cette Commission d’enquête est créée le 31 mars 1966 par la prise d’un décret du gouvernement libéral de Jean Lesage, selon une proposition conjointe du ministre de l’Éducation, Paul Gérin-Lajoie, et du ministre des Affaires culturelles, Pierre Laporte. La Commission a pour mandat « d’étudier toutes les questions relatives à l’enseignement des arts, y compris les structures administratives, l’organisation matérielle des institutions affectées à cet enseignement et la coordination de ces institutions avec les écoles de formation générale ». La formation de cette Commission s’inscrit dans la mouvance de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec (Commission Parent). Elle donne également suite aux grèves étudiantes qui ponctuent l’année scolaire 1965-1966 de l’École des Beaux-Arts de Montréal.
Le sociologue Marcel Rioux assure la présidence de la Commission d’enquête et Jean Ouellet, la vice-présidence. Ils sont assistés de Réal Gauthier, étudiant aux Beaux-Arts de Montréal, de l’auteur et réalisateur Fernand Ouellette, de Jean Deslauriers et d’Andrée Paradis. Les commissaires mènent une réflexion en profondeur. Ils analysent 118 mémoires et étendent leur étude au reste du Canada, aux États-Unis et à l’Europe.
Déposé en 1969, le rapport final de la Commission est publié au mois d’avril suivant. Il est composé de quatre tomes, totalisant 881 pages. Il contient 368 recommandations. En plus de proposer une refonte de l’enseignement des arts, le rapport met de l’avant un véritable projet de société dans lequel les arts et leur enseignement sont appelés à jouer un rôle prépondérant et nécessaire.
Le dépôt du rapport Rioux est réputé pour avoir bousculé le secteur de l’éducation. Il constitue néanmoins une réflexion québécoise de premier ordre sur la place des arts dans le monde contemporain et permet, plus concrètement, de légitimer l’enseignement des arts dans les différents niveaux du système d’éducation issu de la Révolution tranquille.
CORBO, Claude. Art, éducation et société postindustrielle : Le rapport Rioux et l’enseignement des arts au Québec (1966-1968). Sillery, Septentrion, 2006. 363 p.
COUTURE, Francine et Suzanne LEMERISE. « Le Rapport Rioux et les pratiques innovatrices en arts plastiques ». HAMEL, Jacques et Louis MAHEU. Hommage à Marcel Rioux. Sociologie critique, création artistique et société contemporaine. Montréal, Les Éditions Albert Saint-Martin, 1992, p. 77-94.
HAROUN, Thierry. « 42 ans plus tard - Le rapport Rioux suscite toujours le débat ». Le Devoir, 8 janvier 2011, s.p.
RIOUX, Marcel, dir. Rapport de la Commission d’enquête sur l’enseignement des arts au Québec. Québec, Éditeur officiel du Québec, 1969. s.p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Premier match à domicile des Expos de Montréal

Le 14 avril 1969, les Expos de Montréal jouent la première partie à domicile de leur histoire. Il s’agit alors du premier match régulier du baseball majeur disputé à l’extérieur des États-Unis.
C’est à la fin de l’année 1967 que la Ville de Montréal, portée par le succès récent de l’exposition universelle, présente sa candidature pour l’obtention d’une franchise dans la Ligue nationale de baseball. Le maire Jean Drapeau et le vice-président du comité exécutif, Gerry Snyder, sont les promoteurs du dossier.
Le 27 mai 1968, à Chicago, le président de la Ligue nationale de baseball, Warren Giles, annonce que le comité de sélection responsable de l’expansion a retenu les candidatures de San Diego et Montréal. À moins d’un an du match inaugural, la nouvelle franchise n’a toutefois ni propriétaire, ni stade. Certains médias se demandent même si Montréal sera en mesure de remplir ses obligations. Le 8 août, le maire Jean Drapeau annonce que le stade du parc Jarry sera le domicile temporaire de l’équipe et qu’il sera agrandi au coût de 3 millions $. Le 14 août, les membres du consortium ayant finalement acquis la franchise pour la somme de 10 millions $ sont présentés au public. L’homme d’affaires montréalais, Charles Bronfman, en est l’actionnaire principal.
Lors du match inaugural du 14 avril 1969, grâce à une performance éclatante du voltigeur, Mack Jones, qui devient instantanément le héros des partisans, les Expos vainquent les Cardinals de Saint-Louis par la marque de 8 à 7, devant une foule de plus de 29 000 spectateurs et d’environ 200 représentants des médias. Pour ajouter à la solennité de l’événement, le président de la Ligue nationale de baseball, Warren Giles, et le commissaire du baseball, Bowie Kuhn, assistent à la partie en compagnie du maire de Montréal et du premier ministre du Québec, Jean-Jacques Bertrand. C’est d’ailleurs le premier ministre qui eut l’honneur de faire le premier lancer protocolaire.
DOUCET, Jacques et Marc ROBITAILLE. Il était une fois les Expos. Tome 1 : Les années 1969-1984. Montréal, Hurtubise, 2009. 647 p.
HUMBERT, William. « Expos de Montréal ». Historica Canada. L’encyclopédie canadienne [En ligne]. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/expos-de-montreal
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
ROBERT, Mario. « Chronique Montréalité no 33 : Nos Expos, nos amours 1969-2004 ». Archives de Montréal. Archives de la ville de Montréal [En ligne]. http://archivesdemontreal.com/2015/03/30/chronique-montrealite-no-33-nos-expos/
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Création du Conseil du statut de la femme

La création du Conseil du statut de la femme, le 6 juillet 1973, représente un événement important dans l’histoire des femmes au Québec. Après avoir lutté pour la reconnaissance de leurs droits civiques et juridiques, les femmes se mobilisent pour améliorer également leur condition sociale. La Fédération des femmes du Québec, mise sur pied en 1966, porte le message des militantes et des associations de femmes. Elle appuie notamment l’une des principales recommandations de la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada, instituée en 1967, soit de constituer un Office de la femme. Le gouvernement québécois accueille favorablement cette proposition. Le 12 décembre 1972, le projet de loi no 63 visant à créer le Conseil du statut de la femme est déposé à l’Assemblée nationale par Claire Kirkland-Casgrain, première députée au Québec. Il sera adopté à l’unanimité le 5 juillet 1973 et obtiendra la sanction royale le lendemain.
Le nouvel organisme a le mandat de conseiller le ou la ministre, de mener des études, d’entendre les requêtes citoyennes et d’informer la population sur toute question relative à l’égalité des femmes et au respect de leurs droits. Durant les années suivantes, le Conseil entretient des relations suivies avec les groupes qui défendent les droits des femmes, tout en conservant une neutralité de principe, et fait valoir leurs revendications auprès du gouvernement. Son influence sur l’État et la société se manifeste aussi par les études menées sous son égide et diffusées sous forme de rapports ou dans sa revue mensuelle, La Gazette des femmes, lancée en 1979. L’action des groupes de femmes et du Conseil du statut de la femme contribue à l’adoption de mesures législatives, de politiques, de stratégies gouvernementales, de programmes pour lutter contre les inégalités entre les sexes. En faisant la promotion de l’égalité des femmes et du respect de leurs droits, le Conseil participe à l’évolution de la société.
Cet événement historique est désigné pour les motifs suivants:
La création du Conseil du statut de la femme représente un moment charnière pour l'avancement des droits des femmes au Québec. L'instauration de cet organisme est proposée au gouvernement en décembre 1971 par la Fédération des femmes du Québec, qui avait précédemment participé aux travaux de la Commission royale d'enquête sur la situation de la femme au Canada. Le Conseil voit le jour le 6 juillet 1973 lors de la sanction du projet de loi présenté à l'Assemblée nationale par Claire Kirkland-Casgrain, le 12 décembre 1972. Il est appelé à jouer un rôle d'intermédiaire entre l'État, les associations féministes et la population en général. Il fait notamment valoir les revendications des femmes auprès du gouvernement, œuvre à éduquer la société sur les enjeux de la condition féminine et intervient dans les débats publics. En collaboration avec d'autres groupes de femmes, le Conseil a été en première ligne dans la promotion du principe de l'égalité entre les femmes et les hommes et dans la mise en place de plusieurs mesures sociales. Le Conseil poursuit de nos jours son œuvre en contribuant au changement social et à la progression constante des droits des femmes.
Assemblée nationale du Québec. Par ici la démocratie. Ligne du temps [En Ligne]. http://paricilademocratie.com/
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La ligne du temps du Québec [En Ligne]. https://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
Conseil du statut de la femme et Réseau québécois en études féministes. Ligne du temps de l'histoire des femmes au Québec [En Ligne]. http://www.histoiredesfemmes.quebec/
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Superfrancofête

Reconnue comme le premier grand événement international accueilli à Québec, la Superfrancofête est un rassemblement culturel et sportif qui réunit des artistes et des athlètes provenant de quatre continents. Lancé par l’Agence de coopération culturelle et technique (devenue l’Organisation internationale de la francophonie), l’événement attire plus d’un million de festivalières et festivaliers réunis sous le signe de la jeunesse et de l’ouverture sur le monde. Souvent considéré comme le premier spectacle extérieur d’envergure au Québec, le spectacle d’ouverture J’ai vu le loup, le renard, le lion réunit sur une même scène Félix Leclerc, Gilles Vigneault et Robert Charlebois et attire plus de 100 000 personnes sur les plaines d’Abraham. Du 13 au 24 août 1974, la Superfrancofête fait rayonner la ville de Québec et célèbre la vitalité de la langue française qui vient alors d’être déclarée langue officielle du Québec.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La ligne du temps du Québec [En Ligne]. https://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
LABERGE, Yves. « La Superfrancofête à Québec, de 1974 ». Cap-aux-Diamants. No 160 (2025), p. 60-61.
PORTER, Isabelle. « Superfrancofête de 1974: y étiez-vous? ». Le Devoir, 15 août 2014, s.p.
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
TURMEL, Julie. « Superfrancofête de 1974, la fête s’empare de Québec ». Ville de Québec. Site officiel de la Ville de Québec [En ligne]. https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/patrimoine/espace/2017/billet-superfrancofete.aspx
Université de Sherbrooke. Bilan du siècle. Site encyclopédique sur l’histoire du Québec depuis 1900 [En Ligne]. http://bilan.usherbrooke.ca
s.a. « Commémorations. Se souvenir de 1974 ». Commission de la Capitale Nationale du Québec. Commission de la capitale nationale du Québec [En ligne]. https://www.capitale.gouv.qc.ca/histoire-et-patrimoine/commemorations/se-souvenir-de-1974/
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
Adoption de la Charte des droits et libertés de la personne

Le 27 juin 1975, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne est adoptée par l’Assemblée nationale du Québec.
L’adoption de cette loi répond à de nombreuses pressions issues de la société civile au fil des ans. En 1963, le professeur de droit Jacques-Yvan Morin réclame dans la Revue de droit de McGill l’adoption d’une charte des droits de l’homme pour le Québec, dont il présente une ébauche. Le Québec fait alors figure de retardataire dans ce domaine au Canada. Au début des années 1970, il est la dernière province sans législation sur les droits de l’homme.
Peu après sa publication, l’article de Jacques-Yvan Morin est republié par la Ligue des droits de l’homme (devenue la Ligue des droits et libertés en 1978), une association de défense des droits fondée en 1963 et qui compte alors parmi ses sympathisants Pierre Elliott Trudeau, Jacques Hébert, Frank Scott et Thérèse Casgrain. Depuis sa création, elle milite elle aussi pour l’adoption d’une charte des droits par le Québec. En se basant sur l’ébauche produite par Jacques-Yvan Morin, elle entame une campagne de lobbying auprès du gouvernement québécois, multipliant les conférences et les interventions publiques.
Les pressions qu’exerce la Ligue des droits de l’homme poussent le gouvernement unioniste de Daniel Johnson à mettre sur pied en 1967 la Commission Prévost sur l’administration de la justice en matière criminelle et pénale au Québec. Le rapport qu’elle soumet en 1968 préconise l’adoption d’une Charte des droits.
Au début des années 1970, tous les partis politiques représentés à l’Assemblée nationale expriment leur soutien à l’adoption d’un pareil texte législatif. Au printemps 1971, le premier ministre Robert Bourassa mandate Frank Scott, de la Ligue des droits de l’homme, et le juriste Paul Crépeau pour rédiger une ébauche de charte des droits. Le rapport qu’ils remettent en juillet 1971 recommande l’affirmation des droits civils, politiques, judiciaires, culturels et sociaux des personnes sous la juridiction québécoise.
Le gouvernement tarde à donner suite au travail de Scott et Crépeau. En 1973, la Ligue des droits de l’homme publie un nouveau projet de charte des droits, relayé par de nombreux journaux. Le 29 octobre 1974, le ministre de la Justice Jérôme Choquette dépose finalement à l’Assemblée nationale le projet de loi no 50 — Charte des droits et libertés de la personne. Son texte est largement inspiré du document produit par Scott et Crépeau. Il affirme de nombreux droits fondamentaux et prévoit la création d’une commission pour en assurer l’exercice. Il se démarque des législations adoptées par les autres provinces canadiennes sur les droits de l’homme qui se limitent à interdire la discrimination. Le projet de loi est étudié en commission parlementaire de novembre à mars 1975 et suscite de nombreux débats, notamment sur sa préséance sur les autres législations.
Le 27 juin 1975, l’Assemblée nationale adopte à l’unanimité le projet de loi no 50, qui est sanctionné le même jour. La Charte des droits et libertés de la personne a un statut de loi fondamentale, c’est-à-dire qu’elle prime les autres législations, bien qu’il soit possible d’y déroger. Elle interdit notamment les discriminations fondées sur l’origine ethnique, la religion et le sexe. Elle protège également certains droits sociaux et économiques, dont le droit à l’instruction gratuite, le droit à un niveau de vie décent et le droit à l’information. Enfin, la Charte des droits et libertés de la personne crée la Commission des droits de la personne, chargée de la promotion et du respect de la Charte.
La Charte des droits et libertés de la personne entre pleinement en vigueur le 28 juin 1976. Le Québec est depuis la seule province canadienne à avoir adopté sa propre loi fondamentale qui protège les droits et libertés de ses citoyens.
Assemblée nationale du Québec. Par ici la démocratie. Ligne du temps [En Ligne]. http://paricilademocratie.com/
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La ligne du temps du Québec [En Ligne]. https://numerique.banq.qc.ca/ligne-du-temps
CLÉMENT, Dominique. Canada’s Rights Revolution. Social Movements and Social Change, 1937-82. Vancouver, UBC Press, 2008. 281 p.
Collectif. De la Charte québécoise des droits et libertés : origine, nature et défis. Montréal, Éditions Thémis, 1989. 339 p.
Conseil du statut de la femme et Réseau québécois en études féministes. Ligne du temps de l’histoire des femmes au Québec [En Ligne]. http://www.histoiredesfemmes.quebec/
LEMONDE, Lucie. « Charte des droits et libertés de la personne du Québec ». Historica Canada. L’encyclopédie canadienne [En ligne]. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/charte-des-droits-et-libertes-de-la-personne-du-quebec
MORIN, Jacques-Yvan. « Une charte des droits de l’homme pour le Québec ». McGill Law Journal Revue de droit de McGill. Vol. 9, no 4 (1963), p. 273-316.
PROVENCHER, Jean. Chronologie du Québec depuis 1534. Quatrième édition mise à jour. Montréal, Boréal, 2017. 400 p.
Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec




















































